Le coin des traîtres : pièges, surprises, vertiges, plaisirs et mystères de la traduction…
Depuis quelques années, je m’intéresse très personnellement, car cela influe sur ma propre façon d’écrire, à tout ce qui touche à la traduction et à l’auto-traduction. Cet intérêt est lié à une biographie un peu frontalière, un peu migrante : mon père et certains de mes sept frères ont émigré en Amérique latine. Moi même, j’ai connu un immense sentiment de déracinement géographique et social quand, à l’âge de douze ans, je suis passée d’une vie à l’air libre, au milieu des vaches et des araires, dans un petit village de Galice, à l’internat d’une école de bonnes sœurs en ville.
Dans mon village, on parlait une langue méprisée car fruste, une langue de ploucs, propre à des gens « sans culture » : le galicien. En ville, dans cette école pour demoiselles issues de la bonne bourgeoisie, on parlait la langue « nationale » : le castillan. Le galicien était à l’époque, là-bas comme ailleurs, objet de moqueries. C’étaient les années 1960, nous étions en pleine dictature franquiste.
À l’âge de 23 ans, j’ai déménagé à Madrid, où je vis depuis lors : ce n’est pas exactement chez moi, mais Madrid est une ville d’accueil, elle sait apprécier tous les accents.
Cette position toujours frontalière a peut-être favorisé un certain penchant à circuler dans des zones de conflit, le conflit étant entendu comme espace de discussion, de recherche et d’approche d’une forme de vérité. La traduction de la poésie est une zone de conflit. J’appartiens au clan de celles qui apprécient d’avoir pu lire Shakespeare, Rimbaud ou Emily Dickinson en traduction, et j’ai du mal à comprendre cette position assez fréquente des gens qui refusent de les lire s’ils ne peuvent le faire en version originale. J’apprécie davantage encore les éditions bilingues, qui m’aident, avec mes pauvres connaissances des autres langues, à comprendre leurs poètes. Moi-même, je suis bilingue galicien-castillan et j’habite, aussi bien dans la vie que dans l’écriture, cette étrange frontière linguistique qui est aussi – ou surtout – une frontière sociale.
Je ne saurais expliquer correctement ma relation au langage, aux langues, à la traduction, à l’auto-traduction et à la poésie sans expliquer d’abord la raison pour laquelle ma poésie trouve son équilibre sur cette ligne brisée et instable des croisements linguistiques, qui est en même temps un formidable espace de liberté créative. C’est là que se situe l’origine de tout : dans cette distance entre la ville et le village, entre l’exercice de la domination et l’acceptation du caractère subalterne de l’un vis-à-vis de l’autre. Et puis aussi dans mon désaccord avec l’idée qu’il existe de bonnes langues et de mauvaises langues, mon désaccord avec une étrange interprétation de ce qu’est la culture et avec cette singulière conception de la supériorité des uns sur les autres et de la ville sur le monde rural. Je vais donc à présent tenter de résumer des siècles d’histoire, des siècles de mauvaises relations entre ma langue de naissance, le galicien, et ma langue « de formation », le castillan.
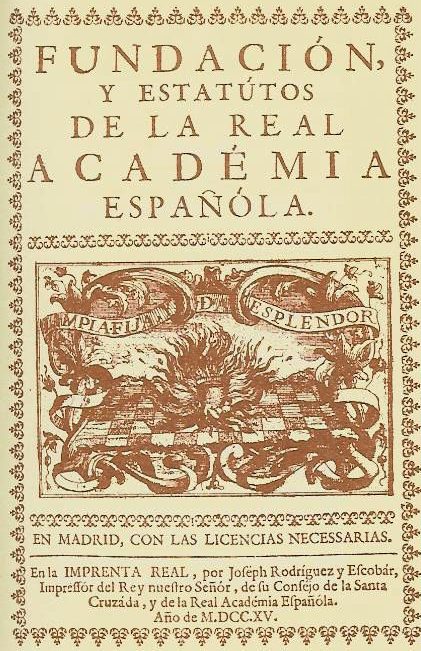 L’État espagnol exerce depuis bien longtemps une politique linguistique centralisatrice, colonisatrice [1]. La Real Academia española, depuis sa fondation en 1713, y a collaboré, toujours obéissante et fidèle à l’idée de départ : « nettoyer, fixer et faire resplendir ». Ce fut tout particulièrement le cas durant les années de dictature franquiste, mais cela perdure aujourd’hui, même si leurs griffes respectives ont été recouvertes de vernis. La très riche variété dialectale du castillan – incluant toutes les variantes latino-américaines – ainsi que les autres langues de la péninsule – le galicien, le catalan et le basque – sont les victimes de cet élan colonisateur.
L’État espagnol exerce depuis bien longtemps une politique linguistique centralisatrice, colonisatrice [1]. La Real Academia española, depuis sa fondation en 1713, y a collaboré, toujours obéissante et fidèle à l’idée de départ : « nettoyer, fixer et faire resplendir ». Ce fut tout particulièrement le cas durant les années de dictature franquiste, mais cela perdure aujourd’hui, même si leurs griffes respectives ont été recouvertes de vernis. La très riche variété dialectale du castillan – incluant toutes les variantes latino-américaines – ainsi que les autres langues de la péninsule – le galicien, le catalan et le basque – sont les victimes de cet élan colonisateur.
Depuis le Moyen Âge, le galicien s’est retrouvé cantonné au monde rural de la Galice et exclu des villes, des institutions, de la culture officielle, de la langue écrite et de la littérature. Jusqu’aux années 1980, nous parlions galicien au village et à la maison mais à l’école, à tous les niveaux de notre scolarité, nous apprenions et nous nous exprimions en castillan. Un mot laissé sur la table de la cuisine était écrit en castillan. Les lettres envoyées à ceux qui avaient émigré à Caracas étaient écrites en castillan. Le galicien n’existait pas comme langue écrite. Même si nous parlions galicien entre nous, par écrit nous communiquions en castillan.
Il en a été ainsi jusqu’il y a peu, et ma génération peut en en témoigner. À la fin du XIXe siècle, un fort sentiment nationaliste galicien a surgi au sein des classes moyennes cultivées des villes de Galice, parlant habituellement espagnol, qui ont commencé à imaginer que la langue galicienne pouvait être le lien et le support de ce sentiment nationaliste. Ce moment est intéressant : d’un côté, de grands poètes locaux tels que Rosalía de Castro ou Manuel Curros Enríquez adoptent sans rechigner le galicien comme leur langue d’écriture poétique et parviennent, avec cette langue de paysans et de marins, à élaborer de l’excellente poésie. Au même moment, des membres de l’intelligentsia nationaliste commencent à se dire que cette langue, qu’ils considèrent comme rudimentaire et pauvre, a besoin de normes pour être plus respectable et pouvoir accéder au rang de vecteur culturel [2]. C’est seulement après la mort de Franco que les tentatives de normalisation se sont cristallisées, mais cette idée qu’il était nécessaire de rendre la langue « respectable » a été à la base de tout ce processus.
À force de subir le mépris envers le galicien qui était leur langue quotidienne, les habitants du monde rural se sont mis à intérioriser l’idée que leur parler était linguistiquement subalterne par rapport au castillan. Tout en sentant que le galicien était la langue qui leur était propre, celle dans laquelle ils se reconnaissaient. On peut parler dès lors de diglossie. Quand il leur faut parler castillan, par courtoisie envers l’interlocuteur ou parce qu’ils considèrent que le parler leur confère un certain « statut » social, ils le font en étant conscients de parler une langue étrangère à leur monde, une langue qu’ils « ne parlent pas bien » et qu’ils appellent, en pratiquant l’auto-dénigrement, du castrapo.
Le castrapo est un castillan où interfère une bonne dose d’éléments lexicaux et grammaticaux du galicien, en quantité variable selon l’origine des locuteurs. On trouve encore aujourd’hui dans les villes des locuteurs à la frontière des deux langues mais le poids des éléments provenant du galicien est beaucoup plus fort chez ceux qui le parlent habituellement dans le monde rural et pour qui le castillan est une seconde langue. Le mot castrapo a une connotation très négative, c’est un malparler. C’est du moins le sens qu’il avait jusqu’à une période récente.
Depuis les années 1980, les défenseurs de la normalisation de la langue, les créateurs de la langue standard, n’ont eu de cesse de qualifier le galicien rural de castrapo. Ce glissement sémantique souligne de façon honteuse le mépris des classes urbaines cultivées à l’égard des habitants du monde rural, un mépris qui a gagné du terrain depuis le XIXe siècle et le Rexurdimento [3]. Ceux qui parlent galicien doivent aujourd’hui subir l’offense de s’entendre dire qu’ils parlent castrapo, alors même qu’ils parlent le galicien qu’ils ont toujours pratiqué (castrapo, j’insiste, c’est le mot qu’ils utilisaient pour faire référence à leur malparler, leur castillan. On les reconnaît comme des locuteurs non pas de galicien mais d’un castillan détérioré ; eux qui ont conservé le galicien comme langue vivante durant plus de cinq cents ans contre tout tentative de colonisation, pendant que le monde urbain et cultivé leur tournait le dos) [4].
Double diglossie aujourd’hui : leur galicien et leur castillan sont aussi mauvais l’un que l’autre ; pire, ils sont la même chose, une langue de gens frustes, une langue inférieure, indigne, de sauvages – on entend ce genre de choses. Ils ne savent pas parler. L’indignité du galicien rural est un lieu commun vivace [5]. Rien d’étonnant : les inégalités sociales et les oppositions entre ce qui est socialement bien ou mal sont plus vives que jamais.
***
Mes livres antérieurs à 2006 sont écrits en castillan [6]. Casa pechada (2006) est écrit en galicien standard ; Cativa en su lughar (2012) est écrit en castrapo et m’ouvre à la merveilleuse liberté d’écrire de la poésie avec une langue sans norme ; tra(n)shumancias (2015) contient des poèmes en galicien, en castillan, en castrapo et aussi des poèmes où s’entrecroisent ces langues et d’autres ; mon dernier livre, CO CO CO U (2017), est écrit dans le dialecte galicien de mon secteur, avec toutes les particularités phonétiques locales. Je continue à chercher ma langue poétique.
 Cativa en su lughar est le livre qui m’offre un langage, celui qui change tout. On m’avait demandé une version en castillan de Casa pechada. Mais Casa pechada est un livre au contenu rural, où abonde la terminologie propre au village, à ses maisons, à ses animaux, à ses occupations, à ses craintes, à ses sentiments. J’ai essayé de le traduire en castillan et je n’ai pas eu de mal à le faire mais il ne restait rien du monde de Casa pechada une fois traduit dans ce castillan qui est le mien, que j’appelle un castillan « de formation », avec toutes les approximations que ce terme contient. Le résultat était en plastique de mauvaise qualité, une chose aussi froide et morte qu’un cadavre. À l’époque, j’avais déjà fait quelques tentatives d’écriture en castrapo et je me suis dit que la langue qu’il fallait pour ma traduction était peut-être bien le castrapo, ce mauvais castillan que nous utilisions pour parler avec les instituteurs, les curés, les médecins et les représentants de l’administration. C’est ce qui s’est passé : le castrapo me permettait de traduire ce monde de façon vivante, véridique et compréhensible à partir de l’espagnol.
Cativa en su lughar est le livre qui m’offre un langage, celui qui change tout. On m’avait demandé une version en castillan de Casa pechada. Mais Casa pechada est un livre au contenu rural, où abonde la terminologie propre au village, à ses maisons, à ses animaux, à ses occupations, à ses craintes, à ses sentiments. J’ai essayé de le traduire en castillan et je n’ai pas eu de mal à le faire mais il ne restait rien du monde de Casa pechada une fois traduit dans ce castillan qui est le mien, que j’appelle un castillan « de formation », avec toutes les approximations que ce terme contient. Le résultat était en plastique de mauvaise qualité, une chose aussi froide et morte qu’un cadavre. À l’époque, j’avais déjà fait quelques tentatives d’écriture en castrapo et je me suis dit que la langue qu’il fallait pour ma traduction était peut-être bien le castrapo, ce mauvais castillan que nous utilisions pour parler avec les instituteurs, les curés, les médecins et les représentants de l’administration. C’est ce qui s’est passé : le castrapo me permettait de traduire ce monde de façon vivante, véridique et compréhensible à partir de l’espagnol.
Et l’inattendu est survenu, la surprise qui te saisit toujours quand la poésie surgit : je pouvais inventer n’importe quel mot, j’étais libre, il n’y avait pas de normes, j’habitais la frontière de tous les croisements où les mots résonnent de toutes les couleurs imaginables. Les poèmes grandissaient, prenaient de l’ampleur, se transformaient, intégrant d’autres changements qui s’étaient produits en moi depuis l’écriture de Casa pechada, six ans plus tôt.
De plus, certains mots, certaines tournures pouvaient avoir besoin d’une définition ou d’une explication. Surgit alors la glose. Et la glose joue avec le nouveau langage et finit par se transformer en poème, en éclairant ce qui n’en a pas besoin, en biaisant, en occultant. Au bout du compte, ce que qui aurait pu être une traduction s’est révélé une trahison qui, selon l’opinion de mes amis et la mienne, surpassait largement l’original. Et l’univers de Casa pechada était sauvé, fidèlement traduit. Mieux encore, Casa pechada a été lu surtout à partir de de Cativa en su lughar quand les deux livres sont parus en même temps en version bilingue.
Un traducteur étranger à l’œuvre n’aurait rien pu faire d’approchant. (Uu peut-être que si ? Jusqu’à quel point ?) J’ai entendu une fois un confrère poète dire : « se traduire soi-même, c’est comme s’opérer soi-même ». Je ne saurais être plus en désaccord : s’opérer soi-même, ce ne serait pas seulement impossible mais terriblement douloureux. Alors que l’auto-traduction peut devenir un pur plaisir : il est facile de se trahir soi-même mais, dans le fond, on sait qui on est.
Ma vengeance était enfin venue : le castrapo, cette langue misérable, cette chose inutilisable, pouvait me servir à écrire l’un de mes meilleurs livres (je crois). L’honneur des miens était sauf. Un peu de justice avait été rendue. Cela m’a fait du bien.
 tra(n)shumancias est ensuite venu confirmer que les langues se laissent contaminer, fondre, traverser. Que dans l’Europe actuelle, nous n’arrêtons pas d’interpréter et de traduire. Que c’est dans la trahison, comme dans l’erreur, que la poésie laisse choir, comme par inadvertance, ses meilleures trouvailles. Que les métissages linguistiques sont aussi naturels que les autres, que les langues migrent avec les gens parce qu’elles appartiennent aux peuples qui les parlent plus qu’à leurs Académies ou à leurs grammaires et leurs grammairiens. Que traduire n’est pas autre chose que créer.
tra(n)shumancias est ensuite venu confirmer que les langues se laissent contaminer, fondre, traverser. Que dans l’Europe actuelle, nous n’arrêtons pas d’interpréter et de traduire. Que c’est dans la trahison, comme dans l’erreur, que la poésie laisse choir, comme par inadvertance, ses meilleures trouvailles. Que les métissages linguistiques sont aussi naturels que les autres, que les langues migrent avec les gens parce qu’elles appartiennent aux peuples qui les parlent plus qu’à leurs Académies ou à leurs grammaires et leurs grammairiens. Que traduire n’est pas autre chose que créer.
En 2017 est sorti CO CO CO U, timide et bégayant, comme citoyen d’une langue subalterne, reprenant par écrit la phonétique et la cadence et les contractions et les petits accouchements douloureux des gens de mon village, Alén, avec ses morts et ses petites mortes, qui ignorent tout ce dont je vous parle, excepté le fait que leur pauvre langue « ne sert à rien ». Et j’ai déjà entendu dire qu’il s’agissait d’un livre écrit en castrapo. Je comprends que la confusion soit possible mais non, ne vous y trompez pas, c’est bien du galicien, du galicien de Alén, de gens qui le parlent depuis plus de cinq cents ans.

La traduction de ce livre en castillan a été réalisée par Ángela Segovia, une grande poétesse. Je lui ai dit : « trahis-moi si tu veux, sens-toi libre ». Et en me trahissant parfois, elle ne m’a jamais trahie. Elle a choisi le castillan du village de sa grand-mère, dans une zone rurale de Castille et elle est partie là-bas, pour traduire un monde subalterne dans un autre monde subalterne, une langue de pauvres dans une langue de pauvres. Brillamment libre.
Je ne sais ce qui sortira de ce que la poésie est en train de faire de moi ces derniers temps. Un va-et-vient, un continuel aller-retour entre les langues. J’écris en parallèle une forme de traduction-création qui soudain crée des surprises, comme ces cailloux dont sortent des étincelles quand on les frotte ou comme ces couples qui, assis face à face au café, commencent en même temps le même geste ou le même mot et sourient pour célébrer la concordance et la télépathie. Le résultat sera quelque chose d’étrangement bilingue, où deux langues sœurs de lait se donnent la becquée, comme des oiseaux, comme des fiancées.
Luz Pichel
Traduit de l’espagnol par Christilla Vasserot
Le coin des traîtres
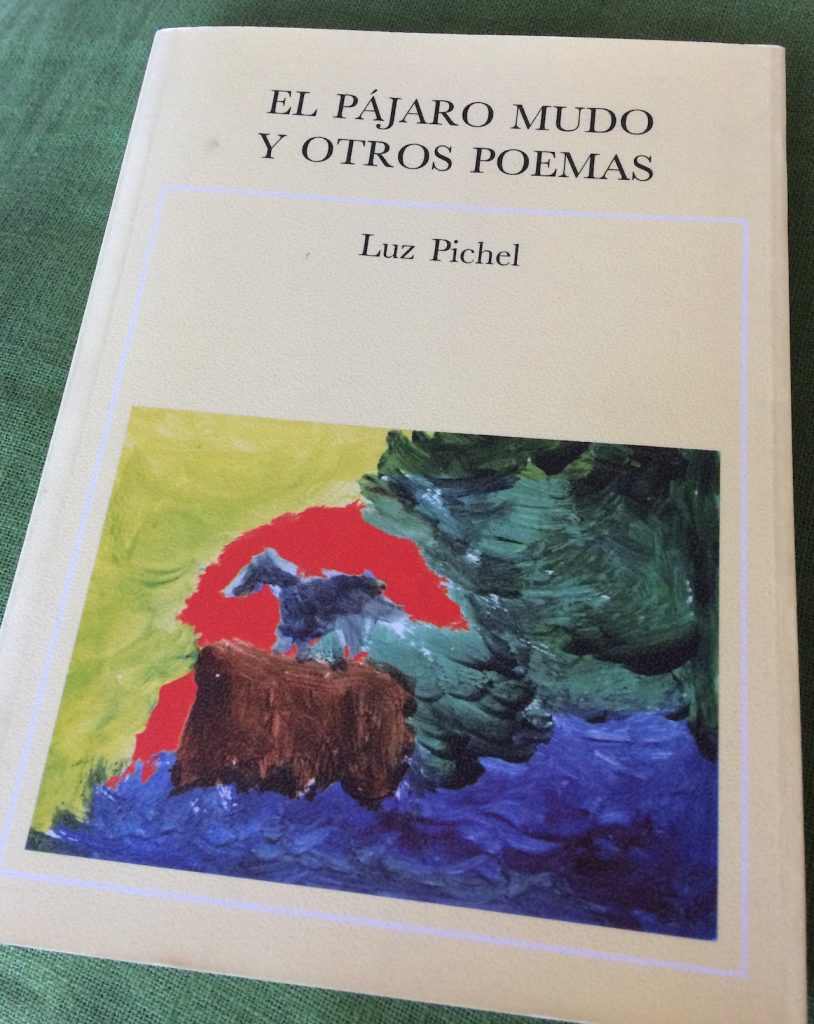 Luz Pichel (Alén, Lalín, Pontevedra, 1947) réside alternativement à Madrid, où elle vit depuis 1970, et, pour de courtes périodes de repos, dans son village de Alén. Elle a publié les recueils de poésie El Pájaro mudo (ed. La Palma, 1990), La Marca de los potros (Diputación de Huelva, 2004), Casa Pechada (Fundación Caixa Galicia, 2006), El Pájaro mudo y otros poemas (Universidad Popular José Hierro, 2004) qui inclut une réédition de son premier recueil auquel viennent s’ajouter de nouveaux écrits (Ángulo de la niebla, Cartas de la mujer insomne y Hablo con quien quiero). En 2013, elle a publié Cativa en su lughar/Casa pechada (ed. Progresele, col. diminutos salvamentos, Madrid), en 2015 tra(n)shumancias (ed. La Palma, col. eme, Madrid). CO CO CO U (traduction: Ángela Segovia, dessins: Eduardo Jiwnani) a été publié en 2017 en édition bilingue (galicien-castillan) par les éditions La uÑa RoTa.
Luz Pichel (Alén, Lalín, Pontevedra, 1947) réside alternativement à Madrid, où elle vit depuis 1970, et, pour de courtes périodes de repos, dans son village de Alén. Elle a publié les recueils de poésie El Pájaro mudo (ed. La Palma, 1990), La Marca de los potros (Diputación de Huelva, 2004), Casa Pechada (Fundación Caixa Galicia, 2006), El Pájaro mudo y otros poemas (Universidad Popular José Hierro, 2004) qui inclut une réédition de son premier recueil auquel viennent s’ajouter de nouveaux écrits (Ángulo de la niebla, Cartas de la mujer insomne y Hablo con quien quiero). En 2013, elle a publié Cativa en su lughar/Casa pechada (ed. Progresele, col. diminutos salvamentos, Madrid), en 2015 tra(n)shumancias (ed. La Palma, col. eme, Madrid). CO CO CO U (traduction: Ángela Segovia, dessins: Eduardo Jiwnani) a été publié en 2017 en édition bilingue (galicien-castillan) par les éditions La uÑa RoTa.
[1] Antonio de Nebrija, « La lengua, compañera del Imperio » (« La langue, compagne de l’Empire »), prologue de sa Gramática castellana (Grammaire espagnole), 1492
[2] « Le véritable langage galicien, il ne faut pas le chercher dans les montagnes, au fond de ces ravins broussailleux habités par des gens qui, au lieu de parler, brament dans leur langue naturelle », Manuel Rodríguez Rodríguez, « Declaración Gallega », 1892.
[3] Ce mépris conduit à des décisions académiques qui semblent également graves d’un point de vue purement linguistique : on élimine du galicien standard toute expression dialectale (le galicien est fortement dialectisé, en bonne partie en raison de l’orographie de la Galice), on méprise sa prosodie (son « accent prononcé »), on écarte les traits les plus caractéristiques de sa phonétique, comme le seseo et la gheada. De plus, comme les nouveaux locuteurs de galicien étaient dans la majorité des cas des gens parlant castillan, dans la pratique ils castillanisent la phonétique, la morphosyntaxe, etc., soit par incapacité à adapter leurs habitudes castillanes au galicien, soit pour ne pas passer pour des paysans incultes. Et cette phonétique et cette prosodie « blanchies » sont les modèles brandis par les médias institutionnels, de sorte que (je le dis ironiquement), aujourd’hui, dans les villages, on commence à savoir comment il faut parler. Double diglossie : par rapport au castillan et par rapport au galicien normatif.
[4] Et la raison donnée pour considérer le galicien rural comme du castrapo est que le lexique est fortement contaminé par le castillan. C’est en partie vrai. Mais une langue n’est pas seulement un lexique et les linguistes le savent bien. Dès lors, pourquoi ignorer le fait que la phonétique, la prosodie, les traits phonétiques dialectaux, la place des pronoms, etc. sont bien conservés ? Pas assez élégant pour eux ? Probablement.
[5] « Les personnes qui durant les siècles sombres, au début du XIXe siècle, et bien après encore, ont tenté d’écrire en galicien, avaient à leur disposition une matière première informe, invertébrée, sauvage, une langue conservée durant des années et des années à l’état simplement oral », Mariño Paz, 1998, Historia da lingua galega, p. 448.
[6] La même génération qui, quand j’avais 12 ans, se moquait de nous qui parlions galicien, décidait à présent les règles que devaient suivre les locuteurs pour bien le parler : j’ai longtemps refusé d’écouter cette langue et de l’utiliser. Finalement, désireuse de tourner la page du ressentiment, j’ai lu tout ce que je n’avais pas lu et j’ai écrit Casa pechada. Tout compte fait, le mal n’était pas d’établir une norme standard (que l’on peut même considérer comme utile, si on la tient pour une variante supplémentaire), mais de traiter par le mépris les variantes non normatives.
Remarque : Je dois les citations des notes 2 et 5 à la professeure Montserrat Recalde. Mes remerciements et mon soutien inconditionnel pour le travail qu’elle mène en faveur du monde rural et de sa langue.
Lire le texte en version originale


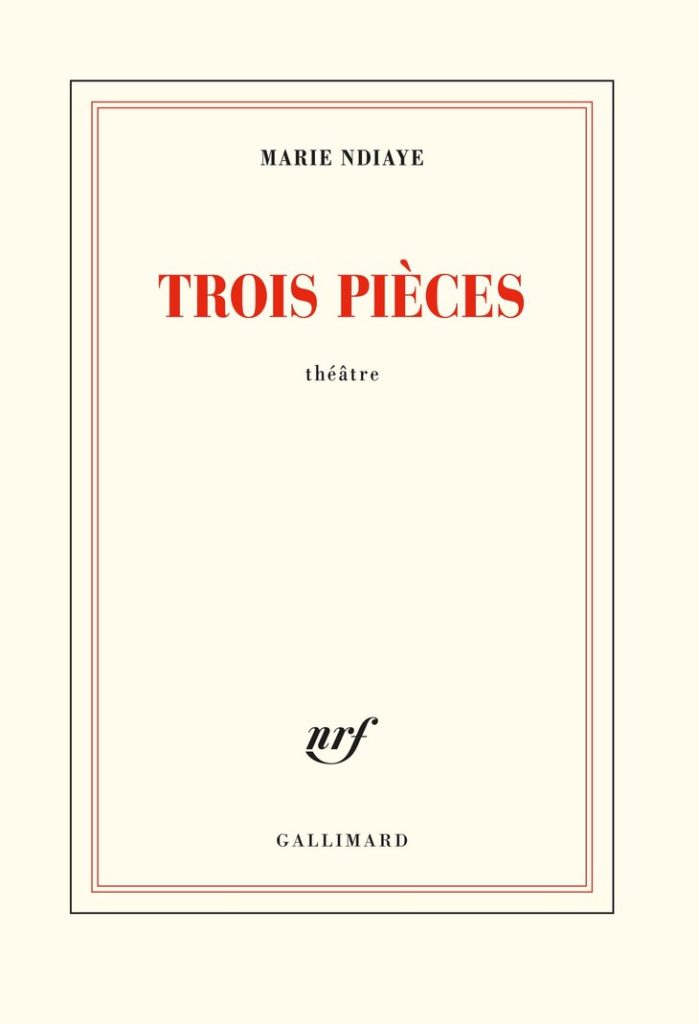





0 commentaires