L’une est une fidèle lectrice d’Alain Robbe-Grillet. L’autre est une lectrice passionnée de Catherine Robbe-Grillet. L’une a intitulé l’une de ses expositions d’après le titre d’un film d’Alain. L’autre a fait de Catherine un personnage important de son roman. Un intérêt commun pour le couple Robbe-Grillet en guise de point de départ d’une discussion foisonnante entre deux curatrices qui pensent l’écriture autant que l’exposition, font un usage jubilatoire de la référence interdisciplinaire, interrogent l’autorité du curateur, la dictature du white cube comme la démocratie dans l’exposition et lèvent un coin de voile sur leurs désirs d’expositions futures.
Lison Noël : Comment avez-vous connu Alain et Catherine Robbe-Grillet et leurs œuvres respectives ?
Arlène Berceliot-Courtin : Le premier roman d’Alain Robbe-Grillet que j’ai lu était La Jalousie [Minuit, 1957]. J’ai essayé de le lire plusieurs fois et j’ai arrêté. Mais ce début de lecture en a engendré d’autres, au hasard de trouvailles dans des librairies ou chez des bouquinistes, qui venait confirmer un désir. Le premier que j’ai lu en entier était Le Miroir qui revient [Minuit, 1985], qui m’a attiré par son titre que je trouve absolument sublime. Je n’ai pas lu son œuvre romanesque dans l’ordre chronologique. C’était davantage par corrélations, par constellations. J’ai ensuite lu les autres romans de la trilogie des Romanesques [Minuit, Angélique ou l’Enchantement, 1988 ; Les Derniers jours de Corinthe, 1994], La Maison de rendez-vous [Minuit, 1965] et Les Gommes [Minuit, 1953]. Il m’en manque encore quelques-uns.
Sinziana Ravini : J’ai toujours admiré le travail d’Alain Robbe-Grillet, mais à la lecture de Catherine Robbe-Grillet, j’ai eu un véritable coup de cœur. J’ai d’abord lu son journal intime, Jeune Mariée : journal, 1957-1962 [Fayard, 2004], puis, j’ai assez vite enchaîné avec les autres, Cérémonies des femmes [Grasset, 1985], L’Image [Minuit, 1956] et Le Petit Carnet perdu [Fayard, 2007]. J’étais aussi passionnée par les mythes qui l’entourent. J’avais une très grande envie d’avoir accès à son monde et de le connaître de l’intérieur. Je voulais absolument rencontrer la femme derrière le mythe. Elle m’a ouvert les portes de son monde. C’est la seule et unique fois que j’ai pu passer au-delà du miroir de l’écrivain. J’ai beaucoup de fascination pour les écrivains qui vivent à d’autres époques, mais je ne pourrais pas côtoyer Joris-Karl Huysmans ou les auteurs de littérature décadente.
ABC : J’ai moi aussi rencontré Catherine Robbe-Grillet à l’occasion de mon exposition double ou double exposition « N a pris les dés » en 2015. Le premier opus était au mois de mai, rue des Panoyaux dans le vingtième arrondissement, avec quatre artistes : Noa Giniger, Nick Oberthaler, Hanna Schwarz et David de Tscharner. Un deuxième opus a eu lieu, sous le même titre, à Air de Paris en juin et juillet, avec des artistes du premier opus, Hanna Schwarz et Noa Giniger, mais aussi Stéphane Dafflon, Seulgi Lee, Camila Oliveira Fairclough et Guy de Cointet. Le titre commun à ces deux expositions était une reprise du film N a pris les dés [1971], que j’ai découvert à la Biennale de Lyon en 2013 et qui est le double de son premier film couleur L’Eden et après [1970], un nouveau montage dont l’ordre des scènes a été joué aux dés.
LN : Comme tu l’expliquais lors de notre précédent entretien, en 2015.
ABC : Oui. Catherine était assez étonnée du choix de ce film, parce qu’il est encore plus confidentiel que L’Eden et après, même s’il intéresse les artistes.
LN : Vous travaillez toutes les deux avec le double. Arlène notamment avec cette exposition double « N a pris les dés » et Sinziana dans ton roman La diagonale du désir, dans lequel tu inventes un double de toi-même, Madame X.
SR : Depuis que j’ai lu Les Élixirs du diable de Theodor Hoffmann [1815], qui a permis à Freud de penser l’inquiétante étrangeté, je suis fascinée par tous les écrivains qui travaillent le double. Cette scission du moi me fascine. Dans mon roman, j’ai inventé un double, que j’ai amené sur le divan. J’ai réussi à convaincre un vrai psychanalyste de recevoir ce personnage fictif en analyse. Madame X partait à la recherche de son désir à travers le désir des femmes. Elle collectionne les muses et leur demande de lui confier des tâches, des missions, qui lui permettent de se soumettre au désir des autres. Comme le disait Lacan, le désir, c’est le désir de l’autre. Que fait-on si on prend cette théorie au pied de la lettre ? Quand l’autre désire à ta place, c’est fantastique, parce qu’ainsi, on peut mettre en échec ou en tout cas piéger son propre inconscient. L’inconscient peut nous amener là où nous ne le voulons pas aller, mais notre inconscient a aussi ses limites. En demandant à l’autre de te donner une tâche qui t’amène hors de toi, on peut vraiment partir à la découverte de cet autre en toi. Ce n’est pas uniquement l’écriture de Catherine qui me passionne, mais toute sa pratique, notamment cérémoniale et rituelle. Ce que j’aime chez elle, c’est qu’elle arrive à construire des scénarios fictifs qu’elle réalise ensuite dans la vraie vie, et vice-versa.
LN : Il y a deux scènes de cérémonies orchestrées par Catherine dans ton roman.
SR : Ou peut-être par son double. Mon double a rencontré son double.
ABC : Son double était lui-même double : Jean de Berg et Jeanne de Berg.
SR : J’ai aussi inventé une exposition double, « The Chessroom » [Atelier Rouart, 2013]. C’était une sorte d’expérience sociale : j’ai amené sept artistes suédois en France et sept artistes français en Suède et j’ai demandé à chaque groupe d’écrire un roman sur la possibilité de l’art de changer le monde. Les artistes suédois ont voulu l’écrire de manière socio-réaliste et être enregistrés pendant sept jours dans un château pour que leurs conversations soient ensuite transcrites. Quand j’ai demandé pourquoi un château, ils et elles m’ont dit que c’était en référence à l’assaut du Palais d’hiver de Saint-Pétersbourg pendant la révolution de 1917. Les artistes français ont voulu travailler de manière individuelle : chacun a voulu écrire un chapitre différent, et dans leur cas, leur point commun était l’écriture docu-fictive.
Chaque artiste a montré deux œuvres, une plutôt utopique, l’autre plutôt dystopique. J’ai ainsi voulu montrer la dialectique entre l’espoir et le désespoir qui est en chacun d’entre nous. J’ai transposé le conflit intérieur qui m’habitait sous forme d’exposition, pour que les artistes y trouvent des solutions. Parmi les Français, il y avait Renzo Martens, qui a réalisé Enjoy Poverty [2008], un film qui a beaucoup divisé le monde de l’art ; Julien Prévieux et ses Lettres de non-motivation [La Découverte, 2007] ; Louise Hervé et Chloé Maillet, qui ont travaillé la dimension imaginaire de toute quête politique. Parmi les Suédois, il y avait des artistes plus activistes, moins intéressés par l’imaginaire que les Français, comme Anna Odell, qui a mis en scène sa psychose pour enquêter sur les hôpitaux psychiatriques suédois qui feraient très peur à Foucault aujourd’hui, parce qu’on est un peu revenu en arrière ; et Dorinel Marc, qui a vécu une année entière habillée en burqa en tenant des discours d’extrême droite. Ces artistes travaillent vraiment le réel. L’une d’entre elles a réussi à annuler le concours Miss Sweden grâce à des actions d’associations féministes. L’exposition était le résultat de ces deux romans parallèles, c’était un jeu d’échecs entre deux façons assez différents de faire de l’art, même si bien-sûr il y avait des artistes activistes, ou « artivistes », parmi les français aussi, comme John Jordan & Isabelle Frémeaux.
Mais Catherine travaille le double mieux que personne. Et au début elle était aussi la doublure ou le double féminin d’Alain.
ABC : Elle porte leurs deux paroles, parce qu’elle transmet la parole d’Alain en plus de la sienne, en dialogue ininterrompu avec lui.
SR : Au début, elle a voulu vivre dans son ombre. Je crois que c’est ce qui l’a rendue aussi mythique. Il a choisi la lumière et elle a choisi l’ombre. Elle a travaillé de manière souterraine pendant qu’il a travaillé de manière un peu plus surterraine. La manière dont ils ont réussi à agencer leurs vies, leurs désirs et leurs fantasmes me fascine.
ABC : Il est vrai qu’elle n’était pas visible en tant qu’auteure, parce qu’elle a choisi immédiatement un pseudonyme.
SR : Dans sa jeunesse, elle a vécu ça comme une liberté, je crois.
LN : Dans ton roman, Sinziana, on trouve une liberté similaire, ainsi qu’une grande jovialité et beaucoup d’humour. Ton double a notamment beaucoup d’autodérision. Chaque récit d’action bute sur quelque chose, le fil est interrompu par un ratage, une maladresse, un détail qui cloche, qui instaure une distance par rapport à la situation, qui dénote une absence d’abandon, par exemple lorsque son bandeau est mal attaché pendant une cérémonie de Jean de Berg.
ABC : C’est un trop-plein de réel.
SR : Elle bute contre le réel, mais son autodérision est aussi une forme de protection. Quelqu’un a utilisé le même terme que toi, « autodérision », et m’a dit qu’il y avait peu d’autodérision chez les femmes dans la littérature française. Il faudrait poser cette question à Catherine : l’humour et l’érotisme sont-ils compatibles ? Je me le demande, parce qu’elle a un humour noir fantastique.
ABC : Il y a une forme de sadisme humoristique chez elle, je pense.
SR : Dans La Cérémonie de Lina Mannheimer [2015], elle humilie les hommes, notamment l’un d’entre eux, qui est sommé de faire la poule, ce qu’elle ne fait jamais avec les femmes.
ABC : Celui qui me fascine le plus parmi ses esclaves hommes, c’est celui qui s’est tatoué son nom au fer.
SR : C’est la dernière grande artiste, au sens royal du terme. Elle s’est créée une cour complètement fascinée par elle. J’ai énormément de tendresse, d’amour et de respect pour elle. Selon moi, il n’y a rien de masochiste dans mon rapport à elle. Ceux qui pensent qu’elle ne fait que fouetter les gens pendant les cérémonies n’ont rien compris.
ABC : Catherine, c’est plutôt La Vénus à la fourrure [Leopold von Sacher-Masoch, 1870], qui a inventé le masochisme, que Sade. Elle n’est pas vraiment sadienne, si ?
SR : Elle ne pratique pas le sadomasochisme dans le sens sadien du terme. Je dirais qu’elle sort du schéma classique. Elle n’a pas la volonté de faire souffrir. Elle en parlait dans un entretien récent : un vrai sadique ne veut jamais le plaisir de l’autre, alors que c’est son cas.
ABC : Il y a un échange, une communication, une complicité.
SR : Je dirais qu’il s’agit d’une forme de communion. Il y a une union des contraires et quelque chose que je n’ai jamais vu chez quelqu’un d’autre : elle arrive à désirer… Non – beau lapsus ! –, elle arrive à deviner les désirs des autres, avant qu’eux-mêmes en soient conscients. Elle met en scène les fantasmes les mieux cachés de chacun. Je ne sais pas comment elle fait. Elle opère comme un psychanalyste qui ferait un X Ray de ton inconscient, avant de passer à l’acte. C’est ce qui est généreux chez elle. Ses cérémonies sont comme des cadeaux inespérés.
ABC : Je pense qu’elle a beaucoup souffert du malentendu colporté sur le fait qu’elle dominerait dans sa vie quotidienne les gens qui lui sont proches ou non, dans une sorte de désorganisation, alors que je pense que c’est beaucoup plus organisé, sous forme de dons, d’offrandes privées. C’est trop intellectualisé ou obscur pour un public non averti. Je pense que le malentendu a commencé avec le contrat de prostitution maritale. L’opinion publique ne comprend pas ce que ça signifie. Une fois que ça a été énoncé comme tel, comme constat, personne n’a retenu le fait qu’elle ne l’a pas signé. Dans leur rapport de force, elle a inversé les choses très rapidement. Elle n’a jamais signé ce fameux contrat marital, parce qu’il y avait une clause de soumission dans l’heure ou la demi-heure, qui imposait une chronicité très contraignante.
SR : Et parce que le fait qu’il lui demande un contrat voudrait dire qu’il n’était pas un véritable maître. Un maître ne demande jamais quelque chose. Un vrai maître n’aurait pas eu besoin de ce contrat. Elle l’aide à être encore plus maître qu’il ne l’était, en refusant de signer ce contrat. Je trouve magnifique cette manière de retourner la relation de pouvoir.
Je pense qu’il y a aussi eu un malentendu autour du phénomène #MeeTo, récemment. À cette occasion, elle a parlé de la servilité des femmes par rapport au discours féministe, qui peut être oppressif, dans le sens où il enjoint toutes les femmes à se libérer de la même façon. J’aime bien cet appel au pluralisme, au fait que chaque femme doive se libérer comme elle le désire et de ne pas juger les fantasmes. Les gens complexes comme elle, créent toujours des malentendus. Par exemple, certains ont peur d’elle parce qu’ils pensent que c’est une femme froide, distante, parce qu’elle a une façade, qui est une manière de protéger son monde et ses secrets, alors que c’est la femme la plus douce et gentille que j’ai rencontrée. Elle est dans la plénitude absolue et le bonheur. Si on peut apprendre quelque chose avec elle, selon moi, c’est d’être heureux et libre.
LN : Alain et Catherine Robbe-Grillet sont loin d’être les deux seuls écrivains et artistes à qui vous vous référez. Arlène, tes textes contiennent beaucoup de références, plus ou moins cachées. Tu joues souvent avec les notes de bas de page en créant une complicité avec le lecteur ou la lectrice.
ABC : C’est un vrai plaisir de considérer le texte comme un espace en soi. C’est presque comme le cinquième mur de l’espace d’exposition, ou le premier du white cube. J’aime bien glisser des clins d’œil, même s’ils sont parfois très appuyés, dans ces espaces, dans ces compositions, qu’ils soient cinématographiques, musicaux ou littéraires. C’est l’idée de créer des passages entre les textes et de jouer sur l’histoire qu’on peut se raconter d’un roman ou d’une analyse. La vraie intertextualité, c’est l’érotisme du texte. C’est ce que dit Roland Barthes : considérer que le lecteur est complice et qu’au moment où il lit ces pages en les dévoilant les unes après les autres, il a déjà lu ça avant et il le lira après, il est dans une certaine condition physique, dans un espace physique, qu’on ne peut pas ignorer. Je pense que c’est ce qui crée des liens. En tout cas, c’est ce que j’aimerais mettre en place. Ces passerelles peuvent aussi être créées avec certaines œuvres, dans le geste de les exposer dans d’autres contextes. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Interexpositionnalité ou quelque chose comme ça ? C’est comme si tu pliais le temps, ça crée des passages. Je crois que l’intertextualité peut se comprendre aussi comme ça.
LN : Ton roman comporte plus de références encore, Sinziana, presque à chaque page.
SR : Oui. C’est peut-être aussi le défaut d’un premier roman : j’ai voulu tout y mettre. Je n’ai pourtant publié qu’un quart de ce que j’ai écrit ! J’avais à la fois la volonté de montrer mon combat intérieur avec mon double, mais aussi d’aller vers l’extérieur et d’embrasser une partie de notre époque. Mais je ne voulais pas faire un roman didactique, même s’il l’est sans doute. Je voulais que ce soit un roman d’initiation. En tant que lectrice, j’adore quand j’apprends des choses, quand un roman m’initie à un savoir que je n’ai pas.
J’aime ça chez Yannick Haenel, par exemple. Il le fait d’une manière vraiment impressionnante, dans Cercle [Gallimard, 2007] ou dans Tiens ferme ta couronne [Gallimard, 2017], parce qu’il utilise chaque œuvre d’art ou cinématographique comme une clef pour ouvrir des portes vers différents mondes. Parfois, il utilise une œuvre d’art pour entrer dans une autre. The Host and the Cloud de Pierre Huygue [2011] a permis ça à ma narratrice, de retrouver un réel qui avait une ressemblance inquiétante avec l’œuvre elle-même. Quand l’héroïne de mon roman arrive à New York la veille de sa conférence sur Pierre Huyghe, elle appuie sur un bouton dans l’ascenseur et les portes s’ouvrent sur une fête assez décadente. Parfois, il faut côtoyer une œuvre d’art jusqu’à ce qu’elle devienne un poison, un poison bienfaisant bien-sûr, car la guérison passe toujours par le mal.
ABC : Un poison doux !
LN : La narration tient une place importante dans vos expositions, au point qu’on pourrait parler d’expositions narratives. Pourquoi ?
ABC : La narration est quelque chose de primordial, d’essentiel a priori et a posteriori de l’exposition, avec l’idée que le narrateur est multiple. L’exposition en tant que telle peut être un narrateur, comme moi en tant que curatrice et auteure de l’exposition, ou les œuvres prises ensemble ou indépendamment. Par exemple, pour la dernière exposition que j’ai présentée à Monte-Carlo, qui s’intitulait « I simply never get lost in the story » [2018], j’avais l’idée qu’à l’instar du Nouveau Roman, dans lequel le véritable personnage est le roman lui-même, le véritable personnage soit l’exposition elle-même.
Le titre de l’exposition est une phrase que j’ai empruntée à Jason Dodge, l’un des artistes. Il y avait trois de ses œuvres dans l’exposition : un coussin intitulé The knife maker is sleeping [2013], qui est une sorte de flottement par rapport à un personnage qui est ensommeillé ou qui a déjà disparu. C’est une sorte de fantôme, parce qu’un coutelier pratique un métier qu’on ne connaît pas bien, qui est incongru. Il y avait une balance ready-made plutôt récente, qui s’intitulait Weight [non daté], avec un jeu de mots sur l’attente. C’est un artiste très attentif aux mots, aux phrases, aux sens et aux traductions, en tant qu’Américain vivant en Allemagne. La dernière œuvre était une chouette taxidermisée. Dans le processus de taxidermie, des pierres précieuses ont été glissées à l’intérieur, ce qu’indique le titre Rubies inside of an Owl. Elle pose la question : le fait de connaître l’histoire de l’œuvre et l’insertion des pierres précieuses change-t-il l’appréhension de cet objet ?
LN : Ce que je me demande, moi, c’est si cette histoire est vraie. L’insertion des pierres précieuses est peut-être une histoire inventée par l’artiste.
ABC : L’œuvre jouait là-dessus. Le titre de l’exposition provient d’un dialogue entre Karl Larsson, un poète suédois, et Jason Dodge, pendant lequel le premier dit que quand il regarde un livre – il ne dit pas quand il lit un livre, donc il est ici considéré comme un objet, avec une dimension intérieure, littéraire, narrative, mais aussi un objet physique –, il est toujours conscient de l’auteur, qu’il appelle narrateur, de ses conditions extérieures et qu’il ne se perd jamais dans l’histoire. Il reste toujours conscient de sa propre histoire et de celle du narrateur. Une sorte de triangulaire se met en place, qui ouvre plus grand le champ des possibles qu’un simple roman. C’est ce qui m’intéressait pour l’exposition, c’est-à-dire détourner un point de vue autoritaire du curateur et de l’œuvre en tant que telle et plutôt proposer diverses pistes de compréhension, de liens.
SR : L’exposition est moins dictatoriale que le roman. Si on compare la littérature avec l’art, mais je trouve que l’art a beaucoup plus renouvelé ses formes que la littérature. En Suède, on a une écrivaine qui s’appelle Lotta Lotass, qui a été membre de l’Académie suédoise — elle l’a quittée maintenant, parce que c’est un tel chaos, c’est comme dans Dix petits nègres d’Agatha Christie, qui disparaissent les uns après les autres. Elle a fait un roman intitulé Den vita jorden [La Terre blanche] qui est culte chez nous, qu’elle avait décomposé de telle sorte que chacun recevait une boîte avec une lecture recomposée au hasard. Aucun lecteur n’a eu la même version de ce roman.
ABC : C’est formidable. Dans une exposition, c’est ce qu’il se passe, je pense, chaque visiteur en voit une version différente.
SR : Dans mes expositions-romans, j’essaie de mettre en place une dialectique entre des trames narratives existantes et leurs multiples continuations possibles. Selon moi, ce qui est important, c’est d’amener le spectateur ou le visiteur dans l’espace d’une manière narrative, pour que l’exposition devienne en elle-même une sorte de roman, qu’on traverse de manière linéaire ou non. J’ai voulu faire des expositions pour rapprocher le monde de l’art et celui de la littérature, mais aussi pour sortir de schémas théoriques très figés qui plaquent une théorie sur le monde de l’art, à laquelle les artistes doivent se soumettre. Je pense que la narration peut plus facilement démocratiser l’espace, dans le sens où il y a un vrai propos, dans lequel tu peux te perdre. Les expositions narratives permettent d’échapper au didactisme de certains milieux du monde de l’art.
ABC : Je pense que notre rôle est de proposer une sélection mentale, intellectuelle, de jeu, de labyrinthe entre les œuvres, en sachant qu’il y a différents angles et différentes ouvertures. Tout n’est pas décrit, tout n’est pas déterminé. C’est une impulsion de départ. Sans notre choix, l’exposition n’existe pas. Mais ce n’est pas pour autant que le spectateur a une unique porte d’entrée et une unique porte de sortie. Faire un choix, émettre un avis, être auteur, c’est pédagogique et ce n’est pas autoritaire. Il n’y a pas besoin de détourner la chose parce qu’on a l’impression que ce premier postulat n’est pas assez ouvert.
SR : Aux États-Unis, il y a une nouvelle vague d’expositions soi-disant démocratiques, dans lesquelles c’est le public qui choisit les œuvres qui vont être exposées. Ce n’est pas toujours réussi. Je suis d’accord avec toi, la démocratie n’est pas compatible avec notre rôle.
ABC : Je pense que l’acte d’organiser une exposition, c’est l’acte de curate, de prendre soin des artistes et des œuvres, mais c’est aussi un geste culturel, qui est un geste de sélection. Il s’agit d’enlever de la matière pour en ajouter plutôt que de remplir l’espace.
SR : J’aime les expositions elliptiques, où ce sont les visiteurs qui deviennent les storytellers, mais j’aime aussi les expositions baroques, car elles sont souvent beaucoup plus généreuses et faciles d’accès.
LN : Vous avez toutes les deux parlé de jeu en évoquant vos expositions.
SR : Oui. Je vois le curateur comme un narrateur qui permet de transformer l’exposition en un jeu de société. C’est encore mieux quand la narration en elle-même est générée par une règle du jeu. Il est important que cette règle soit différente d’une exposition à une autre. Elle peut être choisie de manière collective, comme dans un cadavre exquis, ce que j’ai fait pour « Le Château d’Étain » [2010], mais elle peut aussi changer au fur et à mesure. Dans « The Hidden Mother » [Atelier Rouart, 2012], la règle du jeu était d’amener le regard croisé de ma productrice et de moi-même, pour parler de nos mères et des œuvres qui parlent de la mère, sur un divan, ce qui a engendré un roman. À un moment donné, on a changé la règle : on s’est dit qu’on allait partir à la recherche de nos mères réelles, et nous avons aussi inséré nos rencontres respectives avec nos mères dans le roman.
LN : Vous vous attachez toutes les deux à produire des textes qui accompagnent de très près vos expositions, qui sont bien plus travaillés que de simples textes descriptifs ou pédagogiques. Pour toi Sinziana, ce sont des textes que tu appelles romans et qui précèdent l’exposition. Arlène, à quel moment de la conception de l’exposition tes textes sont-ils écrits ?
ABC : Souvent, ils sont pensés en même temps que la conception, mais la rédaction a lieu quand je sais quelle sera la mise en espace, une fois qu’elle est conceptualisée. C’est un moment clef.
LN : Quel est le statut de ces textes une fois l’exposition terminée ?
SR : Après la fin de l’exposition, mes textes deviennent comme des fantômes de l’exposition, qui commencent à vivre leurs propres vies.
ABC : Je pense qu’il y a une sorte d’interéchange entre les images de l’exposition, qui existe ensuite sous forme de documentation iconographique et le texte, qui se renforcent mutuellement. Je pense qu’en lisant les textes seuls, il y a une petite pression d’image manquante.
SR : En plus des images, j’ai énormément d’archives, par exemple des enregistrements audio : dans The Hidden Mother, le visiteur pouvait faire une analyse à son tour dans l’exposition, s’allonger sur le divan ou prendre la place du psychanalyste et parler librement à partir d’une œuvre d’art qui le touchait. J’ai enregistré ces rencontres où j’ai parfois joué le rôle du psy. J’ai une trentaine de rencontres fantastiques entre les artistes et les visiteurs ou encore des psychanalystes qui se sont allongés sur le divan.
LN : As-tu fait quelque chose de ces enregistrements ?
SR : J’exposerai mes archives plus tard. Ce serait une idée magnifique de faire des post-expositions. Est-ce que ce serait la documentation de l’exposition ? Le catalogue ? Est-ce la réception des visiteurs ? C’est sûrement l’ensemble de tout ça. Les curateurs ne s’occupent en général pas assez de la réception ou de la documentation de leurs expositions. Peut-être parce qu’en tant curateur ou curatrice, on vit un baby blues quand une exposition se termine.
ABC : C’est tout à fait vrai.
LN : Comment documenter la réception des visiteurs ?
SR : Il vaut mieux éviter de donner un formulaire à remplir à la fin : personne n’a envie de dire comment était le service !
ABC : On pourrait faire un appel à témoins a posteriori. En 2015, l’installation d’Hans Haacke à la Biennale de Venise comprenait un questionnaire produisant une analyse sociologique du public. Mais c’était quelque chose d’inhérent à son œuvre et aux travaux d’enquête qu’il mène depuis 1965.
SR : Mon exposition « The Chessroom » se terminait par une œuvre de Margaux Bricler : il y avait deux feuilles différentes, une blanche et une noire. L’une disait « l’art peut changer le monde » et l’autre « l’art ne peut pas changer le monde ». Les visiteurs devaient indiquer où ils en étaient dans leurs croyances. Je trouve qu’il ne devrait pas être si facile de sortir d’une exposition ni d’y entrer. Tout le monde n’aura pas accès à ma prochaine exposition sur La diagonale du désir. Pour ce roman, j’ai vécu une série de rites d’initiation pour avoir accès à différents mondes plus ou moins ludiques ou dangereux et j’ai envie de soumettre les visiteurs à la même expérience que celle que j’ai vécue. J’aimerais bien que les visiteurs soient également mis à l’épreuve, je ne sais pas encore laquelle. On entre et on sort trop facilement d’une exposition. C’est presque pornographique.
ABC : C’est ce qui est agréable !
SR : J’aimerais bien qu’il faille passer un test pour entrer dans ma prochaine exposition, une sorte de rite d’initiation. Et il n’est pas sûr qu’on en sortira !
ABC : Les gens adorent attendre, faire la queue pour une exposition.
LN : Ça crée du désir.
ABC : J’aime bien l’idée que tu évoques, celle d’une dimension pornographique dans le fait d’aller voir une exposition, parce que c’est justement ce qui fait qu’aller voir une exposition est beaucoup moins autoritaire qu’aller voir une pièce de théâtre ou aller au cinéma.
SR : Mais il faut faire attention à ce que le strip-tease ne commence pas avant que le désir de l’autre soit suscité. Si tu commences trop tôt devant un homme, une femme ou un chien… Cela peut vite tourner au ridicule. Le désir dépend du temps.
ABC : Il faut un temps minimum, il faut un effeuillage.
SR : Pour revenir à la documentation, je rêve d’un musée des expositions. Il y a la bibliothèque infinie de Borgès, mais imaginez-vous un musée qui réunirait toutes les expositions de tous les temps, où l’on pourrait voyager à l’infini. Tout serait réuni dans le même espace. Mais cela serait encore plus compliqué que pour les livres, car les expositions nécessitent plus d’espace.
ABC : Et parce que les expositions sont dans un temps unique. C’est une expérience de 15 minutes, 30 minutes, une heure, qui n’est pas la même pour chaque visiteur.
SR : Quand je fais le guide pour raconter l’exposition, ce récit change aussi à chaque fois. Le récit du curateur n’a pas encore été réellement théorisé.
ABC : Non, pas encore. L’expérience de l’exposition est différente aussi quand la lumière est naturelle et qu’à chaque visite, la météorologie est différente. C’est très rare dans les espaces d’exposition. Le white cube a neutralisé l’intérieur.
SR : Le white cube a fait beaucoup de mal. Ce n’est pas pour rien que les artistes Goldin + Senneby associent le white cube à la guillotine, ou en tout cas le musée à la guillotine, parce que le Musée du Louvre arrive avec la Révolution française. Le white cube est une deuxième décapitation du musée. Je crois qu’il faut résister à sa dictature.
ABC : J’ai pratiqué et expérimenté le white cube, notamment en travaillant pendant dix ans dans des galeries d’art contemporain, donc avec des espaces quelque peu différents, mais avec une base commune. C’est mon vocabulaire, mais j’essaie de le diversifier aujourd’hui. Par exemple, l’exposition « I Simply Never Get Lost in the Story » était dans un ancien lavomatique. J’essaie de sortir du white cube pour aller vers d’autres décors. Pour moi, ça reste le décor d’un cinéma provisoire, pas forcément d’un film, mais un lieu de projection provisoire. Les parois étaient blanches, mais la différence avec le white cube est qu’il y avait une entrée cour et une entrée rue. Il y avait un petit labyrinthe, avec deux espaces qui se projetaient l’un dans l’autre, un espace de film entre les deux, une sorte de miroir, et deux sorties. J’aimerais de plus en plus aller vers d’autres lieux : des cinémas, des piscines, des lieux souterrains ou différents. Parmi mes premières expositions, il y avait un cycle pendant un an, en 2013, dans un parking [« And to End », « Blue Monday » et « Everything goes, not anything ». C’était quand même un white cube, avec un sol en béton ciré et des néons, sans fenêtres, mais il fallait un guide pour aller voir les expositions dans un espace coupé de l’extérieur, avec une sorte d’air pressurisé.
LN : Vas-tu continuer l’exploration d’espaces d’expositions différents avec ce lieu mobile que tu as créé, Furiosa ?
ABC : Oui. C’est un nouveau lieu, qui est mobile, itinérant, avec une pierre d’ancrage à Monte-Carlo. Je travaille actuellement avec mon partenaire, Thibault Vanco, sur l’opus numéro 2 et l’opus numéro 3, qui suivront le premier qui était « I simply never get lost in the story ». Ce sera un lieu itinérant, un espace d’exposition mobile dans des lieux qui ne sont pas forcément destinés à projeter ou à organiser des expositions. Il a une dimension cinématographique, parce que son nom, Furiosa, est une référence au giallo, ce style cinématographique provenant d’Italie du nord et particulièrement de Turin. Dario Argento y a filmé plusieurs fois. La ville l’inspire beaucoup, particulièrement la nuit, notamment pour Profondo Rosso, qui a lieu dans une maison bourgeoise sur les hauteurs de Turin. Cette ville serait au cœur de deux triangles magiques : un triangle de magie blanche composé de Lyon, Prague et Turin ; et un triangle de magie noire, composé de San Francisco, Londres et Turin. C’est une ville assez incroyable.
LN : Sinziana, quand tu as exposé au Palais de Tokyo [« Black Moon », 2013], comment as-tu négocié avec l’espace, qui est un white cube ?
ABC : Toutes les parois étaient noires.
SR : Oui. L’exposition était dans le noir, car le noir donne plus facilement l’impression de voyager dans un inconscient. Je pense et j’espère que les expositions vont devenir de plus en plus psychonautiques. Ce qui m’inspire en ce moment, c’est le théâtre immersif, qui est très fort aux États-Unis.
ABC : J’ai l’impression, en effet, qu’on s’éloigne du spectaculaire pour aller vers le panoramique. Les artistes proches de Pierre Huygue dans les années 1990 ont été les premiers à interroger l’exposition comme format, mais aussi comme le temps de l’exposition et le panorama du temps de l’exposition. Un des meilleurs exemples est la dernière exposition monographique de Pierre Huygue au Centre Pompidou [2013-2014].
SR : Ah oui ! J’ai adoré cette exposition. Je pense qu’on n’est qu’au début d’une nouvelle ère où l’espace personnel inconscient et l’espace conscient de l’exposition vont de plus en plus s’approcher l’un de l’autre. Il est important pour moi de garder autant que possible le côté underground et surtout le côté intimiste d’une exposition. De là vient ma volonté de transposer le cabinet de psychanalyse intime sur l’espace extime de l’exposition, pour qu’on reste dans cette intimité. Ce qui me plaisait le plus quand j’ai fait la mise en scène de « The Hidden Mother », c’est que ma productrice et moi nous étions tellement mises à nu dans nos mots et dans nos failles par rapport à nos mères, que les gens qui sont venus voir l’exposition n’ont voulu que parler d’eux-mêmes, de leurs mères, de leurs chats, de leurs amants, de leurs peurs. C’est comme pour les jeux d’enfants : toi d’abord, descends ta culotte avant moi. Si je suis parfois autobiographique, c’est aussi pour que l’autre se dévoile à son tour. C’est qu’à partir de ce moment-là qu’on peut commencer à avoir un véritable échange.
ABC : Est-ce que ça fonctionne ?
SR : Oui, je trouve ! Car dans l’espace d’exposition, c’est toujours l’autre qui prend le relais de cette intimité.
ABC : Cette mise à nu serait comme une sorte de témoin, de passage.
SR : Exactement. Je vais reproduire cette expérimentation dans l’exposition sur La diagonale du désir. Je vais de nouveau amener un divan dans l’exposition et les visiteurs vont de nouveau pouvoir faire une psychanalyse sauvage de trente ou quarante-cinq minutes ou prendre la place du psychanalyste et écouter, poser des questions. La règle du jeu sera de choisir une œuvre qui vous a touchée et de parler à partir de celle-ci, selon les multiples dimensions de Madame X : le côté mystique, le côté érotique, le côté esthétique, le côté philosophique et le côté psychanalytique, de leurs propres vies. Je veux que ces cinq dimensions soient présentes. Ce sera une exposition kinesthésique, où il n’y aura pas que l’art, la littérature et le cinéma, mais aussi la danse, le parfum et une sorte de société secrète, à laquelle on aura plus ou moins accès, en fonction de son degré d’engagement.
LN : En tant que grandes lectrices, quelle importance accordez-vous aux lectures des artistes que vous exposez, à ce que j’appelle la lecture-artiste, c’est-à-dire la manière dont les artistes font usage de leurs lectures ?
ABC : Une grande importance. C’est une question passionnante. Je pense qu’il y a énormément de choses à analyser sur le rapport des artistes aux écrivains.
SR : Il faudrait écrire un grand ouvrage, pourquoi pas une encyclopédie, qui ferait la liste de tous les artistes et de toutes les œuvres qu’on retrouve dans la littérature mondiale et, à l’inverse, de toutes les œuvres littéraires qui apparaissent dans les œuvres d’art. Ça manque.
ABC : Ce qui m’intéresse particulièrement, ce sont les relations de long terme, ou d’œuvres qui s’interpénètrent, d’intertextualité. Quand je conçois une exposition, une des premières discussions avec les artistes porte sur leurs lectures.
SR : Les goûts littéraires d’un artiste me permettent de mieux comprendre une œuvre d’art. Par exemple, j’ai plus de facilité à comprendre une œuvre d’Émilie Pitoiset ou de Pierre Huygue, qui ont été très importants pour La diagonale du désir, en parlant avec eux de leurs goûts littéraires. Chez Pierre Huygue, L’Invention de Morel Bioy Casares est une clef de lecture très importante de son film The Host and the Cloud, par exemple. Chez Émilie, c’est le dramaturge Heiner Müller, qui revisite le personnage shakespearien d’Ophélie et qui le transforme. Elle s’intéresse aux écrivains qui transforment le réel et qui transforment les œuvres des autres en ajoutant des touches qui n’existaient pas dans l’œuvre précédente.
LN : Vous avez toutes les deux exposé Émilie Pitoiset. Elle est aussi une lectrice d’Alain et de Catherine Robbe-Grillet. Elle a collaboré avec cette dernière pour son exposition « Vous arrivez trop tard », sous-titrée « Cérémonie » [Les Églises, Chelles, 2012].
SR : Elle a connu Catherine bien avant moi. Ce que j’ai fait avec Émilie était très inspiré par Catherine et Beverley [la compagne de Catherine Robbe-Grillet] : c’étaient des salons littéraires chez moi. Je recevais des gens et Émilie trouvait des règles du jeu. Parfois, on faisait des performances à deux.
LN : Ophélie est-elle le double d’Émilie dans ton roman ?
SR : Peut-être ! Elle m’a permis de mieux travailler en tant que commissaire d’exposition. Quand je l’ai invitée à faire une performance dans la chambre d’Oscar Wilde, elle m’a dit « non, faisons-la ensemble ». Il y a un vrai va-et-vient entre nous. C’est la relation idéale entre une curatrice et une artiste. On ne pense plus à qui fait quoi, on fait les choses ensemble.
LN : Elle m’a fait la même suggestion quand je l’ai invitée à participer au livre Récits entre amis. Je voulais qu’elle fasse le récit d’une œuvre qu’elle projetait de faire, mais elle m’a proposé autre chose : publier ses notes de préparation de cette œuvre future accompagnées d’un texte que j’ai écrit, qui faisait le récit du récit qu’elle m’avait fait de cette œuvre.
SR : Elle sait bien renverser les rôles ! Elle est très maligne.
ABC : Ça crée un vrai binôme. C’est aussi un moyen de décupler les pistes, de les dédoubler. Je connaissais Émilie depuis très longtemps, mais on a collaboré pour la première fois pour « I simply never get lost in the story ». Elle s’intéresse aussi beaucoup aux pantomimes, à la disparition d’un corps, à l’absence d’un corps, à une sorte d’évaporation. Les œuvres que j’ai présentées dans l’exposition font partie des séries des « Gloves », qui sont des doubles de gants. Ils jouent sur l’ambiguïté, sur le fait que ce soient des doubles de ses propres mains. C’est quelque chose qui est cinématographiquement très fort, évidemment. On pense tout de suite au traitement de l’image, de l’icône, à l’iconographie des mains chez Robert Bresson, à l’érotisme aussi. C’est quelque chose qui est incarné par les œuvres d’Émilie.
SR : Je dirais qu’elle a les deux côtés des Robbe-Grillet. Elle a la froideur et la déconstruction de la narration d’Alain Robbe-Grillet et elle donne des éléments sans donner des récits d’une manière anecdotique. Il n’y a pas de fabula chez Émilie. C’est ce que j’aime le plus, je crois. Elle crée des liens très forts avec les visiteurs qui deviennent des coauteurs de ses fictions. Et il y a aussi ce côté rituel de Catherine Robbe-Grillet, dans son travail sur la gestuelle et la danse, qui est très importante chez elle, la chorégraphie de l’espace.
LN : On pourrait facilement étendre la question de la lecture-artiste aux curateurs. Vous êtes toutes les deux de grandes lectrices et vos lectures contribuent à la conception de vos expositions de manière plus ou moins directe.
ABC : Elles peuvent m’aider à titrer les textes, les temps, le temps, les apparitions d’un programme, d’une exposition. Ce peut aussi être des lectures plus aléatoires, qui ne ressurgissent pas immédiatement. J’ai un rapport assez amoureux aux écrivains, par exemple avec Alain Robbe-Grillet. Quand je commence à les lire, je suis assez fidèle. Un auteur en amène ensuite un autre et encore un autre et encore un autre, mais je ne butine pas. Je travaille beaucoup par rapport à l’iconographie et aux images, donc j’ai plutôt des références cinématographiques, mais la littérature qui précède la mise en image est primordiale.
SR : Plusieurs curateurs et curatrices travaillent avec la littérature. Jean-Yves Jouannais a inventé un personnage littéraire, Félicien Marboeuf, qui faisait des expositions, et il en a fait une exposition lui-même [ »Félicien Marboeuf (1852 – 1924) », Fondation Ricard, 2009]. Il y a aussi toute la génération d’Éric Troncy, qui faisait des expositions littéraires. Aujourd’hui, parmi mes inspirations, il y a Émilie Renard, qui travaille aussi avec la littérature. Le catalogue de son exposition « Les Vagues » [FRAC Pays de la Loire, 2010] était le roman de Virginia Woolf, auquel elle a simplement apposé un tampon indiquant que c’était le catalogue de l’exposition. Ensuite, elle a invité les artistes à produire des œuvres inspirées par ce roman. Elle a aussi inventé un personnage littéraire fictif, Monsieur Miroir, qui tendait un miroir vers les autres [« Monsieur Miroir », Fondation Ricard, 2010]. C’est une très belle métaphore de ce que peut être le curateur. Jean-Max Colard a fait une exposition très belle sur Marguerite Duras, qui avait capté sa mélancolie. [« Duras Song. Portrait d’une écriture », BPI, 2014-2015]. J’aimerais bien que quelqu’un fasse une exposition sur un personnage durassien, pourquoi pas Lol V. Stein ?
ABC : Les personnages féminins de Duras sont toujours le même personnage : Nathalie Granger, c’est Marguerite ; Lol V. Stein, c’est Marguerite ; la mendiante, c’est Marguerite ; Delphine Seyrig, c’est Marguerite ; Bulle Ogier, c’est Marguerite. Jeanne Moreau, c’est Marguerite.
SR : C’est une femme kaléidoscope. Mais Lol V. Stein est un cas psychanalytique fantastique, qui est peut-être plus fort que Dora de Freud. Duras mène l’enquête comme un psychanalyste mais l’enquête ne finit jamais.
ABC : Il y a une forme d’abandon chez elle, un abandon de la situation et une forme d’attraction pour une chute, pour une mélancolie anticipée, qu’elle génère elle-même. Elle est prise de cours. La situation se dérobe sous ses yeux.
SR : C’est une très belle image du curateur : on est fasciné et émerveillé. Et surtout — on perd le contrôle !
ABC : Exposer cette mise en abîme serait magnifique. Duras est très difficile à mettre en exposition ou en images, parce que c’est toujours la même histoire. Elle est uniquement dans la sérialité. Il n’y a pas d’aléatoire. Une autre idée serait d’exposer la fantasmagorie qu’elle a écrite et réécrite d’après son enfance au Cambodge puis au Vietnam. Quand sa biographe Laure Adler s’y est rendue sur ses traces, elle n’a pas trouvé ce que Duras décrit dans ses romans, qui est une fantasmagorie et une fantasmagorie sur la fantasmagorie. C’est quelque chose qui peut être traité dans le cadre d’une exposition, un souvenir, un souvenir sur le souvenir, décupler une image vécue.
Arlène Berceliot-Courtin et Sinziana Ravini
Entretien avec Lison Noël









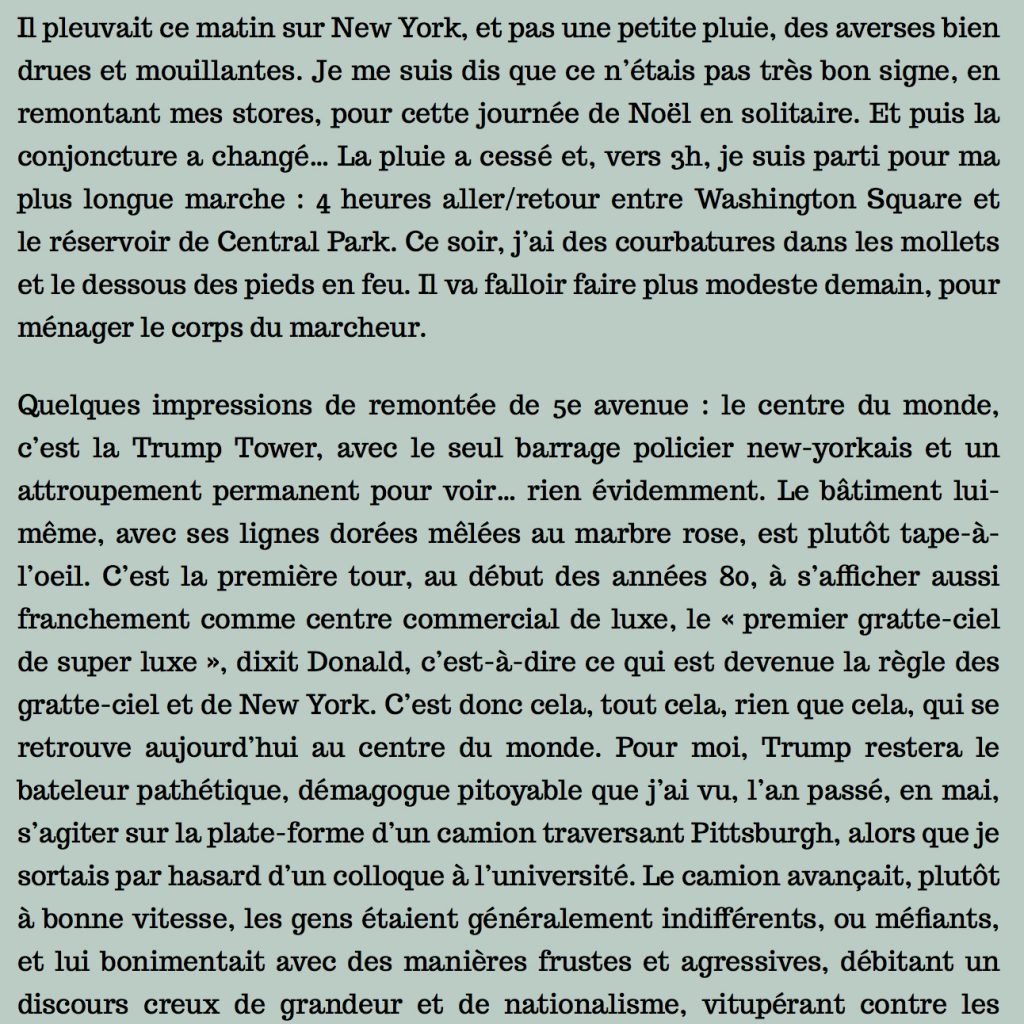


0 commentaires