Gilles Pétel interroge l’actualité avec philosophie. Les semaines passent et les problèmes demeurent. « Le monde n’est qu’une branloire pérenne » notait Montaigne dans les Essais…
Nietzsche publie en 1882 le Gai savoir dont le livre IV s’intitule Saint Janvier. Ce livre compte un grand nombre de textes célèbres qui ont pour dénominateur commun d’affirmer la joie de vivre en toutes circonstances, la joie de vivre malgré tout ce qui s’y oppose comme je le notais dans ma dernière chronique « Una cosa mentale ».
Le premier texte du livre IV, Pour le nouvel an (aphorisme n°276), m’a paru de saison. Nietzsche y fait un rapide bilan des résolutions qu’il a prises pour la nouvelle année. Il ne s’agit pas, le lecteur s’en doute, de ces résolutions badines dont nous abreuvent à satiété nos chaînes de télévision : arrêter de fumer, perdre du poids, aller à la gym trois plutôt que deux fois par semaine, manger moins de viande, boire plus d’eau, protéger la planète, être fidèle en amour, se faire vacciner, aller à la messe, à la mosquée, au temple ou à la synagogue de façon régulière, ne pas se parjurer, se montrer digne, respecter les animaux, la nature ou même le mobilier urbain, être quelqu’un de bien pour reprendre le titre d’une chanson qui eut un temps son heure de gloire.
Non, rien de tout cela dans cet aphorisme. Nietzsche y déclare simplement qu’il « ne veut plus, de ce jour, être jamais qu’un affirmateur » (traduction A. Vialatte). On serait tenté à première lecture, sauf le respect dû à ce grand philosophe, de s’étonner en citant Bobby Lapointe : « Comprenne qui peut, comprenne qui veut« .
Car que signifie être « un affirmateur » ? « C’est, écrit Nietzsche, d’apprendre toujours davantage à voir le beau dans la nécessité des choses […]. Amor fati : que ce soit désormais mon amour. »
Il s’agit en somme d’aimer le monde tel qu’il est et non tel qu’il devrait être, non parce que ce monde serait parfait ou bon ou juste mais parce que ce monde est le seul qui existe. Refuser d’aimer le monde tel qu’il est, violent, injuste, imparfait, c’est refuser d’aimer puisqu’on ne peut aimer que ce qui existe. On peut bien par exemple aimer quelqu’un mais on ne saurait aimer l’humanité parce que celle-ci n’est qu’une idée. Et les idées, si elles peuvent parfois être intéressantes, ne sont jamais en elles-mêmes aimables. Contrairement à ce que Platon ainsi que de nombreux autres philosophes ont pu soutenir, les idées n’ont pas de réalité : ce sont de simples productions de l’esprit, c’est-à-dire des abstractions. Cela ne signifie nullement qu’elles soient sans valeur, mais cela les remet à leur juste place : ce ne sont pas les idées qui mènent le monde ou qui le font. D’une façon qui peut paraître surprenante, Nietzsche n’est pas très éloigné de Marx sur ce point, Marx qui reprochait aux philosophes de n’avoir fait qu’interpréter le monde (voir les Thèses sur Feuerbach), alors qu’il s’agit selon lui de le changer. Point avec lequel Nietzsche se montre en revanche en désaccord. On ne peut, si on lit bien le Gai savoir, espérer améliorer la réalité.
C’est ce qui oppose Nietzsche à la plupart des penseurs du XIXe siècle aussi bien qu’aux opinions dominantes de notre époque. L’idée de progrès est, selon Nietzsche, une idée religieuse puisqu’elle renvoie à la croyance en un monde meilleur. Mais sommes-nous encore capables non seulement de soutenir mais encore de comprendre une telle pensée ? C’est pour le moins douteux. La faute à qui ? Plus probablement la faute à Rousseau qu’à Voltaire.
Toujours dans le même aphorisme, Nietzsche déclare : « Je ne veux pas accuser, même les accusateurs. Je détournerai mon regard, ce sera désormais ma seule négation ! » Là encore, le texte est elliptique et ne précise pas l’identité de ces accusateurs.
Nietzsche pense probablement à ce qu’il appelle ailleurs les forces réactives (notamment dans La Généalogie de la morale). Car si le philosophe allemand n’est jamais tendre avec l’idéalisme, il ne l’est pas davantage avec le conservatisme. Ainsi on voit souvent l’un s’unir à l’autre comme en ce moment au Brésil où une majorité de la population a élu pour président un homme qu’elle présente comme à la fois capable de restaurer les traditions et de promouvoir un Brésil meilleur. L’idéal a parfois des relents de vieilles soupes aigres.
Si nous avons tant de difficultés à comprendre Nietzsche aujourd’hui, c’est sans doute en raison de la victoire des « accusateurs », c’est-à-dire de ces forces réactives qui nous interdisent d’aimer la vie comme elle vient, dans le désordre, avec sa violence, ses passions, son absurdité : « … une approbation sans restriction, l’approbation même de la souffrance, même de la faute, de tout ce que l’existence a de problématique et d’étrange » (Ecce homo, cité par Gilles Deleuze dans son Nietzsche).
Nous avons en effet multiplié depuis plus d’un siècle les instruments de contrôle afin de canaliser, de surveiller, d’endiguer la violence du monde. La paix, « l’amour », le respect universel dont on nous rabat les oreilles ressemblent davantage à un mouroir, à une extinction des forces vives de l’être humain qu’à un progrès vers le meilleur des mondes. J’évoquais plus haut les résolutions pour la nouvelle année que déclinent en chœur les chaînes de télévision. Résolutions en apparence insignifiantes ou badines, en réalité effrayantes tant elles incitent chacun d’entre nous à se conformer à des idéaux tantôt hygiénistes, tantôt bassement moralisateurs, tantôt franchement religieux. Mais nous n’y prêtons guère attention tant nous sommes habitués, dressés à les écouter sans broncher. Si les salles de sport sont souvent les antichambres de la dictature qui a toujours affectionné les corps athlétiques et obéissants (cf. le documentaire tourné par Leni Riefenstahl en 1936 : Les Dieux du stade), les régimes alimentaires sont pour leur part l’avant-garde de la police des mœurs : la diététique est encore une forme de contrôle des corps. Last but not least, nous voici maintenant accusés de « spécisme ». Nous prétendrions à tort être une espèce plus intéressante que les autres. Ainsi, après nous avoir soumis à un ordre de plus en plus policier, il faudrait désormais nous soumettre à la nature. Il s’agit en somme toujours de rentrer dans le rang. La liberté, le désordre, le génie humains sont aujourd’hui considérés comme mauvais. Bientôt nos désirs seront ravalés au rang de l’instinct. Or qu’y a-t-il de plus mécanique, de plus facile à dresser que l’instinct comme le montre l’exemple de ces chiens de garde dressés à l’attaque ? Et y a-t-il quelque chose de moins obéissant que le désir ?
Puisqu’il faut pour conclure prendre quelques résolutions, c’est de ne pas céder cette année au vent mauvais qui souffle fort et tenter de résister à ces forces réactives qui plus que jamais nous empêchent de comprendre ce que signifie être « un affirmateur ». Si le monde ne peut guère progresser, s’il n’existe pas de monde meilleur, il lui est toujours possible en revanche de régresser. Et le pire hélas est peut-être devant nous.
Gilles Pétel
La branloire pérenne






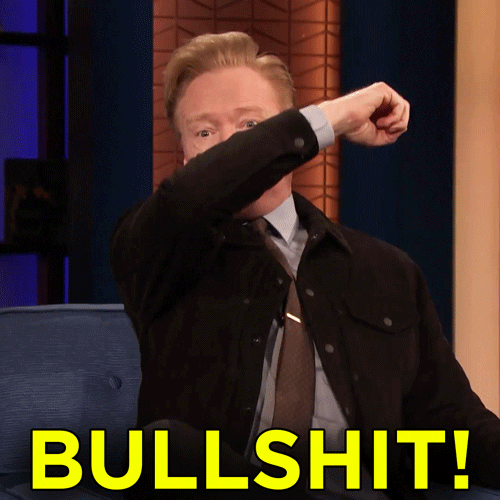
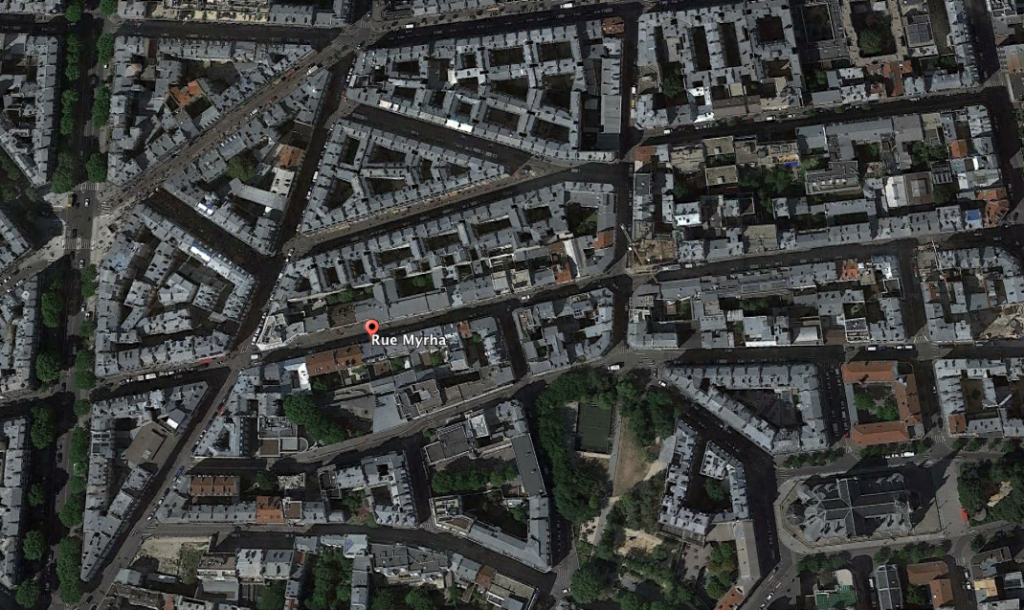

0 commentaires