Dans tous les arts, sous des formes diverses, se pose la question de l’empathie. Autrement dit, comment un auteur, un metteur en scène, un cinéaste, un plasticien, voire un musicien doit-il considérer son objet d’étude ou son sujet d’expression ? La réponse à cette question est, pour moi, déterminante dans l’effet produit sur le spectateur / lecteur / regardeur. Quelques exemples dans l’actualité nous donneront un éclairage sur cette si singulière triangulation artiste-œuvre-public.
Dans Bella Figura, Yasmina Reza s’empare du mélodrame bourgeois tout autant que du vaudeville, en racontant la longue soirée d’un couple adultère qui tombe nez à nez sur le parking d’un restaurant avec la meilleure amie de la femme du mari infidèle, celle-ci étant accompagnée par son propre mari et sa belle-mère. Si, à la lecture du texte, on appréciait déjà la façon dont l’auteur se joue des clichés pour proposer un véritable parcours dramaturgique à ses personnages, Thomas Ostermeier – qui a créé cette pièce – ne fait pas l’impasse sur les situations comiques, pour mieux accentuer la terrible solitude de chaque membre du quintet. Peu tendre avec les deux personnages masculins, Reza propose trois figures de femmes très dissemblables mais qui ont toutes en commun de voir leurs certitudes évoluer au cours de la représentation. Balayant les a priori, Reza ne juge pas, et le metteur en scène allemand suit en cela fidèlement l’auteur, portant sur chacune un regard bienveillant, permettant aux comédiennes de proposer d’infimes variations, de scène en scène, pour les mener vers une conscience plus grande de leur condition. Nulle consolation, ici, mais une empathie qui permet la catharsis.
Dans The other side, le documentariste italien Roberto Minervini est allé à la rencontre de ceux que l’on regroupe sous le nom de white crash, ce lumpen prolétariat blanc du Sud des États-Unis. D’abord centré sur Lisa et Mark, un couple de junkies passionnément amoureux, le film se déporte dans son dernier tiers en suivant les entraînements d’un groupe de paramilitaires soucieux de faire face à toutes les menaces qui pourraient mettre à mal leur mode de vie. Pour autant, Minervini permet à Lisa et Mark d’accéder à la même humanité que ces hommes surarmés, en étant à leurs côtés, sans nécessairement être de leur côté. Ce film nous permet d’accéder à la vérité d’une partie de la population qui se sent, pour partie à très juste titre, oubliée de tous. Ce faisant, il nous permet de réviser là encore un avis généralement trop prompt sur ces deux types très différents de marginaux, en les donnant à voir dans toute leur complexité, et révèle in fine un même souci de l’autre, une volonté de care – pour reprendre ce mot anglais dans sa juste acception – de soin, pour utiliser le mot français qui s’en rapproche le plus, sans toutefois le recouvrir totalement. Le film de Roberto Minervini invente une nouvelle approche du réel par sa forme, et se place en héritier du cinéma direct, en ceci qu’il ne juge pas les gens qu’il filme. Il place ceux qu’il filme dans notre humanité.
Henri Raczymow vient de consacrer un livre à une figure majeure et méconnue de l’histoire intellectuelle du XXe siècle, sous le titre Mélancolie d’Emmanuel Berl. Berl, qui fut l’intime de Proust, Malraux, Gide, Aragon ou Drieu La Rochelle, est un de ces “profils perdus” qui ont marqué leur temps sans laisser d’œuvres marquantes. De fait, hormis Sylvia, roman autobiographique paru en 1952, Berl n’a laissé aucun livre important. Pourtant, son intelligence fascina et séduisit quelques-uns des esprits les plus brillants du siècle dernier, dont il fut un mentor difficile à suivre. Issu de la grande bourgeoisie juive, héros de la Grande Guerre, le pacifiste Berl applaudit les accords de Munich et suivit Pétain à Vichy, où il écrivit deux des discours les plus importants du Maréchal. Il dut ensuite se cacher en Corrèze, une fois les lois anti-juives promulguées. Après-guerre, il ne renia jamais son amitié pour Drieu et d’autres collaborateurs notoires, mais Berl se concentra alors sur son travail littéraire.
Par son essai, Raczymow tente de resituer Berl à sa juste place dans l’histoire des idées de l’entre-deux guerres, et même s’il bute sur la raison de ses amitiés nocives, n’exonérant en rien son sujet d’étude, l’essayiste tente de suivre au mieux la trajectoire changeante de Berl pour dresser le portrait le plus juste qui soit. Ce faisant, Mélancolie d’Emmanuel Berl constitue un essai, ni à charge ni à décharge, fruit du rigoureux travail de Raczimow. Il permet de découvrir un intellectuel dans la tourmente de la première moitié du XXe siècle, et en donne à lire toute sa complexité, sans le juger. L’empathie ne devait pas ici brouiller la rédaction de ce livre, et c’est en cela qu’il est remarquable. Mais Berl n’en est pas à un paradoxe près !
Arnaud Laporte
[print_link]



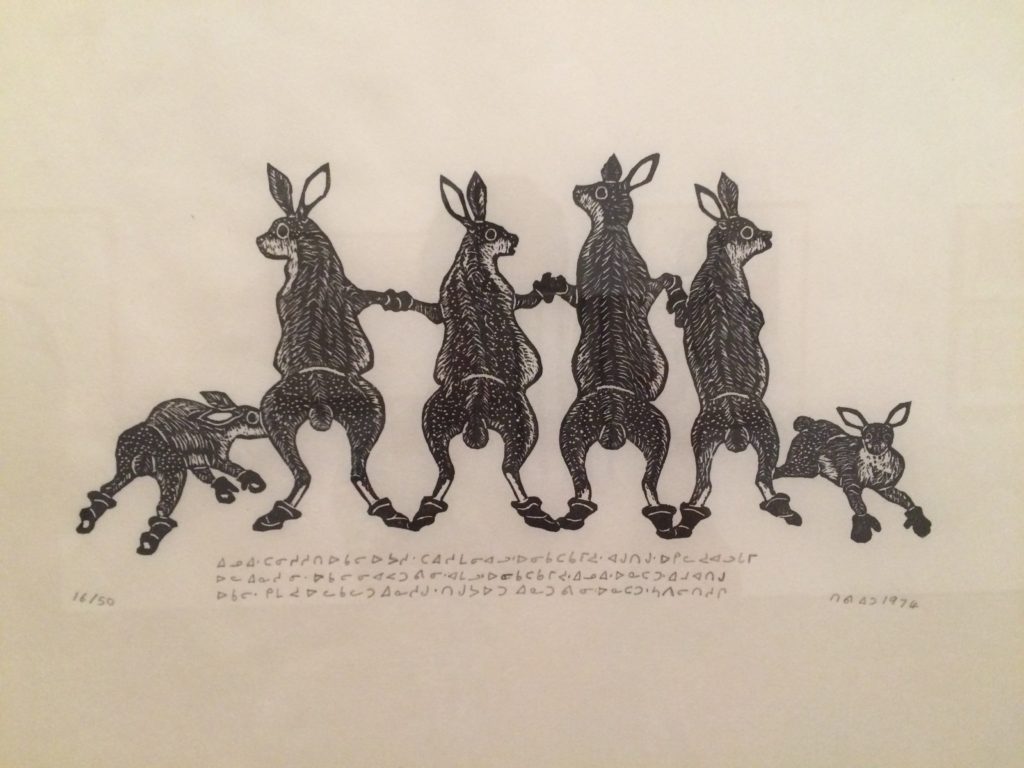





0 commentaires