La forme de ton corps se distingue à peine, faibles vallons entre les creux : l’épaisse couverture te recouvre entièrement. Ton frère et ta sœur sont plus petits : leur tête brune repose sur les oreillers, chacun le sien dans le grand lit. Un rêve traverse la plus jeune qui geint, se retourne. Surgit un pied de bébé, rond, nu, qui frappe légèrement ton épaule, ne te réveille pas
Assise dans l’autre pièce, ta mère boit son café. Première cigarette : la fumée s’échappe par la porte entrouverte du mobilhome. Très mince, en tee-shirt, jupe longue, elle écoute respirer ses enfants dont les prénoms sont tatoués à l’encre noire sur ses bras.
Les réverbères s’éteignent : pénombre. Et, peu à peu, monte du ciel une lumière fauve : celle d’un matin d’automne par temps clair. La circulation s’intensifie derrière la bâche verte tendue sur la grille qui ferme le terrain : les moteurs ronronnent, s’arrêtent au feu rouge puis repartent. Ton père est prêt. Il enfile son blouson, cherche son téléphone, ramasse un peu de monnaie, trouve ses cigarettes, le briquet : ses clés tintent au creux de sa main. Il murmure quelques mots. Ta mère sort avec lui pour ouvrir et refermer la grille quand il disparaît sur son scooter pétaradant. Elle rentre vite, en frissonnant.
Dernière bouffée de tabac, elle écrase le mégot dans le cendrier. Au fond du mug, le café fait un cerne épaissi de sucre. C’est calme, mais c’est l’heure.
Ta mère, penchée sur toi, te parle bas, te secoue doucement. Tu grognes et t’enfouis plus profondément sous la couverture, qu’elle écarte pour te tirer du lit. La toute petite se réveille aussitôt, elle a le sommeil léger quand la vie l’appelle. Ta mère la prend dans ses bras et te demande de t’habiller pendant qu’elle prépare le biberon. Tu râles mais tu t’assois. Ton visage émerge enfin, tes cheveux en bataille : tu bailles à large bouche en te grattant la tête, en te frottant les yeux. Ton frère n’a pas bougé. De sa main libre, ta mère décroche tes vêtements propres qui ont séché au-dessus du réchaud et te les lance. Tu t’habilles vite : l’été est parti. Il faudra bientôt allumer le poêle.
La petite tète son lait et babille dans les bras maternels. Ta mère remplit une grande casserole d’eau froide, qu’elle met à tiédir sur le gaz. Tu t’approches et te serres contre elle, plaques ta joue sur le ventre chaud de ta mère. Ta sœur, qui veut jouer, t’attrape par les cheveux, ça te fait crier et rire. Mais il faut te laver. Ta mère verse un peu d’eau tiède dans une autre casserole que tu emportes dans le cabinet de toilette pour te brosser les dents.
Maintenant, la petite cavale de long en large, tombe et rigole. Il faut encore réveiller ton frère : il n’est pas content. Ta mère lui a trouvé un pantalon neuf qui a encore son étiquette. Elle te demande le prix, tu le lis à haute voix : elle hoche la tête. Ton frère ronchonne quand ta mère l’habille, il veut dormir encore et réclame son lait. Deuxième biberon. Il reste un peu d’eau tiède pour rincer les trois visages et les six mains. Tu grimaces quand ta mère brosse tes cheveux qu’elle tresse avec fermeté. Elle inspecte tes tempes et ta nuque d’un œil averti : elle traque le moindre pou. Tu protestes que tu n’en as pas mais, chaque jour, elle vérifie. Tu n’oublies pas ton cartable rangé dans le placard, puis tu sautes sur la terre battue, hors du mobilhome.
Les petits sont installés, l’un derrière l’autre, dans la poussette à bout de course, garnie de coussins et de couvertures. Ta mère enroule la chaîne, ferme le cadenas de la grille. Vous partez d’un bon pas, ta mère poussant les petits et toi trottinant à côté.
Le temps allonge tes os, ovalise ta figure, te fait pousser les cheveux jusqu’aux fesses même quand ils sont nattés. Sur le chemin, tu bavardes en mâchouillant le pain au chocolat que ta mère veut absolument que tu manges : agacée, tu répètes que tu n’as pas faim. La maîtresse vous dépasse à vélo : vous échangez des bonjours.
Septembre et son incertaine météo, le ciel est grand bleu puis se couvre d’un coup. Devant le lycée, vous longez trois bennes remplies d’objets jetés que ta mère remarque sans rien dire. Elle te montre des plantes qui pendent en haut du parapet dans la rue qui descend : mêlé au feuillage, tu repères des raisins blonds, sauvages. Ta mère dit qu’ils sont mûrs, qu’elle en prendra une grappe sur le retour.
Aux abords des écoles, les enfants affluent. Ta mère salue joyeusement ses connaissances. Des femmes dont certaines portent le hidjab, un boubou, des hommes parlant diverses langues, des grands-parents au pas tranquille, des parents très pressés.
Au bout de l’allée qui monte vers la primaire, se tient le directeur. L’homme annonce d’une voix forte que ça a sonné, qu’il va fermer. L’essaim des derniers arrivés se précipite en riant. Un bisou rapide et tu démarres comme une flèche, ton cartable rose cahotant sur l’épaule.
Ta mère gare la poussette devant la maternelle. Ton frère n’a pas encore l’habitude, il a peur, il n’aime pas. Il pleure, il ne veut pas y aller, il supplie et se débat. Alors, elle laisse la petite courir autour d’elle et serre fort ton frère dans ses bras. La tête haute, d’un pas décidé, ta mère entre dans l’école.
*
Novembre. Je suis allée avec La Grande à la manifestation NousToutes. Si elle a encore du mal à lire, les idées se bousculent dans sa tête, elle est curieuse, repense au passé, analyse le présent et s’interroge. S’il m’arrive d’être pessimiste, de me dire que le processus dans lequel la famille est engagée reste fragile, que les deux ans d’efforts pour régulariser la situation administrative et ouvrir les droits peuvent être réduits à néant en quelques semaines (s’il m’arrivait quoi que ce soit, qui prendrait la suite?), il y a une chose dont je suis certaine : La Grande ne reviendra pas en arrière. Je m’inquiète parfois de la rupture inévitable avec son entourage d’origine, je me demande comment ça se passera quand elle deviendra une jeune femme même si sa mère m’assure qu’il ne sera pas question de la marier trop tôt. Je pense malgré tout la crise inévitable et j’espère me tromper.
Quand nous passons devant la mairie, La Grande me dit qu’elle se rappelle quand ils avaient dormi ici, sur le trottoir. Sur le trajet de la manifestation, nous croisons un homme qui vit sous une tente posée près d’une sortie de métro. La Grande me demande pourquoi il est là. J’explique que, quand on n’a pas de maison, il faut bien dormir quelque part et que certains ont des tentes. La Grande remarque qu’elle aussi a dormi dans la rue sous la tente. Elle n’a rien oublié.
*
Elle est enceinte pour la neuvième fois. Pour moi : vertige abyssal. Mais Elle sourit tranquillement. Ses angoisses cessent, comme si le chaos du monde s’ordonnait soudain et que tout prenait un sens. Elle regarde, émerveillée, son enfant bouger sur l’écran de l’échographiste.
*
On entend vanter, dans les gazettes, la prétendue « résilience » des enfants roms. Comme si, indéfiniment plastiques, ces enfants du fait même de leur origine autre, pouvaient encaisser traumatisme sur traumatisme sans que jamais rien ne les marque vraiment. Nous nous inquiétons pour nos propres enfants dès qu’il leur arrive la moindre broutille et recourons aux services des psychologues à la plus légère inquiétude. De quoi pense-t-on que les enfants roms soient faits, pour que, connaissant dès la naissance la grande pauvreté, parfois l’exil, vivant dans des abris sans confort dont ils sont expulsés souvent et avec brutalité, exclus de tout et partout, héritant des traumatismes de leurs parents et de toutes les générations avant eux, ils puissent grandir sans aucune conséquence ?
*
La chienne s’est échappée. Elle a pratiqué un trou dans la mauvaise clôture entourant le terrain du fond. Lui l’a cherchée, longtemps. Elle reviendra peut-être. Elle était totalement foutraque, obsédée par l’envie de fuir à la moindre occasion. J’imagine la chienne en danger mais enfin libre. Elle est triste, ses enfants aussi : « je lui ai donné à manger tellement de fois ! » Le ventre n’est pas si fidèle.
*
Les allocations, enfin. Je lui annonce la bonne nouvelle, vendredi, alors que je l’accompagne au centre de santé pour son premier examen de suivi de grossesse. D’abord, elle réagit peu : je suis assez déçue mais je m’aperçois que quelque chose lui échappe. Je l’appellerai, Lui, ce soir, pour le lui dire.
Elle me montre ses mains, les petites blessures désagréables qu’elle se fait en explorant les poubelles. Je réponds que c’est fini, qu’elle n’a plus besoin des poubelles, grâce aux allocations. Elle me regarde, incrédule. Je voudrais qu’elle arrête parce que c’est fatiguant, mauvais pour la santé et dangereux la nuit. S’ajoute, le jour, le problème d’être vue par les camarades de l’école des enfants. Mais c’est mon point de vue de gadji. Peut-elle arrêter du jour au lendemain l’activité de chinage qui constitue depuis toujours une partie de son rôle dans la famille ? Une activité qui est celle de toutes les femmes de son entourage ? Et à laquelle s’accroche le mythe de la chasse au trésor ? Il se dit qu’on trouve de l’or dans les poubelles, qui s’évalue au poids. Mais dans les récits de trouvailles faramineuses, ce sont toujours des hommes, les veinards.
Plus tard, alors que nous sommes sorties du centre de santé, Elle repense à ce que je lui ai annoncé, aux allocations. Combien ? Et tous les mois ? Oui, c’est bien ça. Soudain, elle sourit : « alors on a gagné ? » Tu as gagné. Après quinze ans de vie en France et trois années de diverses procédures, tu as finalement arraché à l’administration la reconnaissance de ton droit à exister, ici et maintenant. Victoire, contre l’arbitraire et l’injustice. Revanche aussi, sur les souffrances, sur les traumatismes hérités et vécus du fait d’être née Rom et pauvre. Mais, en ce monde, les victoires sont fragiles comme le bonheur. Tu le sais.
*
Mars/avril 2020. Non, Elle n’a pas gagné. Après deux mois de tranquillité, deux mois à ne plus guetter l’aube avec l’angoisse du ventre creux et des bouches à nourrir, elle a reçu une autre lettre de la CAF 93 : Elle n’a droit à rien. Non seulement les allocations sont supprimées mais elle doit rembourser les montants déjà perçus et se retrouve endettée. Je ne sais lequel des deux agents administratifs, celui qui a ouvert les droits au vu du dossier ou l’autre qui les a retirés au vu du même dossier, se trompe, plongeant la famille dans des difficultés aggravées. Nous avons écrit à la commission de recours amiable. En pleine épidémie de covid-19, le pays fonctionne au ralenti. Il faut attendre. Attendre encore, avec, au lieu de l’aide, une dette, et dans les mains, rien.
J’essaie de visualiser la scène. Un homme, une femme, petite fonctionnaire pas très bien payée mais française, assise devant un ordinateur fourni par l’administration. C’est une technicienne ou un technicien qui tapote sur un clavier. Boulot ingrat, sans doute. Il s’est penché sur le dossier. J’imagine le petit agacement, devant ce qu’elle considère comme une erreur de son ou sa collègue, l’autre qui a accordé les droits : tsitt, tsitt, mais non, Elle n’y a pas droit puisqu’elle est étrangère. Il ou elle tape le courrier qui mettra bon ordre à cette aberration. Suffit de compléter, le nom, le prénom, le numéro d’allocataire. La formule est préremplie « il apparaît que », « vous n’y aviez pas droit », avec l’habitude, ça va vite.
Noire est l’encre de la CAF 93, la privant, elle qui a si peu, des allocations familiales. Encre ordinaire de l’administration française, avec laquelle, il n’y pas si longtemps, une femme, un homme, petit fonctionnaire mal payé sous l’occupation nazie, écrivait à la plume d’acier l’ordre de rafler les gitans de France, et de les déporter en camps d’internement. La même, qui envoie les flics dézinguer les marchés aux puces « sauvages », les pelleteuses détruire les lieux où vivent les Roms pauvres, qui interdit aux enfants l’accès aux écoles, qui refuse la couverture santé. La même encre nette et disciplinée avec laquelle celui ou celle qui occupe un petit rouage dans la grande machine administrative, accomplit sa tâche ingrate en s’abstrayant totalement de la réalité humaine que constitue le dossier qu’elle se dépêche de traiter avant de passer à un autre. L’encre de la banalité du mal.
*
Une aide exceptionnelle de solidarité aidera les ménages les plus modestes. C’est à peu près ce qu’a dit le Président dans son discours du 13 avril. On dit aussi : les plus démunis. Pourrait-il exister des ménages plus modestes que les ménages les plus modestes (de tous les ménages) ? La grammaire du superlatif l’interdit. Il ne peut y avoir de plus modestes que les plus modestes. Selon l’administration française, les ménages les plus modestes ou les plus démunis sont ceux qui « bénéficient » du RSA. En dessous, il n’y a rien. Ou plutôt, il n’y a pas les mots pour le dire. Elle n’a plus d’allocations familiales, ni de RSA. Elle, Lui, La Grande, Le Petit, La Petite, constituent un ménage qui n’existe pas dans la typologie administrative des ménages de France. En-dessous des plus modestes, on sort de la catégorie des ménages, on quitte la commune citoyenneté, la commune humanité, on entre dans le monde de l’infra, dans le monde des déchus de tout droit. Pas d’aide de solidarité exceptionnelle pour ces gens-là puisqu’ils n’existent pas. Combien sont-ils, ces hommes, ces femmes, ces enfants, qui vivent parmi nous mais auquel l’État n’apporte aucune aide ? Auxquels l’État refuse toute aide, préférant subventionner des associations qui distribueront des miettes et les abandonner à la charité variable des bonnes âmes. Ça dépasse l’entendement et le domaine du politique. Peut-on psychanalyser l’État ?
*
Filmée pour un entretien sur le site Hors-Série, l’universitaire française Maboula Soumahoro m’a remonté le moral. Elle vient d’une famille très pauvre, d’origine étrangère. Elle est noire et elle dit avec une fermeté paisible : « On est là et personne ne va repartir. C’est une réalité. Il y a des effacements qui vont devenir de moins en moins aisés. Parce qu’on parle de l’intérieur maintenant et que ça sera de plus en plus difficile de nous remettre à la marge. Ce monde-là (de la domination blanche), c’est fini, et c’est tant mieux. »
Selon le code de la nationalité, La Grande, son frère, sa sœur seront français à l’âge de treize ans. Je ne sais comment, adultes, ils penseront leur passé, les conditions de vie de leur famille quand ils étaient enfants, la manière dont nous avons traité leurs parents parce qu’ils étaient des Roms roumains. Mais nous serons enfin obligés de les voir et de les entendre, il faudra faire avec elles et eux qui agiront et parleront, de l’intérieur.




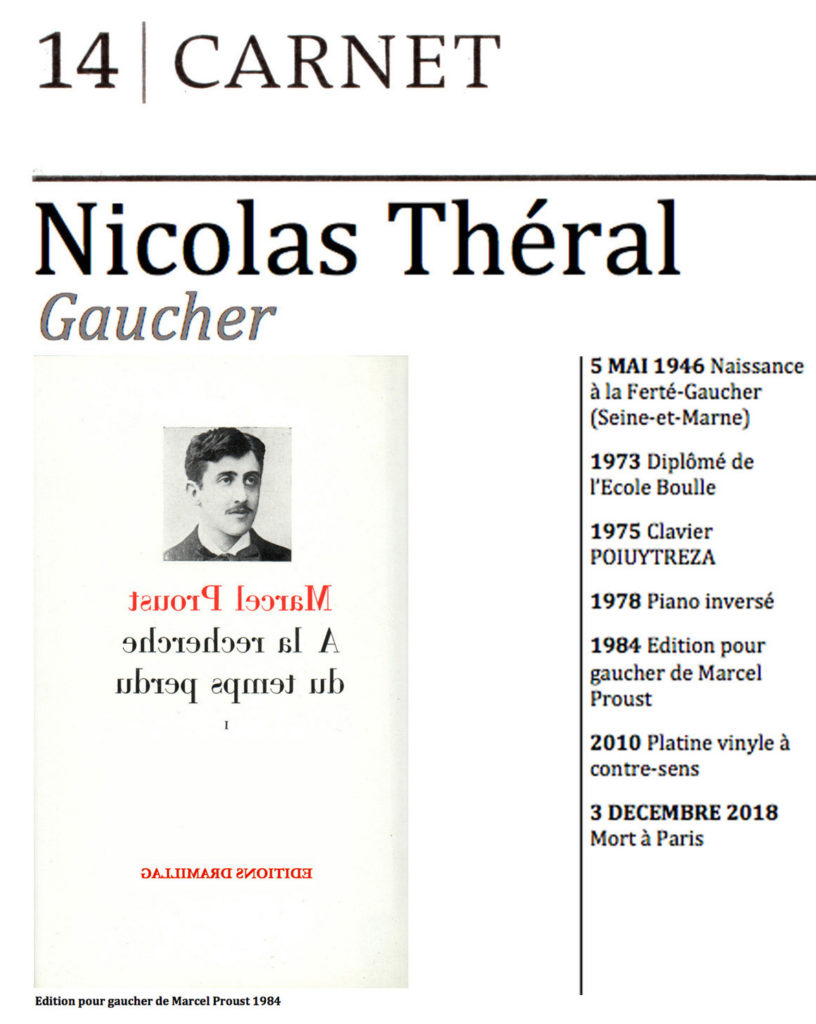




0 commentaires