Machines à voir : un rendez-vous mensuel où les artistes ont recours à la poétique et aux ressources techniques de l’image au format vidéo, version française des Máquinas de visión de la revue Campo de Relámpagos.
The End (1992) de Artavazd Pelechian
(Gyumri, Arménie, 1938)
Fin (1992), du réalisateur Artavazd Pelechian (Gyumri, Arménie, 1938), nous permet une nouvelle fois d’interroger les rapports entre texte et images en mouvement. Dans ce cas précis, le texte se résume au seul mot « fin » qui apparaît à la dernière image et définit à la fois l’œuvre et le moment.
Il s’agit d’un film clair, d’une métaphore évidente sur le temps et la vie, qui joue avec le portrait, avec ce qu’observe quelqu’un qui part en voyage et n’en attend que ce que le voyage peut offrir ; une expérience du temps et du mouvement. C’est un travail achevé, construit sur des images qui s’additionnent pour créer une œuvre chorale et indivisible.
Comme d’autres réalisations de Pelechian, Fin est un poème qui propose une idée du cinéma : une machine qui tourne et projette du temps et de la lumière. Le film propose un mouvement circulaire qui se transforme en fenêtre et en écran, une pratique du montage qui accumule des images et des rythmes, comme des mots et des phrases épars articulés selon le concept de montage à distance créé par le cinéaste arménien*.
Le film évoque aussi par moments d’autres films, il transmet des sensations au travers d’images et de sons où la lumière se dissout puis revient, prise au piège pour mieux s’échapper, telle la marque humide sur une table de verre qui dans Le Miroir de Tarkovski disparaît comme par magie, ou le bruit du train qui nous transporte aux origines du cinéma et de son histoire. La marque qui se déplace au rythme mécanique des roues qui tournent, et accepte pleinement sa condition de road movie.
Le film de Pelechian est un poème avec un début et une fin, mais il a aussi le pouvoir se regarder en boucle et de recommencer, d’aller en avant ou en arrière.
La « fin » devient une promesse – on songe au titre de l’excellent documentaire du Colombien Luis Ospina Tout a commencé par la fin – et en même temps un paradoxe, puisque tout a déjà commencé quand la lumière a jailli et que c’est cette même lumière qui nous éblouit ; quand il y en a trop, alors nous sommes incapables de voir, la lumière nous enveloppe dans un immense vide blanc.
« Fin est-il un film sur la mort ? » demanda Scott MacDonald à Artavazd Pelachian dans un entretien réalisé en 2012 ? Ce à quoi Pelachian répondit : « Non, c’est aussi un film sur la vie. Sur l’homme, le temps, l’éternel et le temporaire ; sur le changement. Avant de terminer, je voudrais préciser quelque chose à propos du montage à distance. Le montage à distance et les effets qu’il suscite sont enveloppants, comme une sphère. Ce n’est pas un montage linéaire mais sphérique. Il est en mouvement perpétuel. Si je trouve le système et que je le construis correctement, il va fonctionner et évoluer dans deux directions ; il ira du début du film jusqu’à la fin et il se créera un effet miroir : il peut aussi aller dans la direction opposée ».
Fin comme un chant d’aller-retour, comme le cinéma, comme un train, comme une année qui recommence quand une autre finit : « Nous connaissons tous le temps. Il est comme une bactérie qui peu à peu nous consume. Je crois que le montage à distance détruit cette bactérie et se rapproche du temps absolu ».
Ángela Bonadies**
Traduit de l’espagnol par René Solis
Machines à voir
* « Le Montage à contrepoint, ou la théorie de la distance », traduit par Barbara Balmer-stutz, revue Trafic n°2, mars 1971/janvier 1972 / éditions POL, 1992.
** Publication originale le 26 décembre 2018 dans la section Máquinas de visión de la revue en ligne Campo de Relámpagos.

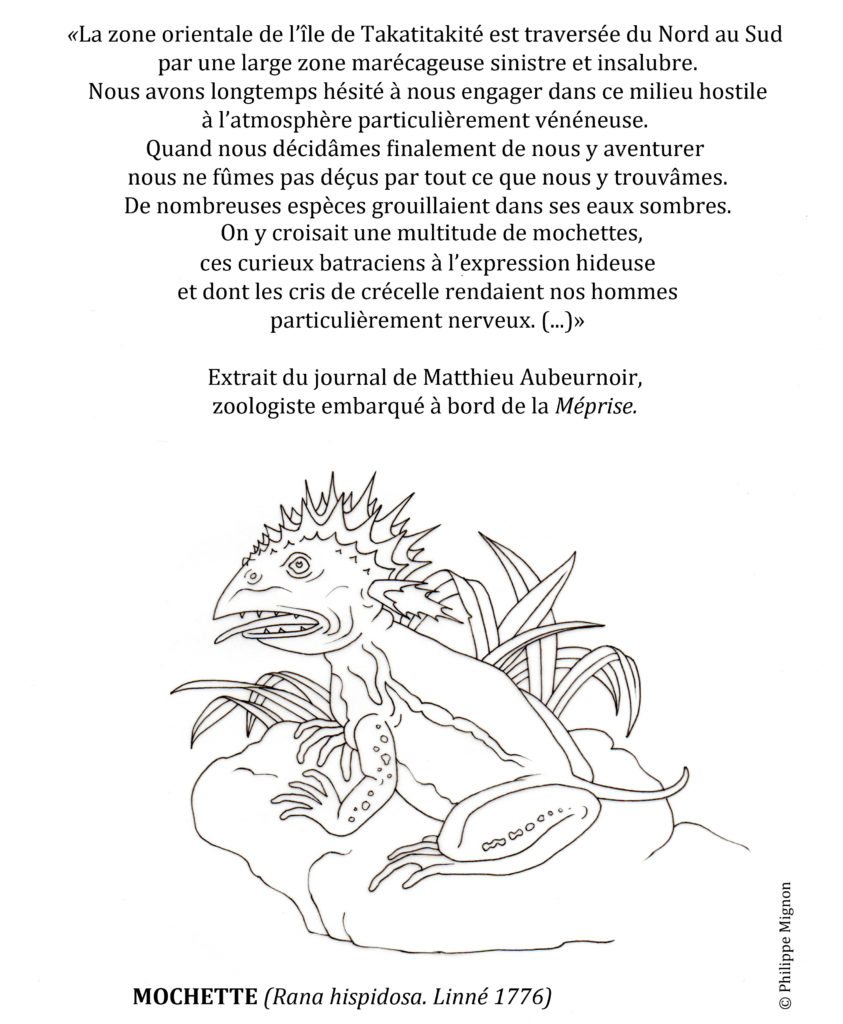






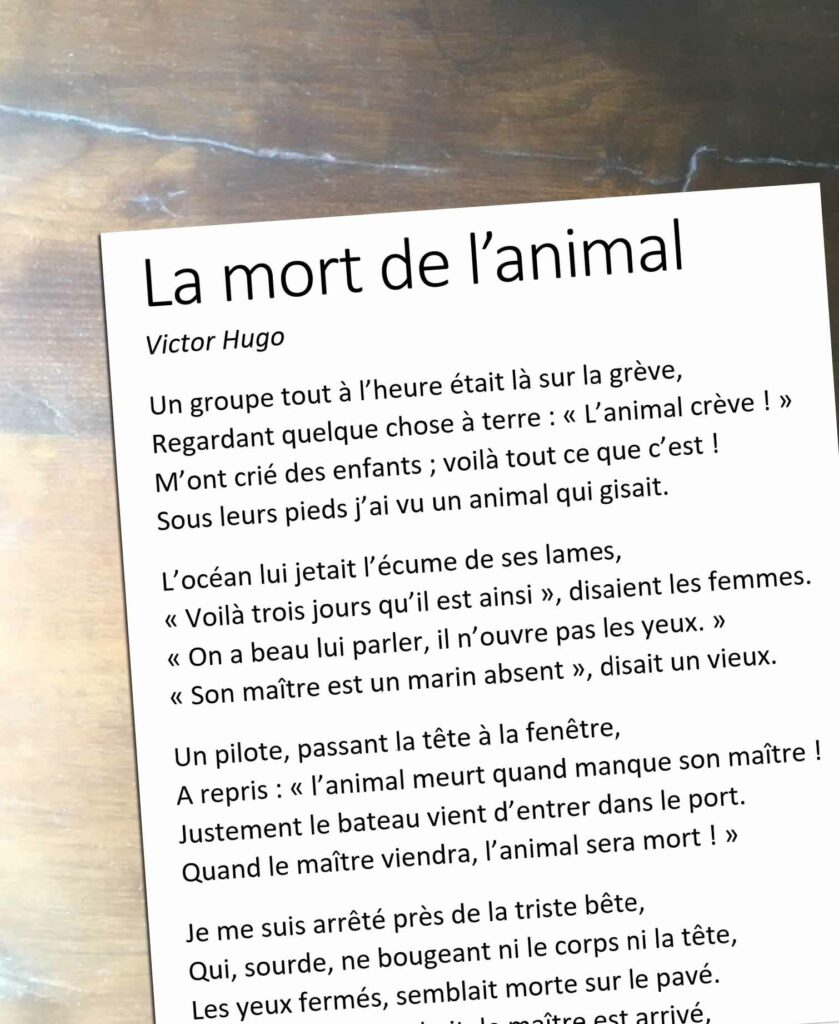
0 commentaires