Il y a quelques années, j’appelais de mes vœux, dans une tribune pour Libération, un « théâtre élargi » où les artistes puiseraient dans le réel les matériaux de leurs créations. J’y évoquais l’émergence de ce que je nommais des écritures de contexte, inscrivant les œuvres dans une écoute sensible des territoires, des situations, des paroles ordinaires. Dans une seconde tribune, parue dans délibéré, je proposais de rêver des maisons de la culture et de la nature, en écho aux pensées de Philippe Descola, pour élargir la conception du champ culturel à celle d’un vivant commun. Ces textes me semblent aujourd’hui trouver une résonance nouvelle dans la crise contemporaine des identités.
Le champ culturel est aujourd’hui pris dans une polarisation brutale, qui ne cesse d’opposer l’élite au populaire, le savant au divertissant, l’institutionnel au spontané. Sous couvert de « parler à tous », certains discours revendiquent une simplification de l’offre, une programmation « de proximité » qui exclut toute complexité, toute altérité esthétique. Derrière ce vernis d’accessibilité, la culture devient instrumentalisée dans une logique identitaire, qui prétend trancher ce qui serait « légitime » pour tel public ou tel territoire.
Cette dérive essentialiste, dangereuse, flatte une vision caricaturale du peuple, conçu non comme une pluralité vivante, mais comme une masse assignée à ses goûts supposés. Le populisme culturel ne crée pas du commun ; il fige des imaginaires. Face à cela, il faut relire Lévi-Strauss, et en particulier La pensée sauvage. Il y propose une alternative à l’obsession identitaire : l’authenticité, non comme folklore ou tradition morte, mais comme qualité de relation. L’authenticité ne se décrète pas depuis un centre ; elle se construit dans la coprésence, dans la reconnaissance mutuelle de personnes réelles vivant ensemble un territoire.
Or, aujourd’hui, une partie des politiques culturelles prétend parler « au nom du peuple » depuis des cénacles hors-sol. Elles fabriquent des dispositifs artificiels qui miment la proximité — plans divers, communautés de substitution ou injonctions à la convivialité — sans jamais laisser émerger l’authenticité vécue, issue d’un processus partagé. L’authenticité devient alors une fiction centralisée, un cache-misère populiste, quand elle devrait être, pour reprendre Lévi-Strauss, une démocratie appliquée à l’échelle locale, c’est-à-dire une culture partagée, tissée dans la durée, entre des personnes en relation réelle.
Heureusement, nombre d’artistes de la scène française et européenne remettent cette question de l’authenticité au cœur de leurs démarches, à travers des formes qui dépassent largement le théâtre documentaire. Je pense à Émilie Rousset, à Yan Duyvendak, à Mohamed El Khatib, aux travaux du Terrain de Boris Charmatz ou du collectif XY. À ces compagnies qui travaillent, dans une attention fine à la qualité de présence, à la réalité du moment partagé, un mouvement de fond porté par des artistes qui explorent un théâtre documentant le réel, où l’authenticité des sources devient constitutive de la création : entre autres, la nouvelle génération de Camille Dagen et Emma Depoid, Eddy D’aranjo, Carine Goron, Lorraine de Sagazan, Simon Capelle et Mélodie Lasselin, Rebecca Chaillon. Ici, la situation réelle et le travail sur le contexte acquièrent une force profondément signifiante. Ces pratiques prolongent l’héritage des happenings et de la performance, en même temps qu’elles interrogent la notion même de scène. Elles font irruption du réel dans l’art sans jamais cesser de fabriquer du symbolique. Elles ne sont pas simplement participatives, mais impliquées. Elles ne sont pas simplement locales, mais situées.
Ce qui traverse la scène contemporaine, c’est une lame de fond : une recherche d’authenticité, qui n’a rien d’une tendance passagère ou d’un effet de génération. Elle pose des questions sensibles : comment créer dans la proximité réelle, comment travailler avec des personnes réelles, comment faire scène à partir d’un rapport juste aux vivants, humains et non-humains. Il ne s’agit plus de choquer, ni même de représenter, mais de rendre possible une relation partagée.
L’authenticité ne peut se décréter depuis Paris ou toute autre abstraction centrale. Elle suppose un ré-ancrage local, une décentralisation réelle, pas simplement administrative mais existentielle. Une décentralisation qui autorise l’émergence de communautés humaines qui ne soient pas assignées à résidence, mais qui puissent se reconnaître mutuellement dans l’échange d’expériences partagées.
C’est là, me semble-t-il, le vrai sens de l’exception culturelle française, lorsqu’elle est bien comprise : non pas un privilège institutionnel, mais une garantie pour que l’authenticité ait une chance d’émerger, face aux tentations de l’uniformisation, de la caricature ou du communautarisme imposé. L’exception culturelle, pour peu qu’elle soit repensée à l’aune des défis écologiques et sociaux, pourrait être le laboratoire d’une révolution douce, où la culture ne serait plus l’ornement des dominations, mais le lieu d’un commun repensé.
Face aux tensions identitaires, aux replis, aux colères qui traversent nos sociétés, il est urgent d’opérer ce déplacement. L’identité, si elle reste figée, tue. L’authenticité, elle, fait circuler. Elle ouvre des possibles. Elle nous oblige à reconsidérer non seulement ce que nous montrons, mais comment, avec qui et pour qui nous faisons culture aujourd’hui.
Dans un monde saturé par les réseaux sociaux, où une fausse authenticité virtuelle est monétisée, mise en scène et vendue à l’industrie culturelle numérique, la nécessité d’une authenticité réelle, décentralisée, incarnée, n’a jamais été aussi forte. Cette pseudo-authenticité algorithmique occupe désormais les imaginaires, impose ses récits et ses figures, et tend à devenir la forme dominante de culture. Face à cette emprise, la seule résistance possible est dans la coprésence, dans des territoires, des pratiques et des gestes partagés, où la médiation humaine prime sur l’exposition permanente.
Dans cette perspective, il faut aussi relire Lévi-Strauss lorsqu’il distingue les sociétés « chaudes » et « froides ». Nos sociétés chaudes, qui produisent beaucoup d’entropie sociale, énergétique et culturelle, ont besoin de toujours plus de normes, de récits et d’institutions pour canaliser le chaos qu’elles génèrent. Face à cela, peut-être faut-il inventer une scène plus « froide » : une scène qui apaise, qui relie, qui permet aux humains de se reconnaître sans s’exclure. Une scène qui ne cherche pas à représenter les identités, mais à les désamorcer par l’écoute, par la présence, par la relation.
Il ne s’agit pas ici de romantiser ces sociétés, mais de reconnaître que nous avons à apprendre d’une certaine sobriété symbolique, d’un rapport moins productiviste au récit et à la culture. Peut-être est-ce là l’horizon d’une scène « froide », où l’art n’est plus dans la surenchère, mais dans l’écoute et l’ajustement à ce qui est là.
Romaric Daurier


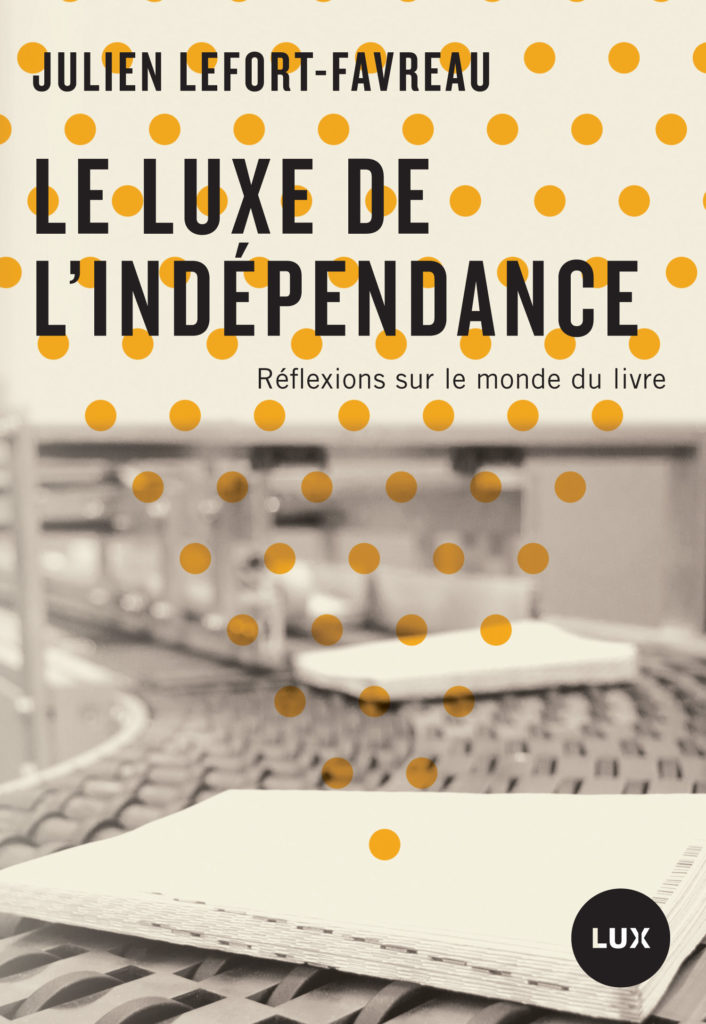

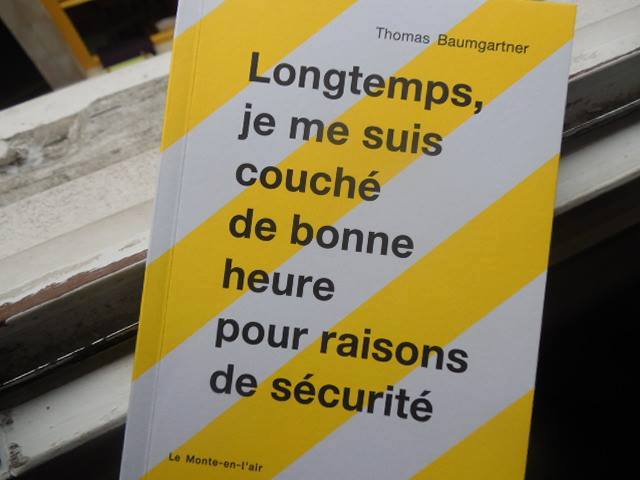
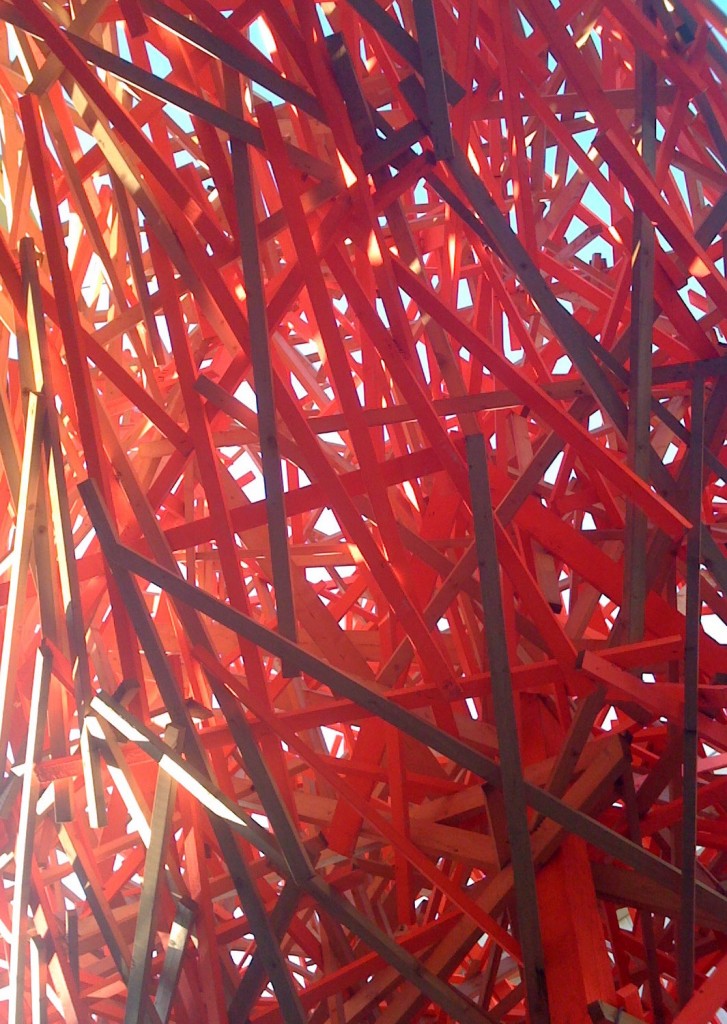




0 commentaires