Le Museum of Modern Art de New York expose l’œuvre de Duchamp intitulée À regarder (l’autre côté du verre) d’un œil, de près, pendant presque une heure (1918) tout près de celle de l’Objet indestructible de Man Ray (1957) dont la version initiale disparue s’intitulait Objet à détruire (1923). Ces artefacts, en apparence totalement différents, sont élaborés sur un ensemble d’attributs parfaitement identiques, ce qui laisse entendre que Man Ray imagina le sien, consciemment ou inconsciemment, à partir de celui de Duchamp.
Duchamp (1918) |
Man Ray (1923 / 1957) |
Mode d’emploi rédigé |
Mode d’emploi rédigé |
L’œil du spectateur
|
L’œil du spectateur
|
Axe vertical, fléau horizontal
|
Balancier vertical
|
Durée de l’expérience :
|
Durée de l’expérience :
|
Pyramide coiffant l’ensemble |
Forme pyramidale du métronome |
Vitre brisée |
Objet à détruire / indestructible |
La trouvaille de Duchamp et sa déclinaison par Man Ray offrent donc deux occurrences de la destruction d’une œuvre consubstantielle à l’œuvre elle-même. Ce ne sont pas les seules. À chaque fois la démarche de l’artiste consiste à sursoir à la destruction définitive, par la recréation de l’œuvre dans le cas de Man Ray, par la conservation sur l’œuvre elle-même des traces de destruction dans le cas de Duchamp. Les vicissitudes qui marquèrent l’œuvre de Man Ray, d’une part – projet de destruction de l’artiste, vandalisme accompli puis recréation de l’objet promu à l’indestructibilité, et celle de Duchamp, d’autre part – destruction accidentelle et affirmation du statut « artistique » des brisures providentielles, rendent visible la plupart des termes nécessaires à la définition de l’œuvre d’art. Définition, ou plutôt identification d’une propriété cardinale de l’objet d’« art ». Voyons cela.
En conservant les fissures de la vitre de À regarder (…) d’un œil…, Duchamp reconnaît la possibilité de la destruction qui menace l’œuvre tout en en figeant le procès. Découvrant les brisures du verre à son retour de Buenos Aires, il perçoit immédiatement l’opportunité que lui offre une liaison entre destruction et création. Man Ray reconnut à son tour la pertinence de la vitre brisée de Duchamp et proposa une variante avec son Objet à détruire. L’intégration « enrichissante » des dommages subis par À regarder (…) d’un œil… et la destruction avérée de l’Objet à détruire puis sa renaissance en Objet indestructible montrent bien l’ambiguïté des choix qui présidaient à la genèse des artefacts des deux artistes. Autrement dit, ces œuvres évoquaient explicitement leur propre destruction, mais Duchamp et Man Ray firent ce qu’il fallait pour les en préserver. Aux aléas destructifs venaient donc s’opposer la volonté des artistes de vouer « pour toujours » ces mêmes artefacts à l’exposition. Ils en vinrent même à les incrémenter d’une nouvelle valeur : l’intrusion anonyme et heureuse des multiples fissures du verre pour Duchamp, la résurrection d’un objet, phénix indestructible, pour Man Ray. Ainsi ces œuvres semblent dialoguer sur leur façon de ne pas disparaître.
L’étroite corrélation des traits qui caractérisent ces deux artefacts montre qu’un principe attaché à la création d’objets singuliers – que sont les « objets d’art » – consiste à abolir la possibilité même de destruction de tels objets. Ce crédo commun consiste à désigner la destruction comme contrepartie latente de leur existence. Autrement dit, d’une œuvre à l’autre, l’ensemble des traits en opposition est placé sous le signe de la destruction à laquelle ces artefacts survivent.
Duchamp se meut dans l’atmosphère dadaïste et new-yorkaise de cette fin de Première Guerre mondiale – irrespirable, selon lui – qui le pousse à s’éloigner à Buenos Aires en 1918. Dans ce contexte social, il conçoit le « bricolage » À regarder (…) d’un œil…, que les brisures involontaires du verre parachèvent, exemple remarquable du « hasard objectif » dont André Breton ne formulera le principe que plus tard. Le hasard, en effet, manifeste l’ignorance générale des lois dont certains événements procèdent. Contrairement aux coups prémédités par Banksy, Duchamp recherchait la contribution du hasard dans son travail. Plusieurs notes de La Boîte verte en font mention : « Du hasard en conserve. / 1914 / […] / Ministère des coïncidences, / Département / (ou mieux) : Régime de la coïncidence / Ministère de la pesanteur »…
Mais encore, la relation dialogique des artefacts de Man Ray et Duchamp se poursuit, un demi-siècle après la création d’Objet indestructible, grâce à l’intervention, littéralement fracassante, d’un troisième interlocuteur. Le 4 janvier 2006, lors d’une exposition au Centre Pompidou consacrée au mouvement dada, un performeur impétueux asséna plusieurs coups de marteau au plus connu des ready-made de Marcel Duchamp : Fontaine, un urinoir renversé portant la signature « R. Mutt » et l’année 1917 de sa création. Cette œuvre a été amplement commentée, notamment pour avoir été refusée lors de la première exposition de la Société des artistes indépendants de New York en 1917, Société dont Duchamp était pourtant membre directeur. Si le vandale de Fontaine fut condamné pour les dommages causés, il était néanmoins en droit de revendiquer, selon certains commentateurs du procès, le statut d’auteur de l’œuvre dérivée du ready-made initial. En effet, l’objet Fontaine portait dès lors les ébréchures comme partie intégrante d’une nouvelle œuvre, si la restauration entreprise par le Centre Pompidou n’était venue les faire disparaître, portant ainsi préjudice à l’auteur, second en titre, et à son droit moral. Après tout, Duchamp lui-même n’avait-il pas agi de la même façon en affublant La Joconde d’une moustache et d’une barbiche dans son L.H.O.O.Q ? Bien que le vandale n’y ait fait aucune allusion dans sa revendication, une coïncidence semble, au moins en partie, lui donner raison : les coups de marteau délibérés sur Fontaine opérèrent comme le hasard le fit sur À regarder (…) d’un œil…, ce dont Duchamp, on s’en souvient, s’était réjoui. Qu’importe alors le caractère fortuit ou intentionnel du choc destructeur, si une trace de la destruction à laquelle l’œuvre a survécu en constitue la dernière touche. Et s’il fallait relever encore l’intervention du hasard objectif, on notera que Fontaine est aujourd’hui connu en trois copies, autorisées par Duchamp, de l’original disparu, quand Objet indestructible est la copie d’Objet à détruire également disparu. Il n’est donc pas nécessaire que le discours de justification du vandale ait un quelconque rapport avec la pertinence de son acte. Qu’il prétendît protester contre la récupération patrimoniale ou marchande des œuvres dada ne contredit en rien la place que son acte vient occuper dans la trame dialogique où se noue la parole des œuvres.
Considérant le dialogue des œuvres évoqué plus haut, un premier élément de réponse semble être que la création d’une œuvre – d’art ou ready-made – conjure la présence pendante de sa destruction. En se débarrassant de toute diaprure, le ready-made met en évidence un principe qui gît au sein de toute œuvre. Parmi les notes de La boîte verte, figure la description suivante sous le titre Possible : « La figuration d’un possible. / (pas comme contraire d’impossible / ni comme relatif à probable / ni comme subordonné à vraisemblable) / Le possible est seulement / un “mordant” physique [genre vitriol] / brûlant toute esthétique ou callistique ». En envisageant le « possible » comme « mordant » physique permettant de brûler au « vitriol » toute idée de Beau en s’en prenant physiquement à l’œuvre elle-même, Duchamp dit à la fois que la destruction du Beau doit avoir une effectivité matérielle et qu’il s’agit néanmoins d’une « figuration du possible », où la destruction est donc elle-même figurée et devient objet de la création. Sous un rapport fondamental, qui se distingue de l’acte destructif délibérément accompli – celui du vandale ou de Banksy, par exemple –, le ready-made interroge l’origine de la destruction. Le contexte de la Première Guerre mondiale explique, en partie sans doute, le fait que Duchamp, de sa résidence new-yorkaise, percevait un monde en cours d’épuisement et de pourrissement. Dans La Boîte verte encore, un exposé laconique mêle analyse et projet créatif en ces termes : « Établir une société dont l’individu ait à payer l’air qu’il respire (compteur d’air) ; emprisonnement et air raréfié, peine en cas de non paiement, simple asphyxie au besoin (couper l’air). […] Les lames de rasoir qui coupent bien et les lames de rasoir qui ne coupent plus. Les premières ont du “coupage” en réserve. – Se servir de ce “coupage” ou “coupaison”. » Évoquant une société où l’air est payant comme une marchandise, Duchamp parle d’un monde à bout de souffle, où les lames de rasoir offrent un service voué à disparaître avec l’usure de l’outil, où l’on ne peut compter que sur une certaine réserve de « coupage » ou d’air, et où il serait possible de « couper l’air » au terme d’une obsolescence irréversible de toute chose. Si l’air est payant parce qu’épuisable, les biens du monde dans leur totalité le sont aussi.
À suivre…
Charles Illouz
Arts plastiques
À lire également : « Banksy vs Marcel : un siècle de retard sur l’art en morceaux (1) »




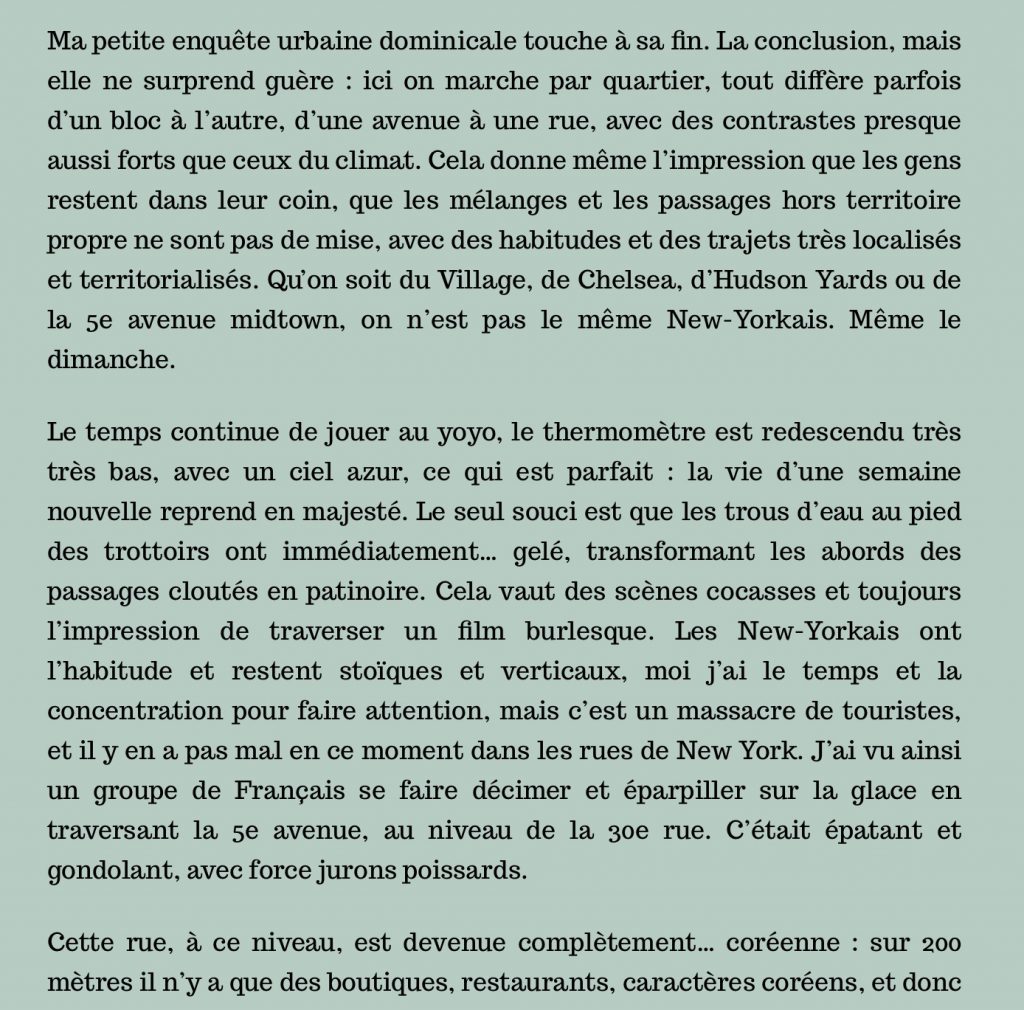


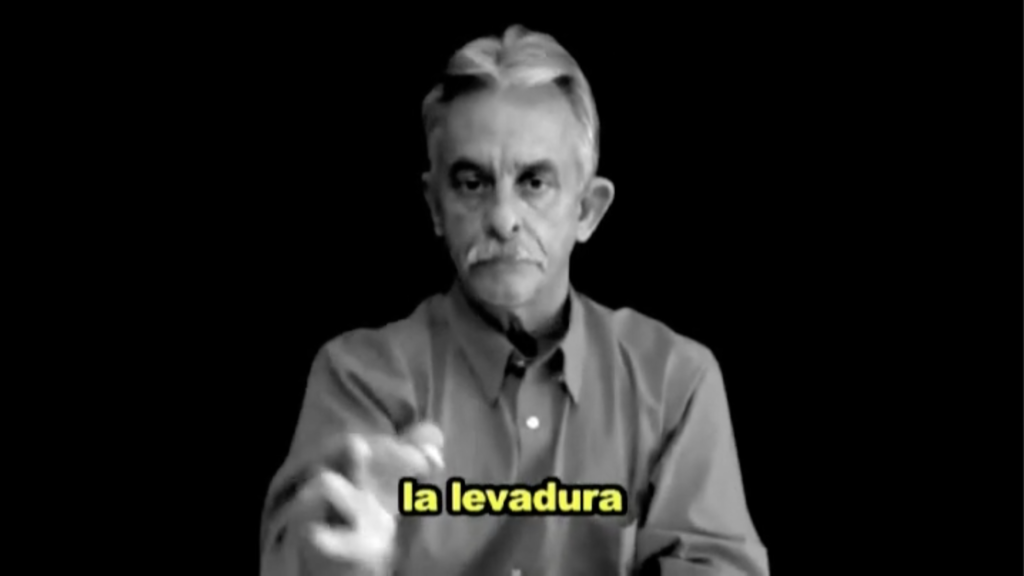


0 commentaires