Du 4 au 7 juin 2019, à l’invitation de la Casa de América, quelques fervents lecteurs du romancier salvadorien Horacio Castellanos Moya étaient réunis à Madrid pour parler de son œuvre…
En 1972, dans un texte intitulé « La conquête de la littérature », l’écrivain américain William Styron se demande pourquoi la guerre du Vietnam a inspiré aussi peu d’œuvres de fiction, et il répond : « Nous nous éloignons peut-être des guerres encore empreintes d’un vestige d’idéalisme, ou, inversement, plus nous nous lançons dans des guerres qui menacent d’être totalement dépravées, plus il est douteux que nous puissions produire des œuvres d’imagination capables d’illustrer à grands traits et de façon plausible les multiples aspects de la nature humaine. » L’Amérique a peut-être cru un peu trop en son destin, au Bien que son histoire incarnait, pour relever par l’imagination ce triste défi. L’œuvre de Horacio Castellanos Moya, née dans le berceau d’une guerre particulièrement sale, au cœur d’un petit pays, y parvient.
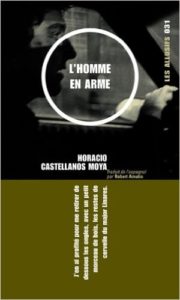 Je l’ai rencontré pour la première fois en 2006, à Paris, pour un long entretien autour d’une ou deux bières. Il venait présenter L’Homme en arme, publié aux éditions canadiennes des Allusifs (traduction de Robert Amutio). Il avait vécu au Canada dans sa jeunesse, au moment où la guerre civile commençait de ravager son pays. En 2006, il enseignait à Pittsburgh, Pennsylvanie. Il vivait seul dans cette ville démocratique où, me dit-il en grimaçant à peine, « les avenues portent librement les noms de ceux à qui tout appartient. » J’ai noté sa discrétion sarcastique, sa mélancolie, comment dire, trapue, cette manière particulière qu’il a d’articuler les mots qu’il prononce en forçant un peu la voix, pour mieux en détacher le comique et la terreur qu’ils révèlent ; et j’ai été frappé par la force qui émanait de cette solitude consentie. Comme certains de ses personnages, Horacio semblait voué à vivre et survivre en explorant, à travers des voix, « les multiples aspects de la nature humaine. » Je me suis senti aussitôt proche de l’homme, comme je l’étais déjà de l’écrivain, de ses personnages travaillés par les guerres civiles d’Amérique centrale, moi qui n’avais jamais mis un pied au Salvador ; de ce rebelle implacable et tranquille ; de ce mercenaire dont l’unique commanditaire est littéraire et la mission, celle de tout écrivain véritable : trouver les formes écrites unissant l’observation, la mémoire et l’imagination. Je n’ai presque jamais senti, à ce point, presque physiquement, la présence et la distance d’un auteur. C’est pourquoi je me permets ici de l’appeler Horacio.
Je l’ai rencontré pour la première fois en 2006, à Paris, pour un long entretien autour d’une ou deux bières. Il venait présenter L’Homme en arme, publié aux éditions canadiennes des Allusifs (traduction de Robert Amutio). Il avait vécu au Canada dans sa jeunesse, au moment où la guerre civile commençait de ravager son pays. En 2006, il enseignait à Pittsburgh, Pennsylvanie. Il vivait seul dans cette ville démocratique où, me dit-il en grimaçant à peine, « les avenues portent librement les noms de ceux à qui tout appartient. » J’ai noté sa discrétion sarcastique, sa mélancolie, comment dire, trapue, cette manière particulière qu’il a d’articuler les mots qu’il prononce en forçant un peu la voix, pour mieux en détacher le comique et la terreur qu’ils révèlent ; et j’ai été frappé par la force qui émanait de cette solitude consentie. Comme certains de ses personnages, Horacio semblait voué à vivre et survivre en explorant, à travers des voix, « les multiples aspects de la nature humaine. » Je me suis senti aussitôt proche de l’homme, comme je l’étais déjà de l’écrivain, de ses personnages travaillés par les guerres civiles d’Amérique centrale, moi qui n’avais jamais mis un pied au Salvador ; de ce rebelle implacable et tranquille ; de ce mercenaire dont l’unique commanditaire est littéraire et la mission, celle de tout écrivain véritable : trouver les formes écrites unissant l’observation, la mémoire et l’imagination. Je n’ai presque jamais senti, à ce point, presque physiquement, la présence et la distance d’un auteur. C’est pourquoi je me permets ici de l’appeler Horacio.
La mère d’Horacio est Hondurienne ; son père, Salvadorien. Horacio a onze ans quand débute et s’achève, en juillet 1969, la fameuse « guerre du Football » opposant les deux pays. C’est une petite guerre hideuse, absurde, entre deux régimes politiques détestables. Un mélange de théâtre bas de gamme et de bagarre sanglante, organisé par des costards au niveau des trottoirs. C’est la phrase de Macbeth : la vie est un conte dit par un idiot, plein de bruit et de fureur, et que ne signifie rien. Cette phrase a donné son titre à un roman de Faulkner, Le bruit et la fureur, et Faulkner, du moins pour moi, est un auteur qui n’est pas si éloigné de Horacio. Dans les deux cas, ce sont en effet des voix qui donnent leur impulsion à la vie. Ce sont les voix de survivants d’une guerre qui ne passe pas, qu’ils n’avalent pas. Une guerre civile, à chaque fois. La guerre de Sécession chez Faulkner, la guerre du Salvador chez Horacio. Si je parle d’abord de la guerre dite du Football, c’est parce qu’elle me paraît, comme dans un opéra, ou plutôt même comme dans une opérette, tenir lieu d’ouverture.
Tout commence quand le Hondurien Roberto Cardona marque un but contre le Salvador, dans un match de qualification pour la coupe du monde de football. Ce match aller, qui a lieu au Honduras, se déroule dans une atmosphère infernale. Les joueurs salvadoriens ont été la veille insultés, menacés, encerclés dans leur hôtel par une foule haineuse qui les a empêchés de dormir. Ils sont arrivés sur le terrain épuisés et paniqués, comme des morts-vivants. Le seul but de la rencontre, celui de Cardona, a lieu à la dernière minute. Après avoir regardé le match, au Salvador, une jeune fille de 18 ans, Amelia Bolanios, se lève, entre dans le bureau de son père, prend le pistolet qu’il avait rangé et se tue. Elle devient aussitôt un symbole de la patrie souffrante et offensée, la vierge du football. Le président du Salvador et le gouvernement entier suivent l’enterrement et le cercueil, telles des veuves respectables ou des putains respectueuses. On est en plein dolorisme patriotique. La cérémonie est retransmise en direct à la télévision.
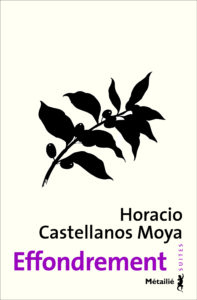 Une semaine plus tard, c’est le match retour à San Salvador. Les Honduriens perdent 3 à 0, mais ils ont eu tellement peur avant et pendant le match, peur d’être lynchés par la foule, que la seule chose importante pour eux était de sortir vivants de cet enfer. Le peuple jetait sur leur hôtel des ordures et des étrons. Plus tard, quelques supporters honduriens sont tués dans les rues. Beaucoup de Honduriens vivant au Salvador avaient préféré sagement ne pas sortir de chez eux. Le Salvador célèbre la victoire. Des personnages imaginés par Horacio vivent cette comédie tragique dans Effondrement (éditions Métailié, traduction d’André Gabastou). Nous lisons les lettres qu’ils échangent d’un pays à l’autre au sein d’une même famille, en voie de désintégration.
Une semaine plus tard, c’est le match retour à San Salvador. Les Honduriens perdent 3 à 0, mais ils ont eu tellement peur avant et pendant le match, peur d’être lynchés par la foule, que la seule chose importante pour eux était de sortir vivants de cet enfer. Le peuple jetait sur leur hôtel des ordures et des étrons. Plus tard, quelques supporters honduriens sont tués dans les rues. Beaucoup de Honduriens vivant au Salvador avaient préféré sagement ne pas sortir de chez eux. Le Salvador célèbre la victoire. Des personnages imaginés par Horacio vivent cette comédie tragique dans Effondrement (éditions Métailié, traduction d’André Gabastou). Nous lisons les lettres qu’ils échangent d’un pays à l’autre au sein d’une même famille, en voie de désintégration.
Le reporter Ryszard Kapuscinski a publié plus tard un livre fameux, né de ses articles, sur la guerre qui a suivi. Il écrit qu’en Amérique Latine, les stades ont deux fonctions : accueillir des matchs et servir de camps de concentration. Les voix de Horacio disent, d’un même mouvement, ces deux fonctions. La littérature commence quand on raconte l’histoire d’Amélia Bolanio, de n’importe quel footballeur poursuivi par une foule qui veut l’exécuter, de n’importe quel démagogue ou de n’importe quel citoyen devenu tueur ou victime, de l’infirmière qui soigne les blessés et qui est tuée par une balle perdue, de n’importe quel général sanglant et décoré, de n’importe quel journaliste exilé, de n’importe quel soldat perdu au cœur d’une guerre sans fin qui a le visage d’un destin. Tous se réunissent au stade, sur le trottoir, dans une impasse, à l’ombre, sur les pages, pour ne plus jamais en sortir. Nous sommes dans l’enfer intime de la politique, dans cet enfer où la politique détruit le plus intime de la conscience et de la vie de chacun, les bons comme les méchants. La littérature de Horacio fait de cet enfer un paradis ; mais uniquement pour le lecteur.
 La guerre du Football a commencé un mois après le match retour. Naturellement, le football était un prétexte. Derrière, il y a des raisons économiques. Le Honduras a décidé d’expulser les 300.000 travailleurs salvadoriens, à la suite d’une réforme économique et agraire. C’est l’origine de cette guerre, et de la future guerre civile au Salvador : comme au Rwanda, un problème non traité, ou mal traité, de terre et de surpopulation. Si tu ne donnes pas du pain aux gens, donne-leur des jeux et des ennemis. Le Salvador réagit et la guerre commença. Avec, accompagnant les morts, son habituel cortège de paroles enflées, gonflées par les intérêts et les passions. Les romans de Horacio plantent des aiguilles dans ces ballons, mais ils le font d’une manière particulière : en revenant à la vie par les voix. En contant la vie des gens, telle que chacun la vit ; ce qu’ils font, disent, pensent. D’où ces voix. Les voix politiques qui se décomposent et se recomposent, comme des cellules, dans et par la vie de chacun. La pauvre et extraordinaire vie de chacun. Extraordinaire, car vue de près et de l’intérieur, comme au microscope et au stéthoscope, la vie est toujours extraordinaire. Son langage est extraordinaire. Son langage est un phénomène. Parfois c’est un langage très bavard, parfois, presque muet. Je préfère les personnages presque muets de Horacio, comme Robocop dans L’Homme en arme ou José Zeledón dans Moronga (éditions Métailié, traduction de René Solis), parce que dans cet enfer ce sont des âmes errantes que résument, dans un silence mortel, leurs actes.
La guerre du Football a commencé un mois après le match retour. Naturellement, le football était un prétexte. Derrière, il y a des raisons économiques. Le Honduras a décidé d’expulser les 300.000 travailleurs salvadoriens, à la suite d’une réforme économique et agraire. C’est l’origine de cette guerre, et de la future guerre civile au Salvador : comme au Rwanda, un problème non traité, ou mal traité, de terre et de surpopulation. Si tu ne donnes pas du pain aux gens, donne-leur des jeux et des ennemis. Le Salvador réagit et la guerre commença. Avec, accompagnant les morts, son habituel cortège de paroles enflées, gonflées par les intérêts et les passions. Les romans de Horacio plantent des aiguilles dans ces ballons, mais ils le font d’une manière particulière : en revenant à la vie par les voix. En contant la vie des gens, telle que chacun la vit ; ce qu’ils font, disent, pensent. D’où ces voix. Les voix politiques qui se décomposent et se recomposent, comme des cellules, dans et par la vie de chacun. La pauvre et extraordinaire vie de chacun. Extraordinaire, car vue de près et de l’intérieur, comme au microscope et au stéthoscope, la vie est toujours extraordinaire. Son langage est extraordinaire. Son langage est un phénomène. Parfois c’est un langage très bavard, parfois, presque muet. Je préfère les personnages presque muets de Horacio, comme Robocop dans L’Homme en arme ou José Zeledón dans Moronga (éditions Métailié, traduction de René Solis), parce que dans cet enfer ce sont des âmes errantes que résument, dans un silence mortel, leurs actes.
La bonne politique est la charge des âmes errantes. Ulysse, son fils Télémaque, doivent s’exiler, se perdre, pour revenir à Ithaque. Ils doivent s’éloigner pour connaître les autres et apprendre à diriger. Leurs longs voyages les préservent de l’aveuglement, de l’enfermement, du narcissisme sourd de la politique. J’ai parfois l’impression que Horacio, exilé comme Ulysse, tantôt au Canada, tantôt en Suède, tantôt aux États-Unis, toujours en voyage, a rencontré sur son chemin, comme le Grec rusé, les âmes des morts qui se plaignent, qui pleurent, qui gémissent, qui réclament, et son travail d’écrivain est de nous permettre de les écouter. Ce ne sont pas les âmes de gens de bien. Elles sont parfois hideuses, criardes, obsessionnelles, paranoïaques. Ce sont souvent les âmes de ceux qui ont organisé ou participé à la guerre civile, qui l’ont animée, qui ont fait que la politique se résume à la violence et à la guerre. Mais ce sont elles qui nous disent ce que fut la guerre, ce qu’est la mémoire de la guerre, comment cette guerre continue à vivre dans les consciences, les corps, les actes de chacun.
Il y a eu, je crois, environ 5000 morts pendant la guerre du Football, ce qui est beaucoup en si peu de jours, mais qui est peu si l’on pense aux 100 000 morts dit-on, difficile de savoir le chiffre exact, provoqués par la guerre civile salvadorienne entre 1979 et 1992.
J’en reviens à la tragique histoire d’Amelia Bolanios. Elle me rappelle deux choses qui, pour moi, sont liées à l’art « ulyssien » de Horacio.
Tout d’abord, deux vers de l’écrivain cubain Virgilio Piñera : « Comment meurt-on au moment/ Où la balle rejoint le rire ? » Les romans de Horacio unissent la balle et le rire, dans un effroi éternel et sarcastique, et si l’esperpento n’avait pas été inventé par Valle Inclán, Horacio aurait pu le faire pour donner vie à ses âmes errantes. Amelia Bolanios n’en fait pas directement partie, mais je veux en faire aujourd’hui le symbole de toutes. Ce qui unit la littérature et la politique, ce qui fait que la langue politique se métamorphose pour devenir une langue vivante et non une langue morte, c’est bien l’intimité de chacun de ceux qui vivent, meurent ou survivent dans cet enfer qu’est l’histoire de l’Amérique centrale, de l’Amérique latine, et, plus précisément, l’histoire du Salvador. L’œuvre romanesque de Horacio est la Comédie Humaine de la guerre civile qui a eu lieu dans ce petit pays lointain, une guerre qui a commencé bien avant 1980 et qui n’a jamais fini. Sa puissance d’imagination des voix et des destins fait que cette guerre nous concerne tous. Balzac dit : « Je fais mieux que l’historien, je suis plus libre. » Et Faulkner enchaîne : « Dans mes fictions, je suis maître de mes personnages et je fais d’eux ce qui me convient. » Ou, ajouterait sans doute Horacio, ce qu’ils veulent que je fasse d’eux. Cette liberté et cette force président au monde qu’il a créé.
Je pense ensuite à un bref poème du Salvadorien Roque Dalton, intitulé « Guerre » : « Mon véritable conflit/ Entre Honduras et Salvador/ a été avec une fille. » Telle est la réalité que nous vivons. On tue ton frère d’une balle au coin de la rue, mais à cet instant tu étais en train de manger des pupusas, ces délicieuses ou dégueulasses petites crêpes fourrées que l’on mange au Salvador, et maintenant le corps de ton frère aura toujours l’odeur et la saveur de ces pupusas, et tu t’en souviendras toujours, et toujours tes paroles vont tourbillonner et tourbillonner et mentir et pleurer autour de ça, et ici même, bien des années plus tard, sur cette flaque de sang d’une bête sacrifiée qu’est la page, Horacio voit et entend non seulement son âme errante, mais aussi la tienne, et, peu à peu, le lecteur découvre peut-être que l’assassin de ton frère, c’est toi même. La guerre civile est comme ça : la politique en armes dans chaque foyer, chaque famille, chaque lit, chaque bouteille de bière tiède ou fraîche, chaque crâne. Et plus généralement : l’événement est comme ça. Il n’existe que quand il existe dans la vie des gens qu’il croise, touche, défait, blesse, tue. Quand il existe concrètement. Et quand, par la suite, cet événement s’entend et s’écoute vivre dedans. Les livres de Horacio font vivre l’événement en révélant les voix de tous ses protagonistes.
 Peu importe si ces voix sont les voix des justes ou des assassins. Laura Rivera, dans La Mort d’Olga María (Les Allusifs), est une femme de la classe supérieure salvadorienne, horrible, vulgaire, inculte, égoïste, cupide et criminelle, mais je dois dire que c’est l’une de mes voix favorites. À chaque fois que j’ouvre le livre, je crois voir une image qui m’avait saisi à la télévision : des femmes chiliennes qui hurlaient et injuriaient l’Angleterre quand Pinochet y fut arrêté. Chaque perle de leurs colliers se mettait à trembler, à vibrer, à suer, à puer, comme de fausses dents jamais lavées. J’ignore dans quel enfer brûle Laura Rivera, mais ce qui est essentiel pour moi, lecteur, c’est que je puisse écouter sa voix, que je la sente vivre et que je puisse sentir, à travers elle, le pouls obscur de la guerre civile, de l’événement.
Peu importe si ces voix sont les voix des justes ou des assassins. Laura Rivera, dans La Mort d’Olga María (Les Allusifs), est une femme de la classe supérieure salvadorienne, horrible, vulgaire, inculte, égoïste, cupide et criminelle, mais je dois dire que c’est l’une de mes voix favorites. À chaque fois que j’ouvre le livre, je crois voir une image qui m’avait saisi à la télévision : des femmes chiliennes qui hurlaient et injuriaient l’Angleterre quand Pinochet y fut arrêté. Chaque perle de leurs colliers se mettait à trembler, à vibrer, à suer, à puer, comme de fausses dents jamais lavées. J’ignore dans quel enfer brûle Laura Rivera, mais ce qui est essentiel pour moi, lecteur, c’est que je puisse écouter sa voix, que je la sente vivre et que je puisse sentir, à travers elle, le pouls obscur de la guerre civile, de l’événement.
Les devins grecs lisaient l’avenir dans les entrailles des animaux sacrifiés. Comme on sait, chacun interprétait de travers la prophétie qui le concernait, ou, plus exactement, l’interprétait de telle façon qu’elle finissait par accomplir le funeste destin auquel il voulait échapper : pas de liberté. Il me semble que Horacio lit le passé dans le sang des morts du Salvador, les laissant parler entre les murs de leurs mémoires noires et fracassées, de ce qu’il nomme la mémoire-tyran. C’est pourquoi ce sont souvent des voix qui monologuent. La guerre civile et ses suites isole les gens. Chaque homme agit, crie ou tait son cri dans sa nuit. Il devient volontiers paranoïaque. En littérature, le paranoïaque a presque toujours raison. Les ennemis sont partout, autour de soi et en soi, et ils donnent forme à presque tout.
En Amérique latine, les voix sont souvent travaillées par la violence politique. C’est ainsi que sont nées les fameux romans de dictature. Dans L’Atelier du roman (Gallimard/Arcades, traduction d’Albert Bensoussan et Daniel Lefort), Mario Vargas Llosa a décrit un processus qui, chez lui, conduit du dégoût à la littérature : «Les dictatures provoquent chez moi une grande répugnance et les dictateurs me sont toujours apparus comme des personnages grotesques. Par ailleurs, elles ont fait tellement de tort, elles ont fait sombrer et ruiné tant de pays. Elles ont été la tragédie de l’Amérique latine et elles ont toutes un aspect grotesque: les mensonges, les raisons qu’elles avancent pour se justifier, la duplicité dans laquelle elles obligent leurs citoyens à vivre, toute l’irréalité qui se crée dans la presse, dans les discours, dans la vie officielle. Tout devient une grande farce. Ce sentiment de répugnance transparaît dans mes romans et s’incarne dans quelques personnages et dans quelques situations. […] Les personnages, au fur et à mesure qu’ils approchent du pouvoir, se mettent à parler d’une façon plus embrouillée et moins cohérente. Il y a comme une pagaille du vocabulaire, de la phrase. Et quand on s’éloigne du pouvoir, la prose redevient plus éloquente, plus transparente.»
Les romans de Horacio ne sont pas des romans de dictature, mais des romans de guerre civile ; et, dans la guerre civile, il n’y pas de transparence et il n’est pas possible de s’éloigner du pouvoir. Ni dans l’espace, ni dans le temps. Le pouvoir rencontre chacun, l’infecte, lui donne la peste, le tue où qu’il soit, dans n’importe quelle impasse. Il le rencontre jusqu’à l’étranger et même, comme les mousquetaires, vingt ans après. Les cendres du pouvoir. L’irradiation du pouvoir dégradé, concentré, répandu par la guerre civile. Ce pouvoir vit dans le plus intime, le plus féroce, le plus tendre, le plus comique, il vit partout et en tout comme il le fait dans les poèmes de celui qui me paraît, comme à d’autres, la torche et le fantôme du grand labyrinthe de Horacio, son compatriote, son aîné, son aimant, son repoussoir, presque son chagrin : le poète et révolutionnaire Roque Dalton, revenu de Cuba au Salvador et exécuté par les guérilleros de son propre camp en 1975. Celui qui fut tué non par la littérature, mais par l’engagement. William Styron avait raison, il n’y a plus de guerre propre.
Je finirai donc par un poème de Roque Dalton, intitulé « L’âme nationale » :
Patrie dispersée : tu tombes
dans mes heures comme une pilule de poison.
Qui es-tu, toi, peuplée de maîtres,
comme la chienne qui contre le même arbre se gratte
et pisse ? Qui a bien pu supporter tes symboles,
tes gestes de jeune fille au parfum d’acajou,
en te sachant brûlée par la bave des crapules ?
Qui n’est pas fatigué de ton imperfection ?
Qui peut encore te rendre hommage ou veiller pour toi ?
Comment t’appeler si, en morceaux,
tu es le hasard à l’agonie dans les flaques ?
Qui es-tu,
sinon ce macaque armé et numéroté,
berger plein de clés et de haine, qui m’illumine la face ?
Ça suffit, ma belle
mère au bois dormant qui empuantit la nuit des prisons :
maintenant, être à l’affût est un devoir qui me ronge.
Il fait du bon fils un déserteur,
du petit paon coquet un pauvre gars mis à nu,
du brave homme un assaillant affamé.
Philippe Lançon
Lire Horacio Castellanos Moya
Semana de autor : Horacio Castellanos Moya, Casa de América, Madrid, du 4 au 7 juin 2019.


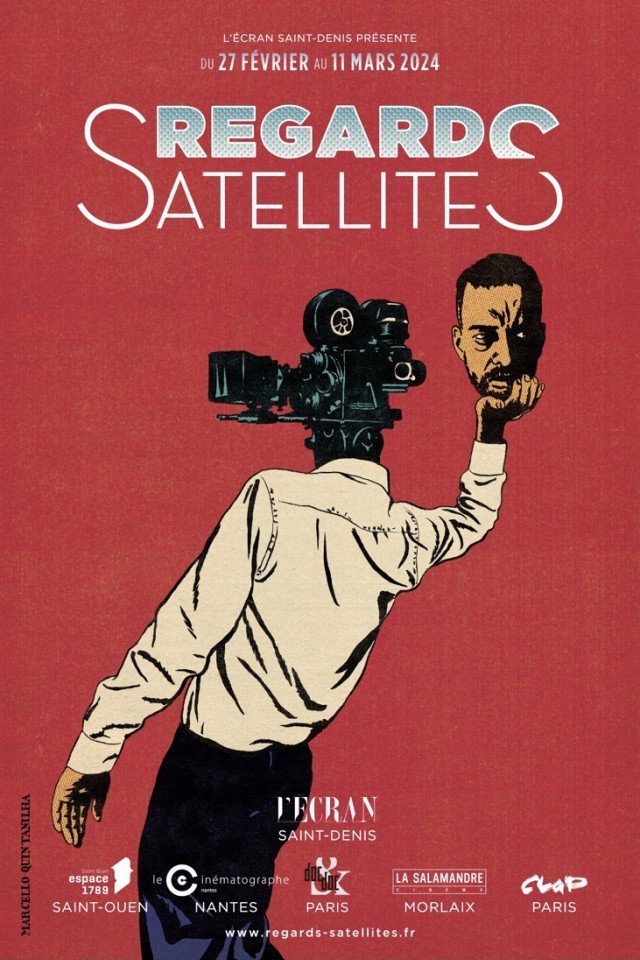






0 commentaires