
Quelqu’un va venir, de Jon Fosse, mise en scène Claude Régy, 1999 © Brigitte Enguérand
« Queeeeel-qu’uuuunnn-vaaaa-ve-niiiiiir »… Dans la salle transformable du théâtre de Nanterre Amandiers, des spectateurs découvrent un nouvel auteur norvégien, traduit pour la première fois en français. Nous sommes le 28 septembre 1999 et Claude Régy met en scène, dans le cadre du festival d’Automne à Paris, Quelqu’un va venir, la première pièce de Jon Fosse, traduite par Terje Sinding pour les éditions de l’Arche.
Décroissance
Étirant chaque syllabe, la comédienne Valérie Dréville et ses deux camarades, Marcial di Fonzo Bo et Yann Boudaud, ralentissent la cadence et ménagent de longues plages muettes dans un texte déjà avare de mots, suscitant dans le public des réactions opposées, tension maximum et fascination, ou rejet, sous la forme de soupirs, bâillements et parfois fous rires. Présent pour la première, l’auteur a le sentiment d’avoir enfin trouvé un metteur en scène qui le comprend, lui qui a longtemps tenu le théâtre à distance et a écrit Quelqu’un va venir sur commande pour boucler des fins de mois.

Le texte ressemble à une partition musicale: des phrases qui se répètent avec d’infimes variations, des silences de diverses durées et des annotations qui indiquent le tempo. Trois personnages: Elle, Lui, L’Homme; une maison de bout du monde sur une falaise au bord de la mer; un refuge impossible pour une histoire d’amour minée par la peur. Et une économie de moyens tout à fait remarquable: pour reprendre une comparaison qui a beaucoup servi, si Shakespeare utilise dans son oeuvre un vocabulaire de 20.000 mots là où Racine n’en a que 2000, Fosse, lui, tournerait plutôt autour de 200. Une décroissance qui n’est pas un appauvrissement: comme ses personnages, la langue de Fosse est en retrait, en grève du brouhaha et de l’agitation du monde.
Références
« Les mots servent à libérer une matière silencieuse qui est bien plus vaste que les mots »: cette phrase que Claude Régy attribuait à Nathalie Sarraute (mais dont il était peut-être bien le co-auteur) illustre parfaitement le propos de Fosse. Si son écriture blanche le place évidemment dans le sillage de Beckett, c’est bien de Sarraute et de Duras que son théâtre est le plus proche. Mais les influences littéraires de Fosse sont d’abord norvégiennes: Knut Hamsun (1859-1952), encombrante – par sa trajectoire politique – figure tutélaire de toute la littérature norvégienne depuis un siècle et demi; Fosse allant même jusqu’à écrire pour le théâtre en 2009 Ylajali, une pièce inspirée de La Faim, le roman mythique de Hamsun.
Et puis aussi et surtout Terjei Vesaas (1897-1970), référence constante dont on retrouve des échos dans toute l’oeuvre, et singulièrement dans Je suis le vent, récit d’un sauvetage – ou d’un naufrage – qui renvoie directement à deux textes de Vesaas, Brume de Dieu et La Barque le soir, tous deux adaptés au théâtre par Claude Régy.
Écoute
Dans sa préface pour le livre de Vincent Rafis, Mémoire et voix des morts dans le théâtre de Jon Fosse, Régy écrivait: « Jon Fosse écoute, dans sa ‘chambre secrète’. Il écoute ‘les fleuves sous terre’ dont parle son grand prédécesseur Tarjei Vesaas. Il écoute la circulation des eaux ensevelies mais toujours remuantes, comme il écouterait, la nuit, le battement de son sang. »
Ce n’est pas Régy qui a mis en scène Je suis le vent, mais Patrice Chéreau, en 2011, deux ans avant sa mort. Dans ce récit d’une noyade – et peut-être d’un sauvetage – Chéreau, qui avait monté précédemment Rêve d’automne du même Fosse, disait voir « un chemin paradoxal vers l’apaisement ».

I am the wind (Je suis le vent), mise en scène de Patrice Chéreau, festival d’Avignon, 2011 © Christophe Raynaud de Lage
Dans un entretien paru dans le magazine Brooklyn Rail en juin 2004, Jon Fosse estimait que « l’une de nos illusions consiste à croire que chaque problème peut être résolu si nous parvenons à bien communiquer. Adorno disait que l’art est le contraire de la communication. Il y a là une part de vérité. Et cette vérité a quelque chose à voir avec la vie. »
Empêcheur de discours, combattant du silence à une époque où la communication fait rage pour brouiller le sens des mots, Jon Fosse, au delà des brumes et du crépuscule où s’inscrit son œuvre, est bien un poète de l’apaisement. Lui attribuer le Nobel n’était pas une mauvaise idée.


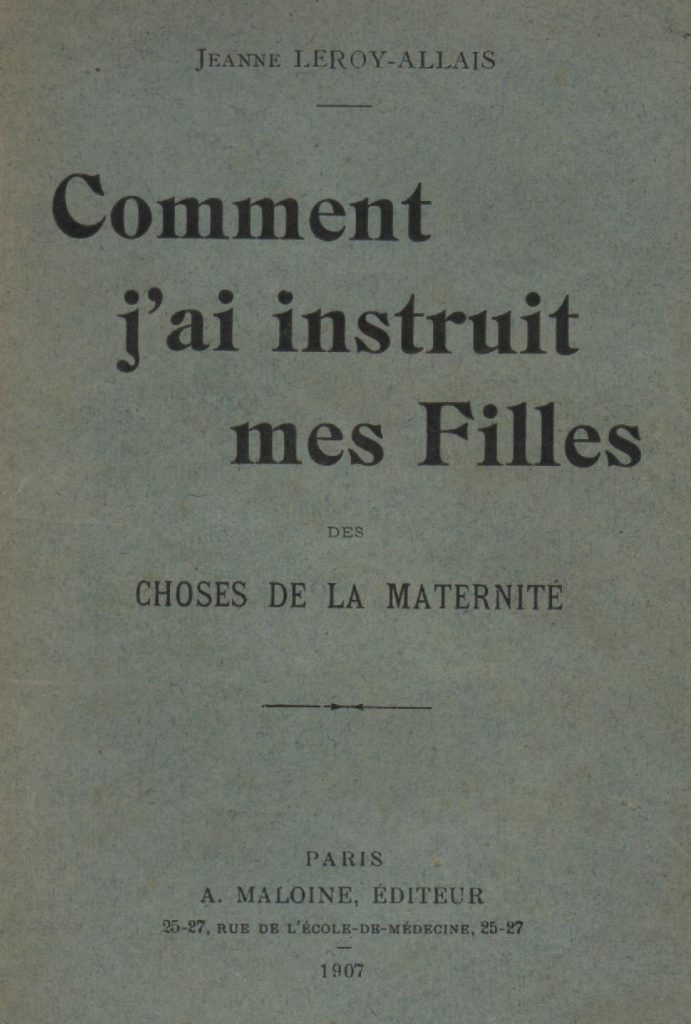
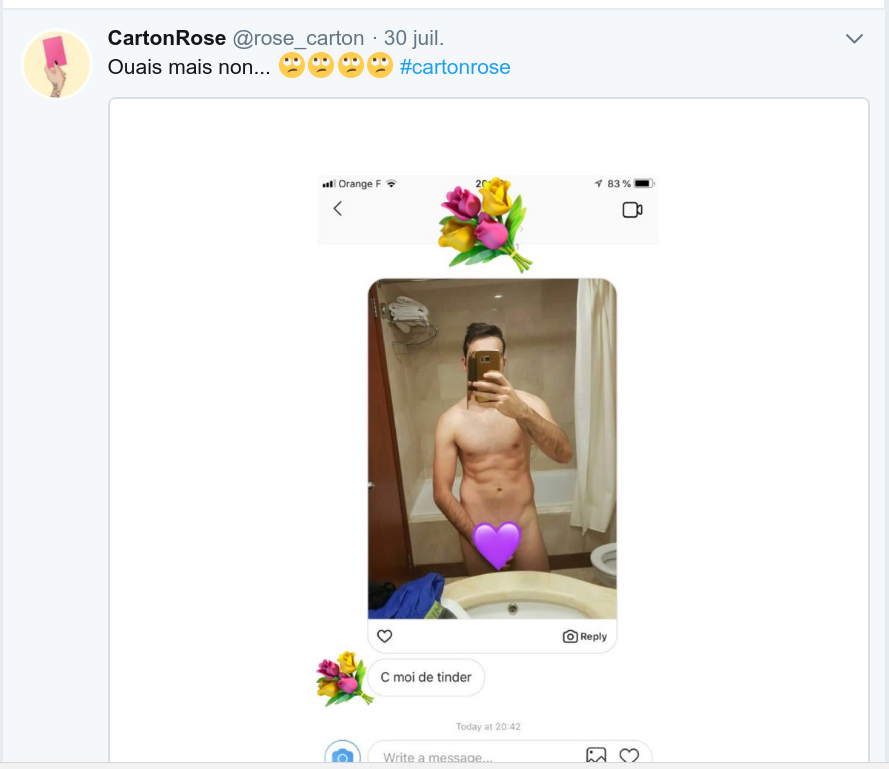



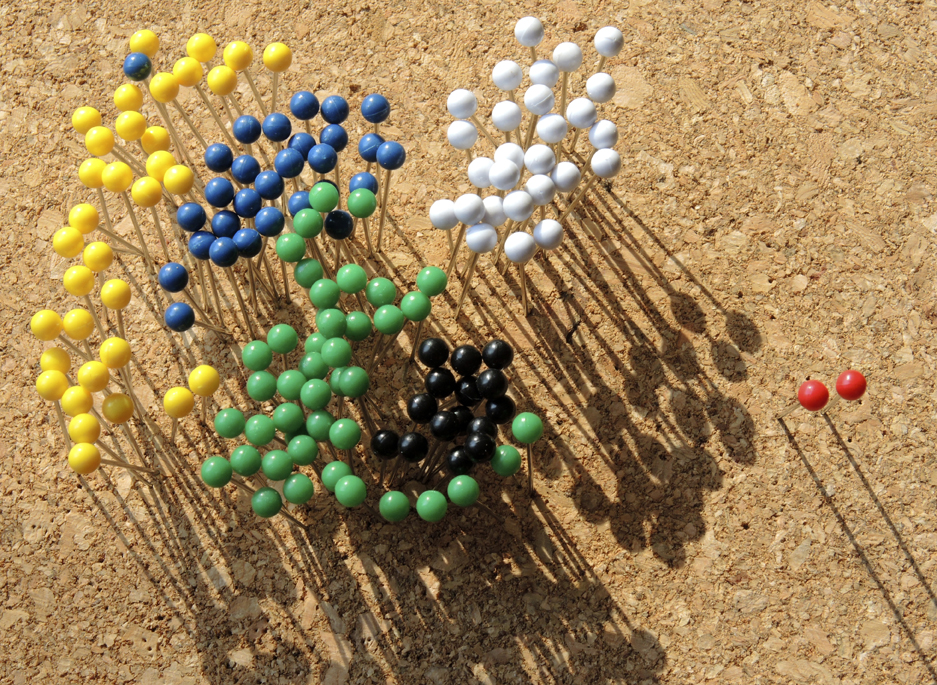
0 commentaires