 Revoir la vie après la mort, découvrir la suite de l’existence qui se prolonge désormais vers l’au-delà. Les histoires nourrissent-elles la vie ou bien se cachent-elles dans le royaume des morts ? Les morts peuvent-ils encore influencer notre regard sur et dans le monde ?
Revoir la vie après la mort, découvrir la suite de l’existence qui se prolonge désormais vers l’au-delà. Les histoires nourrissent-elles la vie ou bien se cachent-elles dans le royaume des morts ? Les morts peuvent-ils encore influencer notre regard sur et dans le monde ?
Tel est le parcours romanesque qu’Alain Mabanckou nous invite à suivre dans Le Commerce des Allongés (paru au Seuil en 2022). Ce sont les pas de Liwa, jeune homme décédé, qui nous guideront à travers les pages de ce récit vers son passé, mais aussi vers son avenir post-mortem. C’est dans le cimetière Frère Lachaise, au pied d’un manguier que, plongés dans le rêve mortel du protagoniste, nous ferons connaissance d’autres personnages et de leurs vies passées. L’un après l’autre, ils rendent visite à ce nouvel arrivé qui peine encore à comprendre son état de défunt et à se repérer dans cet espace qui se présente désormais comme sa nouvelle demeure. Ce monde à l’envers qui se donne à voir petit à petit est en effet le miroir le plus fidèle du monde des vivants.
Avec Liwa, dans son silence quelque peu naïf, nous occupons cette place de spectateurs face à l’inconnu et aux histoires de vie qui se libèrent dans la parole de ces pauvres défunts (et défunts pauvres). C’est en donnant à voir la trajectoire individuelle de chaque personnage que la vie collective se configure dans toute sa complexité ; la vie privée donnant à voir celle du public. Ce sont les autres habitants du cimetière qui vont, avec leurs récits, contextualiser le passé de Liwa et lui attribuer une place dans ce tissu social. Orphelin de mère et père – sa maman décède au moment de l’accouchement, n’ayant jamais révélé l’identité de son père – Liwa sera élevé par sa grand-mère, Mâ Lembé, qui lui consacre toute sa vie.
La multiplicité de voix intégrées à celle d’un narrateur omniprésent, nous dévoile à chaque chapitre le paysage d’une ville, Pointe-Noire, et avec elle les enjeux politiques et culturels de toute une société marquée par les injustices et l’inégalité de classe. Dans le livre, une grande polémique suscitée au sein de la classe dominante, écœurée « à l’idée que leurs honorables défunts côtoient au Frère-Lachaise ceux des quartier populaires », poussera le président du pays à construire un cimetière entièrement à part, ainsi nommé Cimetière des riches, afin de bien léguer à ces derniers une éternité paisible loin des ces « culs-terreux qui ne savent pas se tenir dans leur cercueil ». D’autres caractéristiques viennent encore composer le portrait social que nous dresse l’écrivain. Ici, la corruption côtoie la magie, les superstitions embrassent le pouvoir et prennent parti dans le destin de chacun, les sorciers et sorcières ont leurs places d’honneur dans un quotidien de frontières mouvantes, où les morts ne s’absentent pas et ne se taisent jamais. Mais si la violence et les vices humains sont exposés tout au long de la trame romanesque, le langage et le rythme adoptés par Alain Mabanckou ne découragent pas le lecteur qui, au contraire, se laisse conduire par la légèreté presque paradoxale de son récit. Dans Le commerce des Allongés, il s’agit avant tout d’une véritable ode à l’art narratif (et au fait de raconter des histoires), cette forme ancestrale des mots qui s’affirme dans l’oralité, fort présente dans l’écriture de Mabanckou, car ce sont finalement ces récits qui vont aider le jeune Liwa à prendre sa décision ultime, afin d’accomplir sa mission personnelle.
Alain Mabanckou, Le Commerce des Allongés, Seuil, 2022, 304p.
Au Congo, quelle place la mort occupe-t-elle dans la société ?
C’est une question lourde de conséquences. Disons que la mort, que ce soit au Congo Brazzaville ou dans beaucoup d’autres pays africains, est un moment social. La distinction entre la mort en Occident et la mort en Afrique, c’est que la mort en Occident est une affaire familiale, personnelle ; vous voyez même des communiqués du genre « respectez l’intimité de la famille ». Or, le Congolais ne veut pas d’intimité parce qu’il a envie de rentrer dans cette intimité pour voir justement ce qu’il y a là-dedans. En Occident, la famille va se recueillir dans un appartement, un espace clos : vous avez à cacher quoi ? Sortez le mort, tout le monde veut le voir ! Quand il était vivant, il allait partout, pourquoi vous voulez le cacher ?
En général, à l’époque, on mettait le mort au milieu de la parcelle et tout le quartier venait dormir autour pendant une semaine : les nattes par terre, on dansait, les gens venaient draguer, on s’y donnait même rendez-vous : « On se voit quand ? Ce soir, on va dans telle veillée. Il ne faut pas te tromper, j’ai une veillée demain, si tu vas dans l’autre veillée tu ne vas pas me voir ». Il y a vraiment un aspect social. Parfois quand il y a une semaine, et il n’y a rien qui se passe, un mois, et il n’y a pas de mort, on est fâchés. On va se retrouver où ? D’ailleurs, quand vous arrivez dans un quartier, vous avez des palmes. On coupe une palme d’un palmier et puis après on en met tout le long du chemin pour indiquer où se trouve le cadavre. Donc, quand vous arrivez vous ne faites que suivre ce parcours avec ces palmes qu’on a mises ici et là jusqu’à la parcelle du mort où vous arrivez : le lit a été sorti dans la parcelle et le mort il est là, il n’est pas à la morgue. Ici vous mettez votre mort dans la solitude glacée d’un coffre-fort de la morgue, où le pauvre est là à côté d’autres cadavres et ils ne se connaissent même pas, ils ne peuvent pas se parler (« Mais toi tu es mort de quoi ? D’accident ? »).
La mort est exposée à tout le monde et en même temps, c’est le moment où on peut voir la solidarité : est-ce que vous avez été une famille gentille avec les autres ? Quand il y avait des cadavres ailleurs, est-ce que vous alliez aux enterrements ? Parce que si vous n’allez pas chez les autres, pourquoi seraient-ils solidaires ? Même si vous étiez riche, mais si vous n’avez pas montré une certaine solidarité par rapport aux autres, eh bien, le jour de votre mort, vous serez tout seul à la maison, et c’est la pire des conséquences pour quelqu’un… Quand il y a un décès, on fait circuler un cahier dans le quartier. On y note les noms de ceux qui ont donné de l’argent. Quand quelqu’un décède, on sort ce registre pour voir s’il a cotisé…
Et cet argent est pour la famille ?
Exactement ! Quand un Congolais meurt ici à Paris, il y a un registre qui circule dans le quartier Château Rouge (18ème arrondissement): la solidarité se réveille immédiatement. C’est pour cela que beaucoup de cadavres de Congolais sont rapatriés. Vous vous demandez peut-être : « mais comment ils ont fait ? S’ils n’ont pas de boulot. » C’est possible grâce à la solidarité. Il est important d’assister la famille quand quelqu’un meurt, il faut être généreux. C’est pour ça que je dis que la mort est un acte social.
D’un autre côté, la mort peut être festive, dans le sens où il ne faut pas ennuager le futur, pour ainsi dire, du mort, en étant trop triste, car les routes risquent de se fermer. Il faut continuer de le cajoler, il faut mettre la musique qu’il voulait… maintenant, on met des chansons religieuses, mais avant, si la personne aimait Nana Mouskouri, vous lui mettiez Au cœur de septembre. Ou Dalida, Mike Brant, Claude François…
Il y a donc cet aspect social et c’est un peu ce que je voulais retrouver dans les quatre jours de funérailles de mon personnage Liwa, où il voit ce qui est en train de se passer autour de lui, où il voit comment les gens sont en train de pleurer, comment ils se comportent, puis il y a les danseuses, les pleureuses, etc.
La présence dans le roman de superstitions, de croyances, élargit, enrichit en quelque sorte notre appréhension de la réalité et notre regard sur elle. Les mythes nous expliquent tout ce qui nous échappe, mais peuvent aussi, comme on le constate dans le roman, être au service de la violence humaine. Ces discours mythiques fournissent les bons arguments au nom desquels toutes sortes de crimes peuvent se « justifier ». Comment ces deux faces d’un même discours magico-religieux coexistent au sein de la société congolaise ? Où se situe cette frontière discursive et son rapport à la réalité ?
 En réalité, il n’y a pas de frontière, puisque nous avons été éduqués avec la conception selon laquelle le monde mystique et le monde réel se côtoient. Quand vous allez dans un marché, on vous avertit que tous ceux qui sont dans le marché ne sont pas toujours des personnes vivantes. Tu ne sais pas si le mort est venu acheter un peu de boisson, des casiers de bière pour les amener au cimetière. Parce que oui, il s’ennuie tellement là-bas qu’il vient prendre de l’alcool, des trucs des vivants. On vous expliquera donc toujours qu’il y a un mystère qui est caché derrière la réalité et, grandissant avec ce genre de conception, ça ne vous étonne pas lorsqu’on dit qu’hier un tel a croisé un esprit. Ou bien quand vous ramenez un sorcier à la maison pour qu’il puisse désenvoûter la maison.
En réalité, il n’y a pas de frontière, puisque nous avons été éduqués avec la conception selon laquelle le monde mystique et le monde réel se côtoient. Quand vous allez dans un marché, on vous avertit que tous ceux qui sont dans le marché ne sont pas toujours des personnes vivantes. Tu ne sais pas si le mort est venu acheter un peu de boisson, des casiers de bière pour les amener au cimetière. Parce que oui, il s’ennuie tellement là-bas qu’il vient prendre de l’alcool, des trucs des vivants. On vous expliquera donc toujours qu’il y a un mystère qui est caché derrière la réalité et, grandissant avec ce genre de conception, ça ne vous étonne pas lorsqu’on dit qu’hier un tel a croisé un esprit. Ou bien quand vous ramenez un sorcier à la maison pour qu’il puisse désenvoûter la maison.
Les frontières n’existent donc pas entre le surnaturel et le naturel. Nous vivons dans une situation où ceux qui vivent dans la réalité ont peut-être besoin de croire au pouvoir surnaturel pour pouvoir se trouver une raison d’exister. Si vous êtes, par exemple, dans une famille où il n’y a personne qui peut décrypter ce qui se passe dans l’irréel, vous n’êtes pas dans une bonne famille. Il y a toujours, dans chaque famille, quelqu’un qui en sait plus que d’autres. Quelqu’un qui peut communiquer avec l’autre monde pour nous dire ce qui se passe de ce côté-là. C’est cette cosmogonie, ce sont ces croyances-là que je voulais graver à l’intérieur du roman.
C’est tellement profond et ancré que, quand je trouve des incrédules, j’ai pitié d’eux. Parce que si vous êtes incrédules, c’est que vous avez limité la capacité d’aller au plus profond de votre réflexion. Si vous êtes écrivain et que vous ne croyez en rien, c’est bien, vous écrivez des histoires, tout le monde va dire « il écrit de bonnes histoires », mais qu’est-ce qui reste dans la profondeur ? Est-ce que vous êtes dépositaire de l’imaginaire de votre culture ? La chance qu’a la langue française c’est qu’elle embrasse beaucoup de cultures ; les Français ont colonisé des gens qui ont gardé quelque chose de leur culture. Et de temps en temps ces créateurs, qu’ils soient des écrivains, qu’ils soient des sculpteurs, des peintres, ramènent quelque chose dans la langue française, lui donnent cette épaisseur de l’imaginaire. La langue française a la chance d’avoir des praticiens qui ramènent les éléments de leurs cultures dans la langue de Baudelaire et de Kourouma.
C’est le but même de la littérature : le temps que vous passez à lire ce livre, pendant ce temps-là vous êtes congolais·e. C’est comme nous quand on lisait Pagnol, on était tous dans le sud de la France. On était là-dedans ! On rêvait de sa tour, de la gloire, du château, on était contents. Et après quand on fermait le livre, on retournait congolais.
Dans le roman, la justice rendue par le protagoniste n’arrive qu’après sa mort. Pourquoi ce choix ? La réalité, la vie ne nous laissent plus d’espoir ?
Je pense que les séquelles de souffrance dans les sociétés africaines sont tellement lointaines et ancrées qu’il faut, comme à l’époque d’Orphée, plonger vraiment dans le souterrain pour ramener l’espérance et la vie. Et puisque le seul langage que les dictateurs et les autres peuvent comprendre est celui du surréel, eh bien, il faut sortir les héros des ténèbres pour qu’ils reviennent rééquilibrer la société. En l’occurrence, le voyage de ce personnage vers l’autre monde, c’est un voyage qui lui permet d’avoir des pouvoirs surnaturels pour lutter contre ces gens qui sont les directeurs du port de Pointe Noire, qui ont le pouvoir, puisqu’ils ont le pouvoir économique. Vous n’y pouvez rien, mais le pouvoir économique en Afrique ne succombe que face au pouvoir du mysticisme. La seule peur d’un riche en Afrique, c’est de voir une silhouette qui arrive sans une personne. Tous les jours les riches vivent dans la peur : « il y a des esprits qui vont venir tout me prendre ». Et si vous dites à un riche « on a vu quelqu’un qui va arriver à minuit te prendre tout », il est capable de payer n’importe quoi pour se sauver..
Dans votre livre Le Sanglot de l’homme noir (Fayard, 2012), vous vous positionnez très clairement en tant qu’écrivain monde : il y a là le Congo, la France, les États-Unis. Pourquoi revenir à votre pays d’origine avec Le commerce des Allongés ? Quel lectorat avez-vous imaginé pour un roman aussi politique que celui-ci ?
Je pense que ceux qui lisent mes livres sont maintenant habitués à se promener partout. Je n’ai jamais visé de lectorat parce que je sais que si j’écris avec mes tripes, je peux expliquer n’importe quelle réalité et on n’a pas besoin de faire un stage au Congo pour lire mon livre. Moi aussi, je lis des livres japonais et je ne suis jamais allé au Japon. J’ai lu de la littérature colombienne avant d’aller en Colombie… je pense que le pouvoir de l’écrivain, c’est de vous entraîner vers des zones inexplorées. Avec ce roman, je ne visais pas vraiment un public ciblé, je voulais écrire l’histoire extraordinaire d’un jeune homme qui vient de mourir, qui ressuscite et qui part se venger et qui va retrouver vraiment beaucoup de choses sur son chemin. J’avais envie d’écrire un conte, mais un conte urbain, et dans ce sens le pouvoir du conte, c’est de prendre les lecteurs ou les lectrices dans le monde irréel, de leur dire que le monde réel n’existe plus, que vous êtes dans une autre dimension. Pour cela, il faut commencer par les secouer dès le départ. Lors de la première scène, quand j’essaye d’expliquer comment on ressuscite, vous avez l’impression qu’un jour j’étais mort et j’étais revenu, puisque il y a tout : la terre qui tourne, le gars qui se réveille avec la tête en bas, les pieds en haut, quand on lance un objet, au lieu de tomber, il va dans le sens inverse ; si on veut aller tout droit, il faut en fait reculer, la gauche est à droite, la droite est à gauche, le centre est à côté, le côté est le centre… tout est chamboulé, jusqu’à ce que le gardien, le DRH, vienne gifler mon personnage principal pour que ça retourne son cerveau et qu’il voit clair. Et quand il voit enfin clair, il n’est pas pressé d’aller se venger, il doit écouter d’abord ce qui se passe dans le cimetière… C’est un conte moderne en ce sens, et je pense que la question de la mort a une universalité, même si l’angle avec lequel nous le traitons n’est pas le même. Moi, j’ai choisi l’angle de l’humour, de l’éclat de rire et presque de l’absurdité.
Dans le contexte du roman, les femmes occupent souvent l’espace domestique dans leurs rôles de mères et sorcières ne figurant jamais comme des autorités ou occupant des postes de prestige dans l’univers politique et du travail. On les voit impliqués dans des travaux mineurs, voire marginaux, comme dans le commerce du Grand Marché ou dans la prostitution de luxe. Néanmoins, elles ont une grande force d’esprit, elles inspirent plusieurs vertus, telles que la solidarité, la justice, la bienveillance, entre autres. Pourriez-vous nous parler un peu plus de ces femmes ?
Dans ce roman, je pense qu’il est normal qu’elles n’occupent pas des postes de grande responsabilité. Nous sommes dans les années 70, 80, quelques années à peine après l’indépendance. C’est donc une Afrique vraiment dominée par les dictateurs. Les dictateurs ne sont pas connus pour être des féministes… le grand pouvoir qu’ont ces femmes, c’est le pouvoir de la vie sociale, c’est-à-dire qu’en étant au cœur de l’économie du marché, vous êtes au cœur du petit commerce, et le petit peuple vit du petit commerce. Ce n’est pas le petit peuple qui va acheter des actions à la bourse de Paris. Les femmes, en général, ont du pouvoir dans tous les marchés, ce sont elles qui contrôlent, qui menacent. Dans le roman, on voit que Sabine, qui est la doyenne de toutes les femmes du marché, menace à chaque fois d’aller enlever ses habits en public pour obtenir une table. Chez nous, si une femme âgée vous dit qu’elle vous montre sa nudité, tout le monde fuit, parce que sinon vous serez maudit. La meilleure manière de maudire les gens c’est celle-là. Quand on voit quelqu’un qui est devenu fou, on va dire que c’est parce qu’il avait vu la nudité d’une personne âgée, voire de sa mère. Ça remonte peut-être au péché de la Bible ou à la malédiction de Cham, justement – on a vu la nudité du père et par conséquent, on a maudit tout un peuple, en disant « tu seras l’esclave de l’autre ». Du coup, les exégètes ont dit « ah ! Les Noirs, vous serez les esclaves parce que vous êtes les descendants de Cham, donc vous êtes destinés à être des esclaves »…
Bref. Ces femmes sont des femmes puissantes, ces femmes tiennent la société : l’économie la plus forte là-bas, c’est le marché. C’est le port de Pointe Noire, mais le port de Pointe Noire ce sont les ballots d’habits, les quincailleries, les légumes, etc… Ces femmes sont aussi là pour la solidarité, puisqu’elles se réunissent, se cotisent pour que chacune d’elles achète une parcelle et construit une maison. Il y a non seulement une sorte de marché qu’on construit, mais également une sorte de banque : un système de prêt, de crédit sans intérêt existe. C’est-à-dire que si on est trois, alors si vous donnez 50.000, je donne 50.000, elle donne 50.000, ça fait 150.000 et on prend les 150.000 et on vous les donne à vous et vous allez acheter, je ne sais pas, un appartement. Or, maintenant vous continuez encore chaque année à verser. Vous donnerez encore l’année prochaine 50.000, je donne encore 50.000, elle donne 50.000 et on me donne 150.000 et j’achète mon appartement. Puis, le dernier tour et on lui donne le même montant à elle, et tout le monde a une maison. En fait, le tout c’est de savoir quel tour vous allez avoir, et là, c’est parfois la doyenne qui décide…On voit qui a le plus de problèmes et on va lui donner. Tout ça, c’est par la parole. Dans le livre vous voyez qu’on n’a pas signé un papier, parce que chez nous, on ne fait pas confiance au papier. On peut déchirer le papier. Les papiers, on dit, c’est un truc de blancs. Vous signez et voilà ce n’est pas moi qui ai signé, d’ailleurs je ne sais pas lire. Mais quand vous avez promis « Oui, je vais donner 50.000 », vous êtes obligé de donner. Là-bas, ça s’appelle la tontine et j’ai vu ma mère le faire, j’ai vu ma mère acheter sa parcelle et sa maison par ce biais. Et ça continue toujours, ici même dans le Château Rouge, les Congolais continuent à faire les tontines.
Quand on contemple votre œuvre littéraire, on s’aperçoit que chaque livre paraît bénéficier d’un autre style. Ainsi, Le Commerce des Allongés est rédigé à la deuxième personne du singulier. Dans quelle mesure chaque histoire / thématique requiert un autre style de narration ? Cette recherche de style vous procure-t-elle du plaisir ? Est-ce un jeu ? Pourquoi avoir fait le choix de la deuxième personne ?
L’utilisation de la première personne du singulier aurait logiquement voulu dire que c’est la personne qui est morte qui va raconter l’histoire. Ça aurait encore compliqué la situation : tu es mort et tu dois déjà gérer beaucoup de problèmes… Je voulais le laisser en paix, il est mort et il veut respirer ! Puis j’avais réfléchi : la troisième personne faisait trop roman classique du XVIII, XIX siècle. Au bout d’un moment, je me suis dit : Tiens ! Et si la personne ce n’est pas la personne qui est morte qui raconte, mais une voix qu’on ne voit jamais. On ne sait pas qui parle, mais il a eu une proximité avec le cadavre et il le tutoie. Cette voix connait tout, c’est un narrateur omniscient qui laisse néanmoins la place à d’autres voix aussi. En ce sens, cette narration est vraiment un conte. Peut-être que lorsqu’on écrit un roman, le plus dur est de trouver le ton, c’est comme quand vous voulez danser, le plus dur c’est de trouver le rythme, la cadence. Pour respirer un peu, j’ai eu recours à la technique de la polyphonie, c’est-à-dire, plusieurs voix : il y a une personne au-dessus de tout le monde qui raconte, et puis il y a, à l’intérieur, les personnages. Ce sont eux-mêmes qui racontent leurs vies, accompagnés par la voix du tout puissant qui est au-dessus. C’est la première fois que j’utilise cette voix que j’ai trouvée chez Umberto Eco…
Entretien réalisé le 3 octobre 2022 à la Quincave (partenaire de délibéré), lors d’une rencontre littéraire organisée par 1 bouquin 1 vin.
Propos recueillis par Gianna Schmitter et Priscilla Coutinho






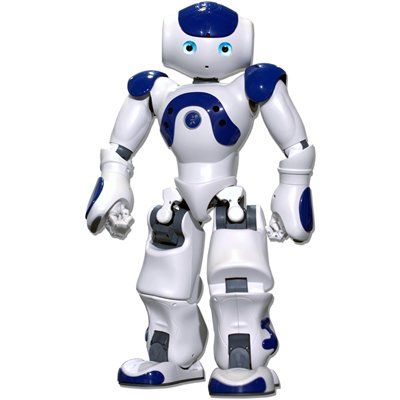



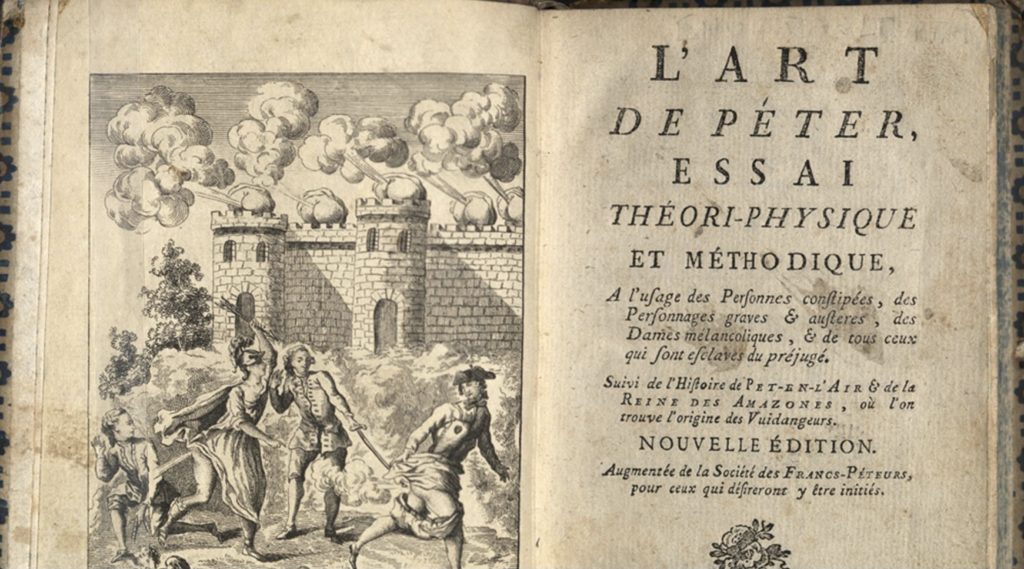

0 commentaires