 Allons au cinéma une fin d’après-midi d’hiver, quand les jours rallongent. En salle, actuellement, on peut voir tour à tour les sixième et septième longs-métrages du Chilien Pablo Larraín. Et cette expérience double, ou redoublée, vaut la peine car Neruda et Jackie sont des films jumeaux, nés de regards nouveaux et audacieux sur deux figures célèbres – et peut-être mineures – de la guerre froide.
Allons au cinéma une fin d’après-midi d’hiver, quand les jours rallongent. En salle, actuellement, on peut voir tour à tour les sixième et septième longs-métrages du Chilien Pablo Larraín. Et cette expérience double, ou redoublée, vaut la peine car Neruda et Jackie sont des films jumeaux, nés de regards nouveaux et audacieux sur deux figures célèbres – et peut-être mineures – de la guerre froide.
Réalisés l’an dernier, partiellement français par leur tournage et leur co-production, ces deux films sont des reconstitutions historiques qui suscitent des émotions contraires. Alors que la fuite du poète et sénateur communiste chilien déçoit rapidement, l’intensité de l’entrée en veuvage de l’ex-first lady américaine émeut et fascine durablement.
 En passant d’un film mineur, et en grande partie raté, à un film majeur, voire un chef-d’œuvre, on se demande pourquoi Larraín a voulu réaliser à deux mois d’intervalle des films aussi contrastés. Les écarts entre ces deux réalisations écornent-ils sa condition de cinéaste, d’auteur ? Ou, au contraire, soulignent-ils la portée de son travail, l’ampleur de son génie ?
En passant d’un film mineur, et en grande partie raté, à un film majeur, voire un chef-d’œuvre, on se demande pourquoi Larraín a voulu réaliser à deux mois d’intervalle des films aussi contrastés. Les écarts entre ces deux réalisations écornent-ils sa condition de cinéaste, d’auteur ? Ou, au contraire, soulignent-ils la portée de son travail, l’ampleur de son génie ?
À travers le récit des déplacements d’une maison clandestine chilienne à une autre, et d’un lieu de recueillement funèbre au lieu choisi pour la mise au tombeau, Larraín met en scène l’intimité de deux personnages publics qui se trouvent en danger, mais dont l’Histoire nous assure d’avance la survie. Le Chant général [1] a été publié au terme des épisodes représentés dans le film, la légende fashion de Jackie à la Maison Blanche est connue de celle-ci et de nous tous.
D’un film à l’autre, ce qui diffère radicalement est la mise en scène des dangers respectifs : alors que Pablo Neruda est poursuivi par Peluchonneau, un policier risible qui vit et commente tout avec un temps de retard, Jackie Kennedy survit sans raison à un tourbillon sourd d’événements qu’elle est peu à peu capable d’affronter et d’infléchir par l’intermédiaire de l’appareil d’État et de la presse.
Si l’on apprécie dans Jackie la rigueur et l’efficacité des tensions propres à une tragédie antique, dans Neruda ce sont les incongruités d’un Santiago du Chili enjolivé de vues urbaines ostensiblement tournées à Buenos Aires qui sautent aux yeux, tout comme les invraisemblances narratives, joyeuses chez un Raoul Ruiz mais inconsistantes chez Larraín.
Accessoirement, par le biais de personnages secondaires comme Delia del Carril, l’épouse du poète, et de Bobby, le frère de feu le président, le cinéma de Larraín reprend à son compte des desseins caustiques ou contestataires pour dénoncer au passage les intérêts des politiciens, qu’il s’agisse des radicaux chiliens comme Gabriel González Videla, des démocrates américains comme John F. Kennedy, ou des communistes comme Pablo Neruda. Leur futilité est une question d’échelle, ou mieux, de perpective. On comprend alors pourquoi la voix de Luis Gneccho, calquée sur celle du poète, récitant à loisir le même poème d’amour, sonne faux : parce qu’il est aussi mal à l’aise dans les rondeurs du poète sybarite que Gael García Bernal dans l’élégance ridicule du flic en civil.
Par ricochet, on comprend également que si l’interprétation de Natalie Portman noue la gorge du spectateur, comme celle de Billy Crudup, le journaliste venu l’interviewer chez elle après l’assassinat, c’est parce que le film entier trouve son principal point d’ancrage dans leur entretien. Dans le mille-feuille temporel où prend place le crime de JFK, la musique de Mica Levi accompagne le retour de certaines scènes et, avec elle, la fiction se fait forte, capable de donner d’abord à entendre la mort du président, puis de la montrer et, ainsi, de la faire revivre par acteurs interposés et par un montage savamment éclaté.
Lorsqu’en clôture du film réapparaît le plan de grue aérien de la limousine présidentielle sur l’asphalte lisse de Dallas, le spectateur se souvient de l’arrivée au ras du sol des chars putschistes dans les rues défoncées de Post mortem (2010), le quatrième film de Larraín. Alors on saisit la justesse de « L’absente de tout miroir » [2], l’essai dans lequel Jean-Louis Comolli explique que la mort au cinéma n’est montrée que parce qu’elle ne cesse de revenir, film après film, jour après jour. Chez Larraín — un auteur, un vrai, même dans ses films ratés — la mort filmée est émouvante parce que revenue et remontée à l’écran ; tout travaille à en saisir le sens. Après la séance, avec en tête le souvenir des Hauteurs de Machu Picchu et de la statue indéboulonnée de son auteur, les couleurs du ciel d’un soir de fin d’hiver nous paraissent encore plus contrastées, pleines de promesses.
Joaquín Manzi
Cinéma
[1] Pablo Neruda, Chant général (titre original : Canto general, 1950), traduit de l’espagnol (Chili) par Claude Couffon, Poésie/Gallimard, 1984 (première parution en 1977).
[2] in Jean-Louis Comolli, Voir et pouvoir, Verdier, 2004
Neruda, de Pablo Larraín, avec Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes Morán…
Jackie, de Pablo Larraín, avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup…





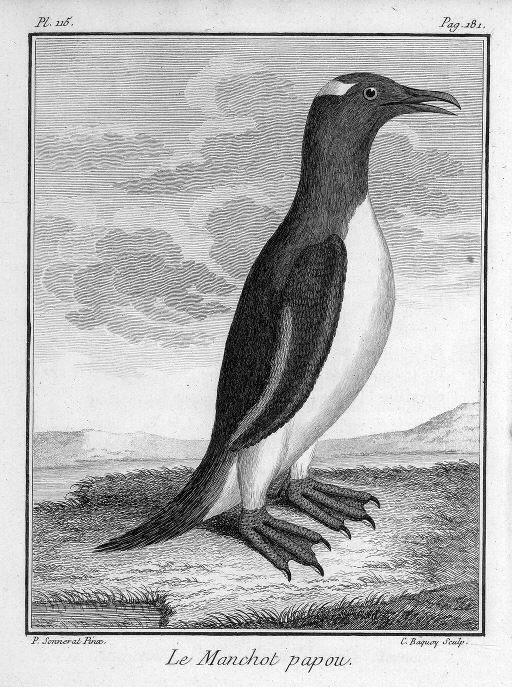



0 commentaires