Cette saison, au Palais de Tokyo, ça prend.
D’abord avec l’exposition amoureuse de Ugo Rondinone, “I ♥ JOHN GIORNO”. Première salle : une installation vidéo. Quatre écrans de la taille des murs et une série de moniteurs alignés au sol. Dans un claquement de noir et de blanc, John Giorno dit le poème “Thanxs 4 Nothing”, récital autobiographique, autocélébration de son 70e anniversaire dans laquelle ses amants, ses amis, ses sentiments, ses drogues, ses aspirations passent en bande accélérée. Saisi sous tous les angles, le visage est kaléidoscopique, la voix élastique, le montage serré, impeccable, hypnotique : le spectateur plonge, captivé dès le seuil – on a rarement vu captatio benevolentiae plus efficace.
On traverse ensuite un couloir feutré (et une des sagesses de cette exposition est de ménager ce genre d’intervalle entre une pièce et une autre, respirations spatiales si précieuses et trop souvent oubliées dans les scénographies) qui nous fait passer de l’obscurité de la blackbox au polychrome flashy d’une salle des archives dont les murs sont tapissés de reproductions, tandis que d’énormes classeurs reposent sur des socles. Concevoir le lieu de l’archive comme un espace en technicolor : voilà qui est pensé.
Replongée dans l’ombre : voici la salle dédiée à Sleep, ce film de 5h30 dans lequel Andy Warhol filma John Giorno endormi. Puis lumière à nouveau avec la grande salle dédiée au projet “Dial A Poem”, initié par Giorno en 1968. Composez un numéro de téléphone et, au bout du fil, une voix (celle de Emmett Williams, de Serge Gainsbourg, de Bernard Heidsieck, etc) chantera un morceau ou dira un poème dans votre combiné (vous pouvez même essayer depuis votre propre téléphone, jusqu’au 10 janvier 2016, en composant le 0800 106 106). Suivent ensuite les multiples appropriations dont Giorno fut l’objet, par Pierre Huyghes, Rirkrit Tiravanija, Elizabeth Peyton, etc. À la fin du parcours, on est épuisé d’avoir sans cesse plongé de l’ombre à la lumière, on est épuisé, donc on est heureux. La première salle a tenu ses promesses : le rythme qui était celui du film traverse toute l’exposition, l’espace est scandé, conçu comme une ligne musicale qui ferait du contrepoint son motif favori. Il n’en fallait pas moins pour exposer un poète.
Sans souffler, on descend au niveau inférieur, où est exposée l’œuvre de l’artiste islandais Ragnar Kjartansson. Pour cette exposition, Kjartansson a composé la pièce Bonjour : dans deux maisonnettes exagérément charmantes reproduites à échelle 1, deux acteurs – un homme et une femme – s’activent. Puis l’homme sort de sa maison d’opérette, se rend près d’une fontaine située sur une fausse place du village, allume une (fausse ?) cigarette. La femme sort de chez elle, un vrai vase de fausses fleurs à la main, se dirige vers la fontaine. Ils se regardent tandis qu’elle remplit son vase. Il lui dit : “Bonjour”, elle lui répond “Bonjour”. Elle rentre chez elle. Il rentre chez lui… Et recommencent les mêmes activités, refont les mêmes gestes, sortent à nouveau, se disent bonjour, rentrent à nouveau, et ainsi de suite : la rencontre n’ira pas plus loin. Car comment une carte postale pourrait-elle avoir de la profondeur ? Elle n’a rien d’autre à offrir qu’une surface répétitive. C’est là que réside son charme – et notre angoisse.
Dans Bonjour, comme dans tout le travail de Ragnar Kjartansson, l’œuvre est un théâtre qui révèle ses artifices. Tout cela se fait avec ingénuité et sans grandiloquence : les maisons de Bonjour ne dissimulent pas qu’elles sont en toc ; de même pour les rochers peints de Seul celui qui connaît le désir, dont on découvre, en passant derrière eux, les tasseaux et les montants en bois ; ou encore pour les océans, rivières et lacs qui peuplent les vidéos de l’installation World Light et qui ne sont rien qu’une toile de tissu bleu sous laquelle court un souffle. World Light est une adaptation du grand roman de Halldór Laxness, monument de la littérature islandaise. Mais voici en quels termes Kjartansson décrit son adaptation du grand chef-d’œuvre national : “On n’a pas vraiment fait du cinéma. On a joué une tentative de faire du cinéma. C’est un film épique tourné avec le budget d’un porno-soft bon marché.”
Quand la désillusion n’est pas un principe plastique, elle intervient ailleurs dans la sémantique de l’œuvre. Ainsi, dans Scenes from Western Culture, série de huit vidéos dont chacune incarne une scène de la vie occidentale dans ce qu’elle a de connu, de rassurant et d’étrangement inquiétant. Une femme fait des longueurs dans une piscine en plein air, une horloge sonne dans une maison silencieuse, un cinquantenaire et une pin-up se disent au revoir sur une jetée tandis que s’approche un bateau à moteur, un couple dîne au restaurant, un autre fait l’amour dans une chambre blanche et lumineuse… Visions d’un certain idéal quotidien, images de marque du bonheur à l’occidental, produits de consommation recommandés plutôt que vies réelles. Au fil de son travail, Ragnar Kjartansson réinvente les codes de la distanciation. Elle n’est pas militante, elle est mélancolique ; son objet n’est pas politique, il est culturel.
Au Palais de Tokyo, cette saison, ça prend, et d’un niveau à l’autre, d’une atmosphère à l’autre, on se dit qu’un musée peut être un endroit merveilleux.
Nina Leger
Ragnar Kjartansson et Ugo Rondinone (“I ♥ JOHN GIORNO”) à voir jusqu’au 10 janvier 2016, au Palais de Tokyo, 13 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris, tous les jours sauf le mardi, de midi à minuit.
À lire également : “Croisements” d’Arnaud Laporte, à propos de Ragnar Kjartansson.




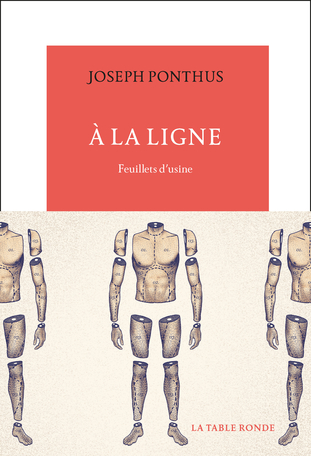
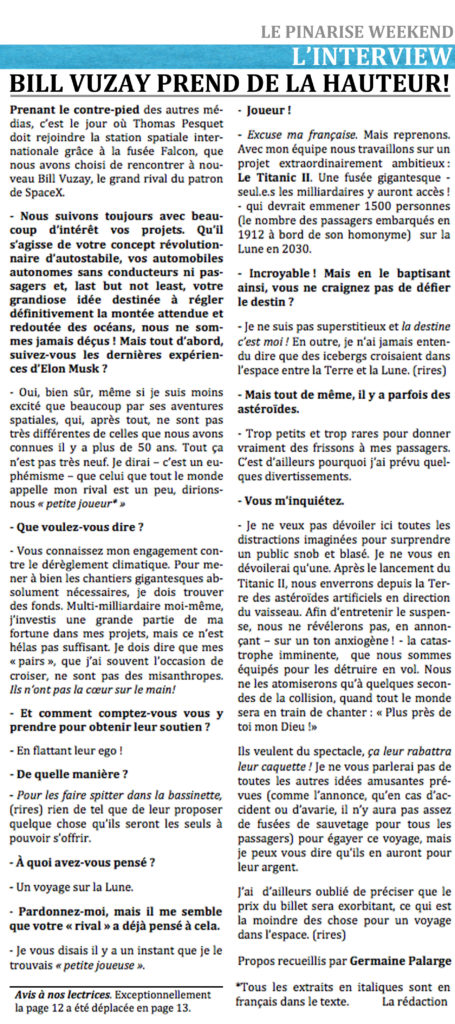




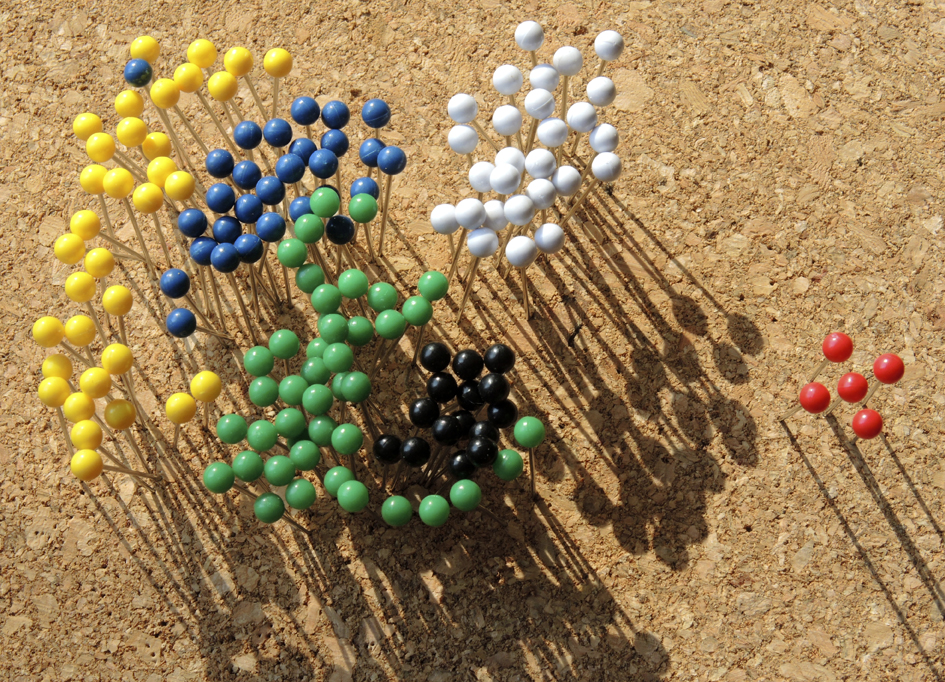

0 commentaires