Roman de Vodolazkine, série Netflix sur Trotsky, documentaire géant en trois volets, exposition Rouge au Grand palais. On n’en finit pas de scruter la mémoire russe. Avec des résultats parfois surprenants. « Notre passé est imprévisible », écrivait Joseph Brodsky, et il n’avait pas tout vu…

”Lénine en promenade avec des enfants”, d’Alexandre Deïneka, musée des Forces armées, Moscou, actuellement au Grand Palais dans le cadre de l’exposition “Rouge”
Dans Une pièce et demie [1], le même Brodsky évoque son enfance dans un appartement communautaire de Saint-Pétersbourg, afin, disait-il, que tout ne disparaisse pas en même temps que nous. Dans L’Aviateur, récemment publié, Evgueni Vodolazkine, avec le même souci, va retourner aussi dans l’un de ces Kommunalka, faits de cohabitations improbables. Même si en début de roman le personnage principal, Innokenti Platonov, est bien incapable de retourner où que ce soit : il se réveille dans un hôpital, déboussolé et amnésique. Il va rapidement apprendre que, né en 1900, congelé aux îles Solovki [2] dans les années 30, le voici propulsé dans le XXIe siècle russe.
Dans ce livre nourri d’évocations littéraires, on parierait sur une référence malicieuse à Maïakovski et sa pièce La Punaise. Montée par Meyerhold en 1929, avec décors de Rodtchenko, mal perçue, vite interdite. Un aspirant petit-bourgeois, traître à sa classe, au Parti, et à sa fiancée, produit de la NEP [3], y est accidentellement congelé et ramené à la vie « dix plans quinquennaux plus tard », comme disait le poète. 1979, à hauteur d’avenir radieux et communiste ? Ce tenant de la révolution sans repos, qui se suicida un an plus tard, voyait un monde aseptisé, étale, où des robots font têtes pensantes. Pas si mal anticipé, 1979 fut bel et bien l’apogée de Brejnev et de la période dite de glaciation. Mais si pessismiste fût-il, Maïakovski écrivait sur un futur redoutable, mais un futur.
Evgueni Vodolazkine écrit, lui, sur le passé : celui qui revient par bribes à son héros Innokenti et celui dont les Russes sont privés. Âgé de 54 ans, Vodolazkine a tâté du soviétisme, mais il fut de ceux qui virent arriver la perestroïka avant leurs trente ans. Et de ceux qui assistent, aujourd’hui, à la mise aux normes nouvelles, en ère poutinienne. Entre 2014 et 2018 (avec tendance lourde récemment) 71% des ouvrages que les établissements scolaires sont autorisés à acheter ont été interdits. Motif le plus souvent invoqué, le livre « ne contribue pas à donner l’amour du pays ». Ce qui interdit, par exemple, de faire mention des queues interminables devant les magasins d’antan, ou d’oublier de célébrer le formidable rebond économique russe en dépit des sanctions. Ou encore de faire la part belle, dans les livres pour petits, à Winnie l’Ourson, Perrault, Grimm, Astrid Lindgren, rien que des étrangers…
Kuokkala paradis perdu
Innokenti s’adapte vite, à la téléréalité, aux médias qui le coursent, au contrat publicitaire mirobolant que lui offre une entreprise de légumes surgelés, il s’adapte amoureusement, séduit par Nastia, répliquante moderne de son amour d’autrefois, dont elle est la petite-fille. On lui explique le monde : « La dictature a été remplacée par le chaos. On vole comme jamais auparavant. Il y a au pouvoir des gens qui abusent de l’alcool. Voilà les grandes lignes. » (Prudemment, l’auteur situe le récit en 1999, juste avant l’arrivée de Poutine.)
Mais c’est une autre Russie qui revient à Innokenti, par fragments et surprise, façon Brodsky. C’est la chair du livre, son charme, et une formidable photographie de la mémoire russe actuelle, tournée vers l’âge d’argent. C’est par exemple Kuokkala, ce village alors finlandais à 30 minutes de Saint- Pétersbourg, en bord de mer, et en passe de devenir dans la mémoire collective l’image du paradis perdu. Se retrouvaient là, hors de portée du tsarisme et pour pas cher, artistes célèbres, Gorki, Repine, artistes en devenir ou inconnus, mais aussi – Innokenti comme bien des Russes n’en a pas souvenir – les révolutionnaires en exil, Lénine ou Trotsky (on ne saurait trop conseiller, sur le sujet, les merveilleuses mémoires de Iouri Annenkov chez le même éditeur). Parfum des pins, télègues et moustiques, temps ralentis d’étés ouverts sur le monde, en avance sur celui-ci bien souvent. Et objet de toutes les modernes nostalgies. Mais est-ce un hasard si le héros de cette fable se retrouve en proie à un vieillissement accéléré et délétère au rythme de celles-ci ?
Trotsky, le train fantôme et Netflix
Tout d’abord, c’est bien tentant. Souscrire sans discuter au texte signé par des centaines d’universitaires, et le petit-fils de Trotsky lui-même pour protester contre la diffusion par Netflix de la série russe Trotsky. Huit épisodes bien tassés qui n’appellent pas de saison 2, une épuisante collection de mensonges, déplacements, approximations. Et filmée par des tâcherons, Alexander Kott et Konstantin Stasky, dont on peut seulement dire qu’ils auront amorti le coût du « train de la Révolution » de cette superproduction.
Bien sûr, comme les signataires, on peut s’énerver en prime de voir toutes les femmes de la série réduites au sexe torride ou aux fonctions ancillaires : Frida Kahlo en forme olympique (ah, elle peignait ?), Larissa Reisner (elle écrivait ?), sans compter les épouses Nadedja Krupskaïa (pédagogue et militante ?), voire Natalia Sedova (militante ?).
Évidemment, la récurrence des phrases et épisodes antisémites, peut d’abord apparaître comme une exposition crue de l’antisémitisme bien réel de la Russie tsariste, haute époque de pogroms et autres Protocoles des sages de Sion. Mais cette récurrence, décontextualisée, obsessionnelle, finit par former un autre paysage : l’antisémitisme comme composante ordinaire (avec en prime quelques touches « cosmopolites », la révolution comme œuvre de l’étranger).

On peut s’étonner, le mot est faible, de voir l’assassin de Trotsky, Ramón Mercader, un stalinien convaincu, apparaître en quasi ingénu politique, presque droit-de-l’hommiste, nouer une relation intime et fascinée avec le révolutionnaire en exil et ne se résoudre à le tuer qu’en légitime défense. On renvoie vers L’Homme qui aimait les chiens, de Leonardo Padura : non seulement c’est un vrai livre, mais documenté.
Que probablement jamais Konstantin Ernst n’a pris le temps de lire. Le monsieur est l’ordonnateur omniprésent et producteur de la série, bouclée en un an pour les célébrations de la Révolution. Il est aussi le président de Perviy Kanal, chaîne qui illustre en permanence les faits et gestes de Poutine. Cote légèrement en baisse, dit la presse russe. Mais Konstantin Ernst a aussi des ambitions internationales. Contrainte de marché, comment plaire à la fois au tsar Poutine et aux USA Netflix ? L’un trouve de la grandeur à Staline, les autres le voient en monstre. Show-runner inter-blocs, un métier. D’où des concessions mineures au personnage de Trotsky, « rock star », dit Ernst, et l’avenant Ramón Mercader, il faut tout de même des héros positifs. Quant à Staline, service minimum : un brigand madré…
Avec cette série multi-récompensée en Russie, Konstantin Ernst a retrouvé la cote. Faîte de carrière pour l’ancien grouillot de l’émission Vzgliad (le regard) au début des années 90, celle qui chaque vendredi vidait les rues de toutes les républiques car on osait pour la première fois y aborder des sujets brûlants avec une bonne dose d’insolence. On le retrouve cinq ans plus tard (et après l’assassinat resté non résolu du journaliste vedette de Vzgliad, Lystiev, devenu entre temps directeur de chaîne), nommé par l’oligarque Berezovski en remplacement de celui-ci. Rapide ascension qui ne l’empêche pas de rallier Poutine avec enthousiasme.
C’est anecdotique. Les Russes ont adoré (meilleur audimat et grande curiosité pour ce Trotsky dont même Gorbatchev refusait de prononcer le nom) ; ils ont sûrement capté le message, l’étranger est suspect et toute révolte mène au pire. Plus ennuyeux, Netflix diffuse désormais la série auprès de ses 139 millions d’abonnés. Combien ne connaîtront de Trotsky, et de la révolution russe, que la vision « rock » de Konstantin Ernst ?
Dominique Conil

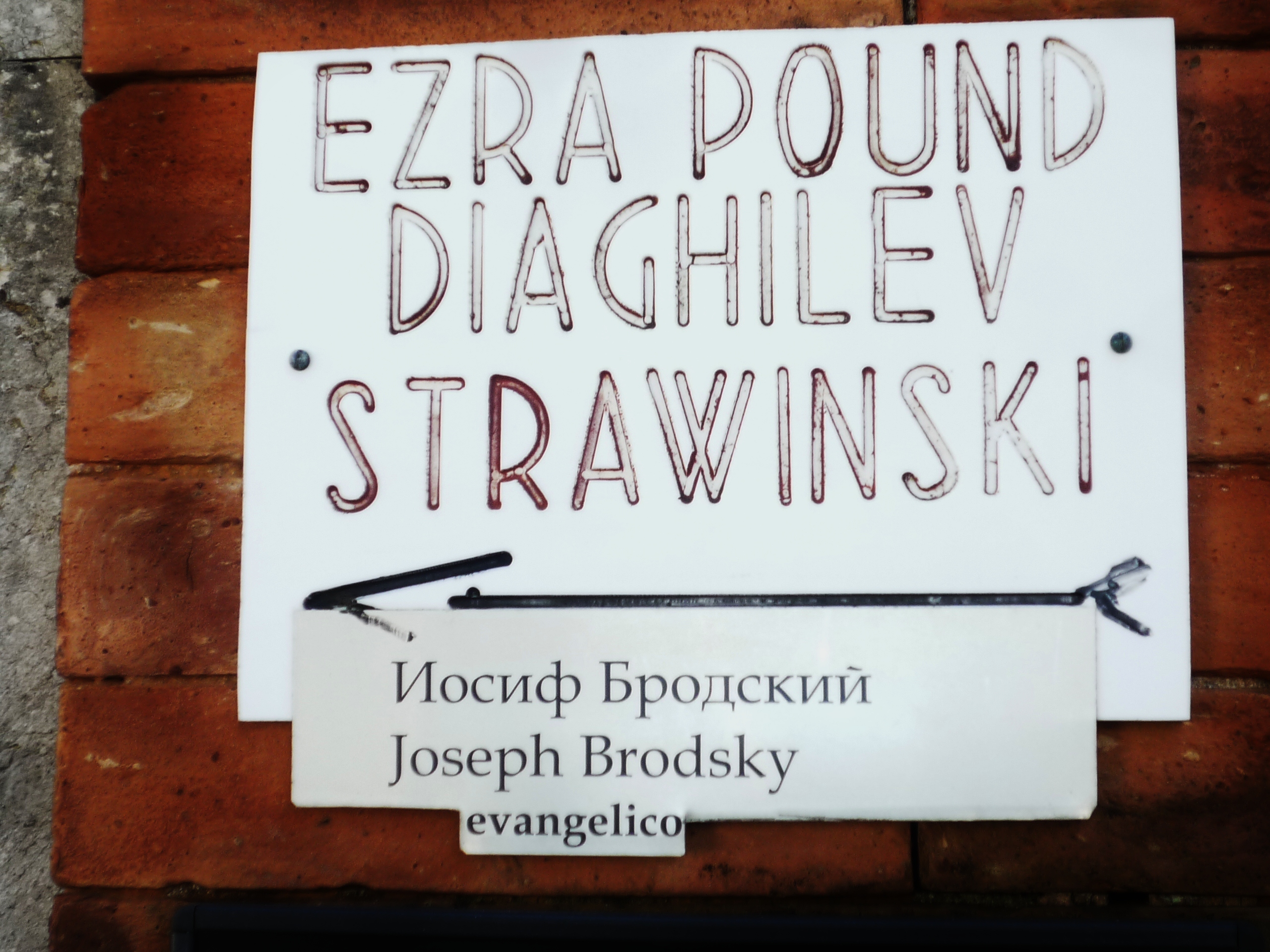


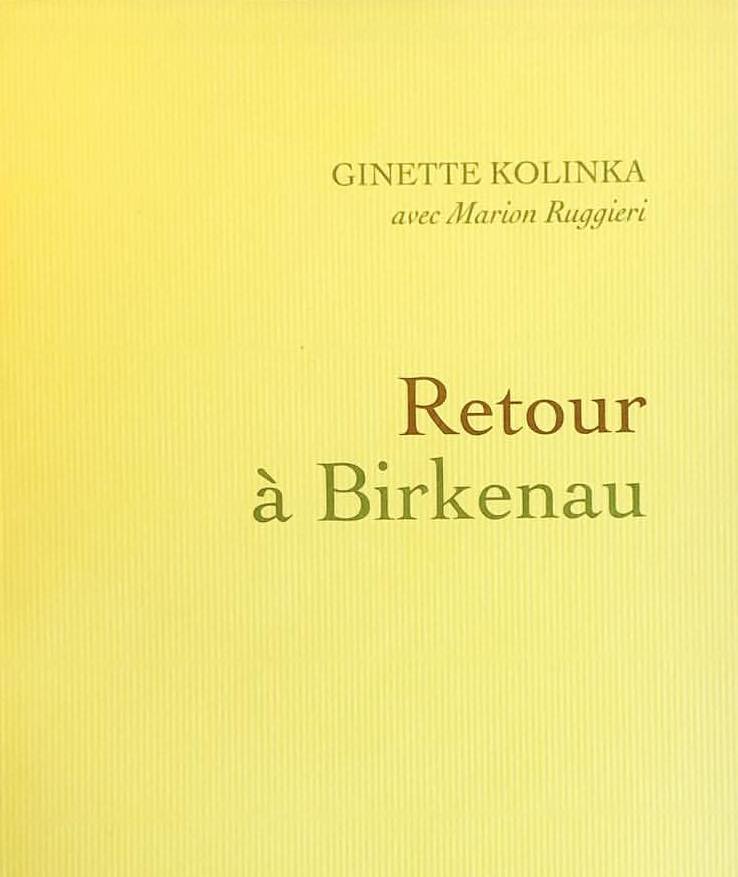




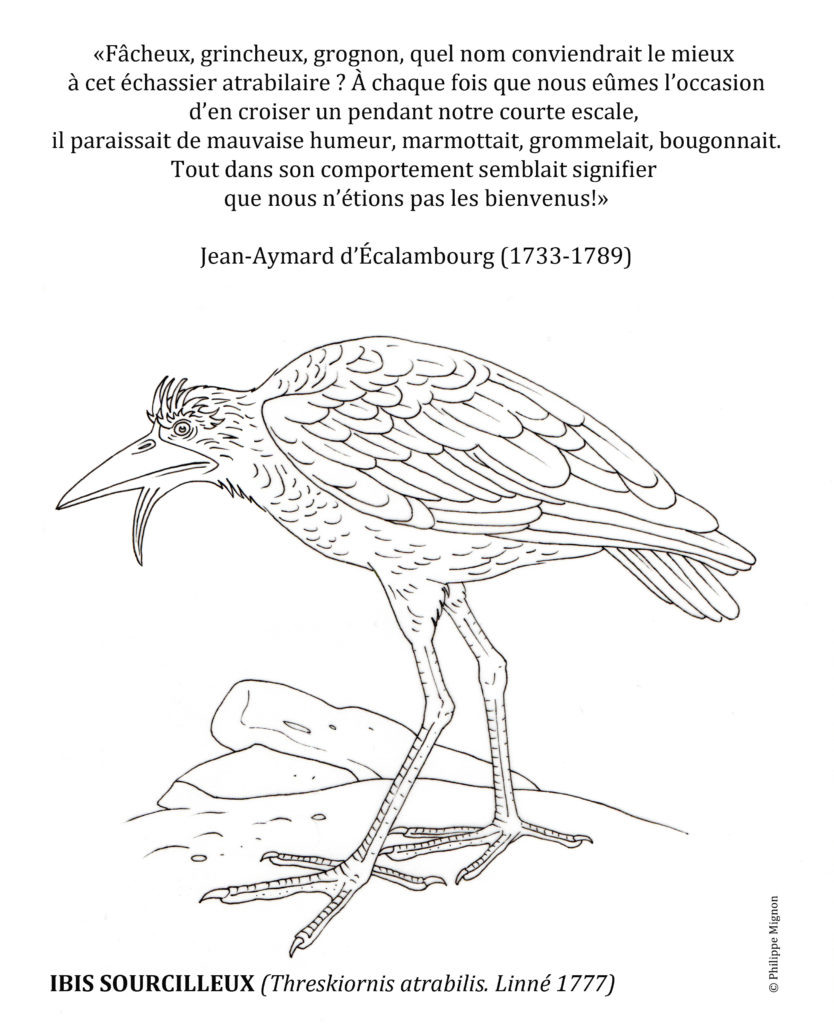

0 commentaires