Le genre idéal est noir. Comme un polar, un thriller, une enquête judiciaire ou un roman naturaliste. Et c’est de l’humain, de la tragédie grecque, du meurtre, en série, passionnel, accidentel, d’État, ordinaire parfois.
Bibliothèque à vendre. Pas de place. Plus d’argent pour les fêtes et les assurances à payer qui arrivent en même temps que les vœux de bonheur et de prospérité. Les caisses de livres remontent de la cave, rejoignent celles du grenier dans le salon. Restent sur les rayonnages vides des traces légères d’absence, des fantômes délicats d’histoires sur le bois. Il faut d’abord payer le loyer. La classe moyenne française ne doute plus, elle se voit tomber. Ses enfants craignent moins d’être tué en boîte de nuit ou par un camion bélier que de ne pas avoir de travail, ce que l’on appelle « l’avenir ».
Alors il faut se séparer du premier roman lu en Rivages sur le conseil d’un ami quand on pensait le faire suivre à ses fils. Il faut mettre dans l’estomac d’un sac de sport Arracher les bourgeons, tirez sur les enfants ou L’Homme des vallées perdues et prendre le métro vers un hypothétique acheteur. Rouletabille, American Gods, La Solitude est un cercueil de verre, Le Monde perdu, Dominique Mainard, Kader Abdolah, Cossery, Ogawa, Darley, Todde, Davidsen, Rawi Hage, Jancar, Jocelyne Saucier, Thompson… Faire le tri. Toutes ces années d’écriture, ces centaines de personnages, ces milliers d’émotions. Il faut agir. En mode automatique. Comme on jette un nid de souris au feu sans trop penser à la portée qui s’y trouve. Fahrenheit 451. Mémoriser au moins un titre avant de le vendre. Se remettre à lire les quatrièmes. Composer une autre liste de noms et de titres. Sallis, Giono, Bunker, Padura…
[huge_it_gallery id= »18″]
Et retomber, entre une couverture bleue de Japrisot en Denoël et le mythique Fantasia chez les ploucs, sur le roman écrit en 1968 par un jeune homme de 19 ans, alors en deuxième année de fac en Pennsylvanie. Un gamin, ou presque, qui parce qu’il avait en tête une histoire et qu’il voulait l’écrire, a tout laissé tomber pour se mettre devant sa machine tout en bossant dans une blanchisserie afin de remplir son assiette. Un étudiant qui négocia avec le doyen de sa fac de pouvoir rester dans sa chambre payée d’avance sur le campus sans pour autant assister aux cours, et qui dut pour cela consulter un psychologue tant il passait pour fou de mettre ses dernières économies dans une chimère.
Des solidarités imprévues se mirent en place pour pallier les moments de doute. Un client de la blanchisserie ne manquait jamais de lire quelques pages chaque fois qu’il venait chercher son linge. La famille de son côté, si elle ne validait pas l’idée, ne fustigea pas cette « année sabbatique ». La mère était bibliothécaire, le père footballeur jamaïcain surnommé « Flèche noire ». La musique qui accompagne leur fils est celle de Coltrane et la soul urbaine de Curtis Mayfield. Celui qui allait devenir un écrivain le dit lui-même dans la préface de l’édition française parue en 1998 en Soul Fiction chez l’Olivier : « Composer ce livre fut pour moi une expérience semblable à un exercice de haute voltige, comme si j’avais marché sur un fil les yeux bandés, en sachant que, si je n’arrivais pas au bout, il n’y aurait pas de filet de sécurité pour me rattraper, pas d’abri où me réfugier, que je ne pourrais plus regarder en face les autres étudiants de Lincoln et qu’il ne me resterait plus assez d’argent pour aller ailleurs. »
Le livre a paru chez un éditeur de littérature pornographique et de polar désireux d’ouvrir son catalogue à la littérature du ghetto. Il cogne dur et fut oublié avant d’être lu. Les premières lignes s’ouvrent, de manière classique pour un roman noir américain, sur une scène réaliste, violente dans sa banalité à présenter la mort par homicide. Un noir de 18 ans est trouvé à même le trottoir, le crâne éclaté par une balle. Quatre portraits d’assassins probables suivent pour décrire plus globalement la réalité de la rue à la fin des années 70. L’ambiance est celle de la série The Wire où la ville est pourrie, sans pitié et où survivre pour un jeune black relève de la gageure. Le roman annonce aussi ce qui sera la dégénérescence de toute une nation avec une lucidité qui fera ensuite de l’auteur l’une des cibles préférée du FBI.
 Ce gamin, c’était Gil Scott-Heron. Poète, pianiste, chanteur au carrefour de la Soul et du Rap étroitement lié à l’histoire du mouvement noir de ces trente dernières années et auquel on doit Spirits, album sorti en 1994. La carrière du musicien éclipsa le talent du romancier. Cet acharné devait mourir en mai 2011. Longue vie à ses textes. La bibliothèque dont il est ressorti restera finalement bien au chaud avant d’être donnée plutôt que de se vendre. Ce premier roman est à la hauteur des grands classiques du genre. Il se nomme Le Vautour, et il ouvre l’année.
Ce gamin, c’était Gil Scott-Heron. Poète, pianiste, chanteur au carrefour de la Soul et du Rap étroitement lié à l’histoire du mouvement noir de ces trente dernières années et auquel on doit Spirits, album sorti en 1994. La carrière du musicien éclipsa le talent du romancier. Cet acharné devait mourir en mai 2011. Longue vie à ses textes. La bibliothèque dont il est ressorti restera finalement bien au chaud avant d’être donnée plutôt que de se vendre. Ce premier roman est à la hauteur des grands classiques du genre. Il se nomme Le Vautour, et il ouvre l’année.
Lionel Besnier
Le genre idéal
Le Vautour de Gil Scott-Heron, traduit de l’américain par Jean-François Ménard, Éditions de l’Olivier, coll. Soul Fiction (1998) et Points Seuil (2007).
[print_link]



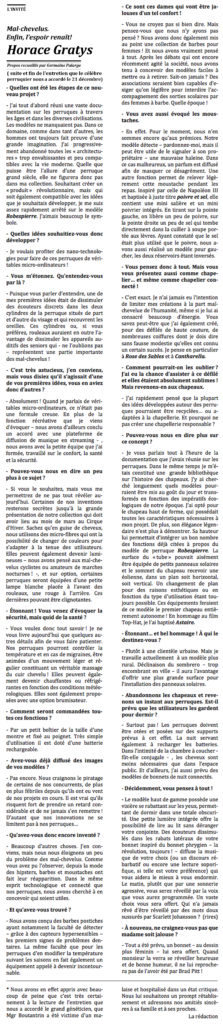



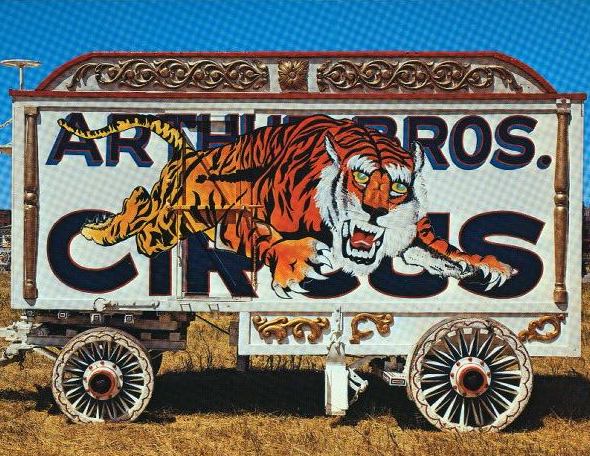

0 commentaires