Aimer les trams. Tramways du passé, celui nommé Désir ou le “fatidique” de Claude Simon. Ceux qui ont eu leur âge d’or puis ont été bannis. Ceux qui n’ont jamais disparu. Et ceux qui ont ressurgi récemment. Des architectes roulants qui retracent la ville, de lents paysages à eux-seuls.
Bien avant qu’ils ne redeviennent les vecteurs roulants des récents réaménagements urbains, il y a eu des trams partout. À New York, où John Stevenson crée en 1832 la première ligne tirée à cheval, de Manhattan à Harlem. En France, en 1838, le tramway roule en pionnier dans la Loire, de Montrond-les-Bains à Montbrison. Il ne déboule vraiment à Paris qu’à partir de 1870. De San Francisco à Sarajevo, de Montréal à Saïgon, il devient le principal moyen de transport urbain et même interurbain. Il est hippomobile, puis à vapeur, puis à l’électricité… puis dépassé.
Dans un documentaire des années 1930, en effet, on voit bien qu’à Paris le tram était complètement piégé par la circulation, créant des embouteillages. Rien de spécifique n’avait été pensé pour lui, il ne luttait au départ qu’avec des charrettes. Mais ces trams publics vont vite se faire courser par la séduisante automobile particulière. Ils commencent à disparaître en France, à partir de 1938. Dans les années 50 et 60, ils sont jugées archaïques, mal entretenus, maladroits. Plus assez « modernes ». Ces ringards sont rejetés, à quelques exceptions près comme Lille-Roubaix-Tourcoing, Marseille et Saint-Étienne. Le tout automobile pompidolien, les autoroutes, les autobus, les métros, les RER, devenus plus performants, les ont renvoyés dans des dépôts ou à la casse. On arrache les rails du bitume. Des morceaux de rails subsistent ici ou là, tristes empreintes de leur âge d’or.
Mais ils roulaient, impériaux, dans nos mémoires. Dessinant des villes chaotiques de leurs silhouettes spécifiques, leurs rails, leurs câbles, leurs emmêlements avec les voitures. Ils ont bien résisté dans certains pays. Et c’était délicieux de croiser ces irréductibles à l’étranger. Sur les pavés griffés de rails de Milan, ville qui ne les a jamais bannis depuis 1876, en choper un vieux orange, déguster sa lenteur brinquebalante, ses cris métalliques, ses tintements de cloche, lui qui permet de sinuer dans la ville, de s’y situer, de relier la Stazione Centrale à la Via Manzoni. Faire attention en traversant de ne pas se faire heurter par ces rames un peu inertes. Sursauter en se faisant sonner la cloche. Et on en attrapait un autre jaune, un grimpeur, le 28 à Lisbonne, pour monter si lentement, comme en déséquilibre, à l’assaut du quartier de l’Alfama. Un autre passait à Lodz en Pologne, archaïque rame rouge et jaune d’une Europe de l’Est à la marge, comme sorti de la guerre froide !

Lisbonne (photo DR)
Ces fantômes du passé ont joué de petits rôles dans le cinéma et la littérature. Loin d’être aussi glorifiés que le train ! Leur lenteur, leur disparition leur a donné des rôles plus ténus, mélancoliques peut-être. À Lodz, en 1966, alors qu’il était étudiant à l’école de cinéma, le réalisateur polonais Krzysztof Kieślowski réalise Le Tramway, un court métrage muet. Un garçon aperçoit une fille dans un tram… il court après… se retrouve seul avec elle… elle s’endort, le garçon descend… et décide… de courir après le tram. Un transport passeur d’amour impossible.
Un tram fut même nommé Désir, en 1947, comme celui, infernal, qui fait trembler les maisons de la rue Desire à La Nouvelle-Orléans, dans la pièce de théâtre de Tennessee Williams, puis dans le film d’Elia Kazan. Son irruption violente, régulière et inexorable, exacerbe le délabrement de l’appartement où vivent Blanche, Stella et Stanley. Il mugit comme le blues du Vieux Carré, quartier en plein dislocation. Son surgissement brutal scande la tragédie violente que vivent les personnages. Le tramway, entre « attention danger » et « attention désir » ! Aux noms de Desire et Cemeteries, en passant par la rue Elysian Fields, les tramways cheminent du désir impossible à la mort certaine.
 Dans On a volé un tram, petit film mexicain de Luis Buñuel, un autre tram s’en va à la casse en 1954. Mais avant, deux employés de la Compagnie des transports de Mexico, qui venaient juste de le réparer, lui font faire un dernier voyage. Cette petite comédie mordante se promène dans la vie à Mexico, moque l’administration, l’inflation, la corruption…
Dans On a volé un tram, petit film mexicain de Luis Buñuel, un autre tram s’en va à la casse en 1954. Mais avant, deux employés de la Compagnie des transports de Mexico, qui venaient juste de le réparer, lui font faire un dernier voyage. Cette petite comédie mordante se promène dans la vie à Mexico, moque l’administration, l’inflation, la corruption…
Le tram est encore regretté par le sombre passéiste Céline, dans Mort à crédit : « Destinée ou pas, on en prend marre de vieillir, de voir changer les maisons, les numéros, les tramways et les gens de coiffure, autour de son existence… Je ne veux plus changer. J’aurais bien des choses à me plaindre mais je suis marié avec elles… »
Mais celui qui nous fait vraiment monter à bord d’un tramway, vers 1918, c’est Claude Simon. En 2001, il reprend le train de ses souvenirs. Ce « fatidique tramway » de quatre heures, qui reliait la « place à ragots » de Perpignan à la plage de Canet… Que petit garçon il avait si peur de rater, de voir « s’escamoter » avec « une sorte de ricanement moqueur et méchant ». Il pouvait monter en privilégié dans la « prestigieuse » cabine peinte en jaune d’un conducteur taciturne, ce wattman mégot collé à ses lèvres. Ou il s’asseyait sur les banquettes en bois ; passait le receveur avec ses tickets bariolés – pourpre, indigo, outremer, cadmium. Un trajet de 15 kilomètres, aller et retour, qui conduisait et reconduisait sa petite enfance. Défilent la façade rococo d’un cinéma, les panneaux publicitaires Suze ou BYRRH, « un paysage légèrement bosselé aux pentes recouvertes de vignes », d’opulentes résidences à créneaux, dont la villa « Joué », des pins somnolents… jusqu’au terminus, où les rails couverts de rouille disparaissaient sous le sable. Près de la plage populaire « Mondaine » avec ses musiques de bastringues, le bruit frais des vagues. Claude Simon nous entraîne dans un collage d’images, qui se meut au ralenti, s’arrête, accélère au fil de tous les signes de la ville d’alors, empruntant de nombreuses correspondances avec sa propre vie. De l’école à l’hôpital. Un tramway nommé littérature.
Après être devenus folklos, restaurés comme à San Francisco sur Market Street, ou transformés en trains-trains vernaculaires à touristes, les trams sont revenus ! Dès les années 1970, les élus aux prises avec toutes les congestions urbaines repensent à eux. Dans un revirement paradoxal, ce vieux tram (renvoyé trop vite ?) ne pouvait-il pas d’un seul coup lutter contre la multiplication des automobiles, détrôner le métro claustro-boulot-dodo, devenir écolo à l’air libre, moins bruyant, et créer de nouvelles mobilités reliées entre elles ? Déclarés d’utilité publique, ces revenants vont retrouver la lumière du jour. En 1985, Nantes est la première ville française à le réadopter, suivie de Grenoble, de Strasbourg… Les controverses vont toujours bon train, les nuisances ne manquent pas lors des longs travaux qu’ils nécessitent… Mais ils serpentent de plus en plus dans les villes de France, de Strasbourg à Nice, d’Orléans à Bordeaux…

Bordeaux (photo DR)
Ils ont bien changé, ces nouveaux héros contemporains ! Circulation en site propre, allée verte engazonnée, lenteur moyenne de 15 à 18 km à l’heure, fonctionnement à l’électricité… Ils exigent une large travée, ils réorganisent complètement l’urbanisme, créent des liens fluides de gares à banlieues. Ils se ressemblent tous, ces sobres Tramways français standard (TFS) fabriqués par Alstom, ces citadins à plancher bas, aux modules standardisés. Seuls peuvent différer leurs nez ; celui de Bordeaux a été voulu « accueillant », en « forme de sourire vu de devant ». Les vitrages latéraux de sa cabine de conduite sont « comme de grands yeux en amande ».
Ils adoptent aussi des déguisements décoratifs spécifiques, ces signaux qui identifient une cité aussi bien qu’un monument. On les voit même circuler sur des cartes postales. Ils sont devenus d’excellents agents de la communication politique des cités. Prenons ceux de Bordeaux encore, ils sont bleus, le code-couleur de la ville évoquant le fleuve. Mâts, barrières, potelets, corbeilles et abris ont été dessinés par l’architecte Élizabeth de Portzamparc. Ils ont tous leurs décors extérieurs et intérieurs bien à eux, leurs architectes, leurs artistes qui ponctuent leurs parcours de leurs œuvres plastiques, sonores et littéraires. À Montpellier, ils ont arboré les hirondelles des designers Garouste et Bonetti, les fleurs multicolores du couturier arlésien Christian Lacroix. À Reims, ils évoquent des flûtes de champagne ; à Orléans, ils se parent de la teinte sable de Loire; et ils jouent d’un effet miroir à Tours.

Reims (photo Lunon92)
À Strasbourg, c’est l’architecte Zaha Hadid qui a conçu la station Hœnheim Gare, l’un des terminus de la ligne B en 2000. Un étonnant auvent en béton brut, radical, plié comme une feuille de papier, soutenu par 44 poteaux disposés irrégulièrement, avec des inclinaisons obliques différentes. À Nice, le tramway a entraîné un autre chambardement. Car ce n’est pas un simple décor, ou un simple bâtiment qu’a créé Marc Barani en 2008, avec la gare des tramways. Au nord de la ville, entre montagne et mer, dans la pente, il fallait insérer un pôle multimodal, coincé entre barres d’habitation et nœud autoroutier. Un site trop petit, que l’architecte a su élargir en un territoire plus vaste pour remodeler à plus grande échelle la ville et le paysage. Le tram se fait architecte. Et devient lui-même un paysage entier, nouveau, mouvant.

Hœnheim Gare (photo Philip Schäfer)
Les trams ont aussi regagné la région parisienne ! Par la banlieue d’abord, une première ligne renaît en 1992 entre Saint-Denis et Bobigny. À partir de 2006, le T3 a été mis en service à Paris. À Paris ? Non, il n’a pas droit de cité dans le centre ! Il ne fait qu’une partie du tour de la capitale, sur les Maréchaux. Du pont du Garigliano à la porte de Vincennes, puis de la porte de Vincennes à La Chapelle. La prolongation jusqu’à la porte d’Asnières est prévue pour la fin 2018. Une boucle presque totale, autour de Paris, de porte en porte, déjà tournée vers le Grand Paris.
Anne-Marie Fèvre
Un tramway renommé Désir



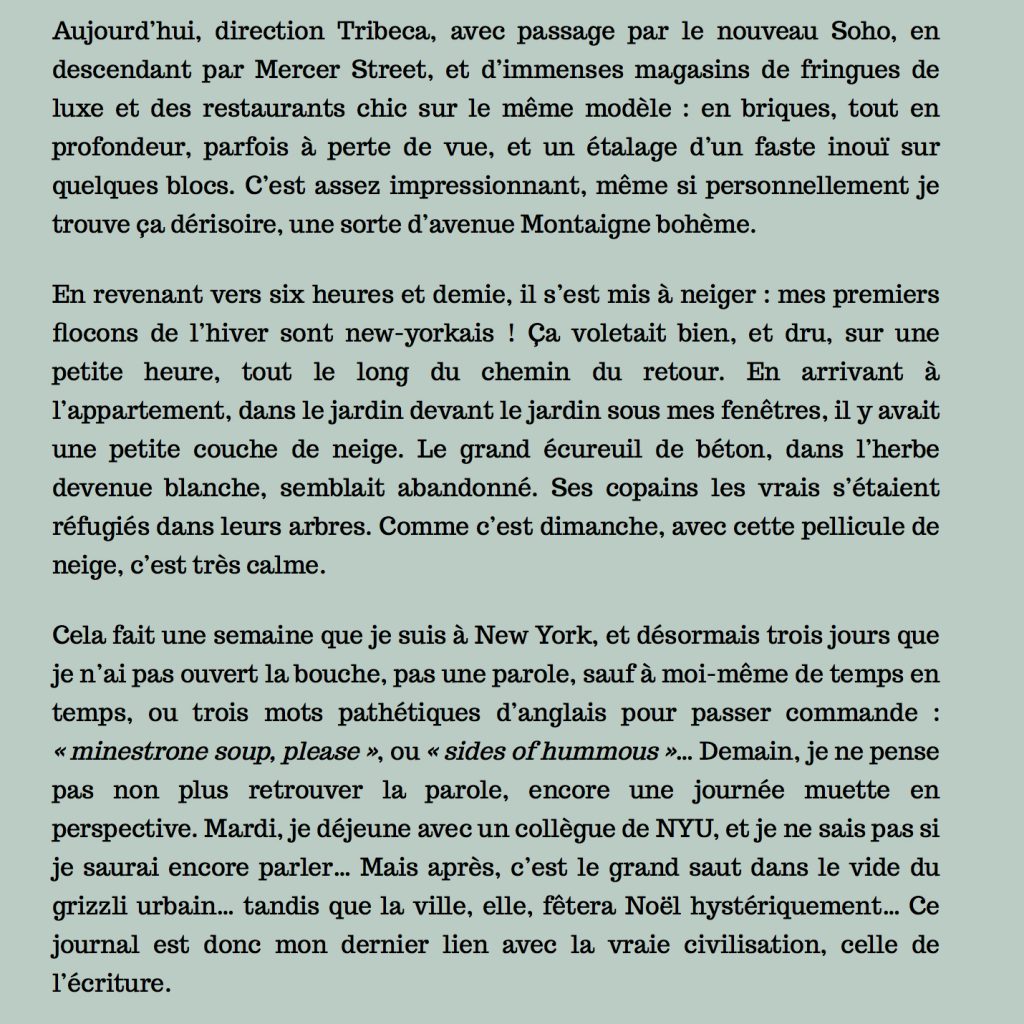



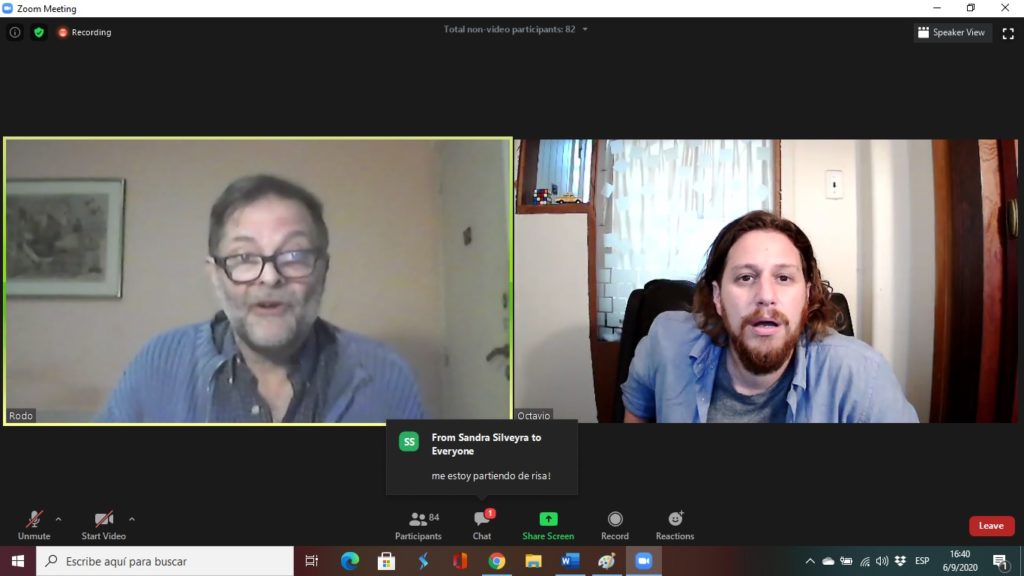

0 commentaires