Des ordonnances littéraires destinées à des patients choisis en toute liberté et qui n’ont en commun que le fait de n’avoir rien demandé.
En ce début de mois d’août, entre le grand vide généré par les départs en hordes de celles et ceux qui profitent de deux ou trois de leurs cinq semaines de congés généreusement payés depuis que des « preneurs en otage » ont décidé de terroriser la France un certain printemps d’une certaine année trente, sans même parler de nos cher.e.s co-fonctionnaires, les enseignant.e.s, qui vont pouvoir profiter de leurs cinquante-cinquième semaine de vacances de l’année, et le trop plein de marronniers médiatiques arrosés à coup de « chassés-croisés-soyez-matinaux » ou de « mille quatre cent cinquante-trois conseils pour vous rafraîchir » ; dans ce contexte estival, donc, je médite, allongée dans un hamac thaïlandais en lamelles de bois que le Dr P. a pu suspendre je-ne-sais-comment-mais-ses-talents-sont-insoupçonnables entre deux de ses plantes que j’appelle des arbres, sur notre moyennement triste sort à nous, les doctoresses du service de médecine littéraire, toujours sur le pont, toujours sur le front. Marcel est parti, lui, se reposer quelques semaines dans le Quercy. Il n’est pas remplacé, bien sûr, il eût été dommage que les urgences ne ressemblassent pas au Péage de Saint-Arnoult un samedi du mois d’août à 14h. Cette tension constante du sous-effectif permanent, pensée et voulue par celles et ceux qui ont la prétention de « nous » gouverner, m’inquiétait néanmoins à mesure que je voyais le mercure rouge du thermomètre, que je ne quittais pas des yeux, s’étirer par le haut. Nous avons des patient.e.s fragiles : Nadine M., Christine B., Babar ou les commentateurs du Figaro pourront-ils résister à un coup de chaud ? Alors que j’en arrivais à la conclusion qu’il y aurait des pertes moins lourdes (pardon, moins graves, malgré le traitement du Dr R., je fais des rechutes de grossophobie) que d’autres, j’entendis mes consœurs m’enjoindre de venir prestement à l’accueil, déserté lui aussi en raison de l’épidémie de grandes vacances.
La scène qui s’offrit alors à moi était d’une cocasserie délicieuse : le Dr R. et le Dr P. se trouvaient toutes les deux debout, armées d’équerres et d’un mètre ruban, face à un petit patient qu’une protubérance corporelle particulièrement impressionnante (nasale, précisons-le d’emblée pour les esprits mal placés) empêchait de franchir la porte. Après avoir calculé l’angle d’inclinaison nécessaire, nous décidâmes de manipuler le fragile patient nous-mêmes : le Dr P. lui saisit délicatement les pieds, je pris ses petites mains dans les miennes et le Dr R. assura la culbute par la taille. Nous parvînmes ainsi à installer Pinocchio, puisqu’il s’agissait de lui, dans une salle suffisamment grande et menâmes ensemble la consultation.
Le malade était inquiet car, depuis quelques semaines, il ne parvenait plus à réfréner ses mensonges qui devenaient de plus en plus régulièrement paroxystiques au cours de crises de moins en moins discrètes. Blondement mêché, il avait par exemple affirmé que les services secrets de son pays se fourvoyaient en accusant d’ingérence dans l’obscur jeu électoral qui l’avait mené là où il était, dans une belle maison toute blanche, le chef d’une autre communauté, le Général Palpoutine. Le Dr R. prit des notes et commençait à envisager un traitement opératique, un petit Tancredi, deux fois par jour peut-être. Nous poursuivîmes le bilan clinique. Une autre crise, encore plus spectaculaire, avait secoué notre ami de bois quelques jours après seulement. Alors qu’une assemblée réunie dans le Château Bourbon lui demandait de manière insistante s’il connaissait Nelson Muntz, la brute de la cour d’école de Bart et Lisa Simpson, qui s’amusait à rosser les gens venus s’aérer dans les rues un jour férié de mai et qui aimait à jouer au gendarme (moins à celui de Saint-Tropez, toujours très en vue à cette période de l’année, qu’à celui de Guignol), Pinocchio ne put s’empêcher de répondre, contre toute évidence, qu’il ne savait pas, qu’il ne savait rien, qu’il n’était pas au courant et que s’il avait fait un gros câlin à Nelson (pour le féliciter, peut-être de ses talents d’observateur éclairé), c’était uniquement parce qu’il avait « coutume d’être urbain ». Alors, évidemment, le nez de Pinocchio s’était beaucoup, beaucoup allongé ces derniers temps, au point d’en devenir un véritable handicap.  Avec la mesure qu’on lui connaît et dont elle ne se dépare jamais, le Dr P. suggéra de couper l’appendice nasal de notre patient. Je craignais pour ma part que cette solution trop radicale ne fît que traiter le symptôme et non le mal et je gardais en tête l’une des évolutions majeures de la pathologie, à savoir la transformation totale du patient en âne. Je suggérais ainsi une méthode plus douce, presque homéopathique, à savoir la lecture, à raison de dix pages par jour (cinq le matin, cinq le soir), du fabuleux « roman » de l’Argentin Ariel Magnus, Une partie d’échecs avec mon grand-père, traduit de l’espagnol par Serge Mestre (éditions Rivages).
Avec la mesure qu’on lui connaît et dont elle ne se dépare jamais, le Dr P. suggéra de couper l’appendice nasal de notre patient. Je craignais pour ma part que cette solution trop radicale ne fît que traiter le symptôme et non le mal et je gardais en tête l’une des évolutions majeures de la pathologie, à savoir la transformation totale du patient en âne. Je suggérais ainsi une méthode plus douce, presque homéopathique, à savoir la lecture, à raison de dix pages par jour (cinq le matin, cinq le soir), du fabuleux « roman » de l’Argentin Ariel Magnus, Une partie d’échecs avec mon grand-père, traduit de l’espagnol par Serge Mestre (éditions Rivages).
Pris entre réalité et fiction, sans que l’on ne sache réellement laquelle est laquelle, l’auteur y raconte l’histoire (ré)inventée de son grand-père, exilé juif allemand qui trouva avec sa famille refuge en Argentine alors que le régime national-socialiste durcissait sa politique envers les juifs.
Notre patient y trouvera plusieurs personnages palliatifs à son état chronique qui se croisent épisodiquement à l’occasion de la huitième olympiade d’échecs qui se tint (réellement) dans la capitale argentine en septembre 1939 alors même que débutait en Europe une autre partie mondiale bien moins engageante. On croise donc le vrai faux (ou le faux vrai) « héros » du roman et grand-père de l’auteur, Heinz Magnus, mais aussi une joueuse d’échecs allemande, un journaliste juif préférant la boxe, des anarchistes aux grands discours qui ne se croisent qu’à la faveur d’un bar ouvert proposant la Quilmes à des prix raisonnables, Mirko Czentovic, le joueur d’échecs de Stefan Zweig, l’une des (nombreuses) œuvres auxquelles le roman fait référence, mais aussi le lecteur- qui s’indigne que le livre aille « contre toutes les règles du jeu romanesque » – et l’auteur qui dialogue régulièrement avec son grand-père sur le sens de sa vie, de ses (non) engagements et même sur le sens du roman qu’il écrit.
Tou.te.s sont coincé.e.s dans cet espace liminaire de la fiction « qui appartient à un monde différent de la réalité », et tou.te.s usent de petits ou grands mensonges, l’un pour sauver sa vie et celle des siens en se déclarant catholique, l’autre pour conquérir une femme ou pour arranger une partie. Tou.te.s sont des « personnages de Dieu », se mouvant sur l’échiquier de la vie, quitte à transcender leur propre réalité. Ils vont ainsi, ensemble ou séparément et pour des raisons aussi diverses qu’ils le sont eux-mêmes, chercher à changer le résultat attendu de ce tournoi d’échecs en faisant perdre l’Allemagne, qui vient d’envahir la Pologne, pays candidat sérieux au titre, afin d’envoyer au monde et aux belligérants un message fort. Le protocole de soins et le secret professionnel auxquels nous sommes tenues nous interdit ici de dévoiler les issues réelles et fictives de l’argument.
Tout comme ces personnages, notre patient trouvera ainsi dans le remède proposé un principe actif particulièrement efficace qui lui permettra de se distancier de ses mensonges, car « comme tout bon personnage », il apprendra à « se méfi[er] de la fiction », y compris de la sienne. À défaut d’une rémission totale, nous espérons sincèrement que notre patient puisse au moins mettre ses mensonges au service d’une réelle fiction, pour le bien commun.
Dans l’attente d’une amélioration nette de son état, nous prîmes la décision de placer Pinocchio sous observation, dans la même chambre que Nadine M. dont nous espérions secrètement qu’elle puisse devenir un personnage de la fiction qu’il pourrait ainsi créer.
À l’issue de la consultation, le Dr P. s’en alla arroser ses plantes vertes, le Dr R. reprit sa consultation avec sa patiente préférée et je m’en retournai méditer dans mon hamac, prise soudain d’un étrange questionnement : et si nous étions, nous aussi, des personnages de fiction ? Je pourrais être joueuse d’échecs en 1938, danseuse folle au seizième siècle, et peut-être même médecin !
Katell Brestic
Ordonnances littéraires




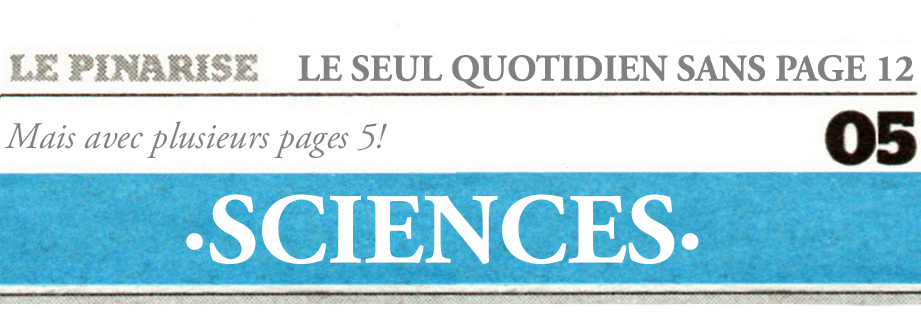




0 commentaires