Quelle ne fut pas ma surprise en ouvrant la lettre de Descartes à la Princesse Élisabeth de découvrir enchâssée dans les plis de celle-ci une seconde lettre. Je crus d’abord à un doublon avant de m’apercevoir que ni le propos ni le ton n’étaient de l’auteur du Discours de la méthode. La signature de Baruch Spinoza en bas de la seconde page m’éclaira aussitôt. Écrite en néerlandais, la lette est adressée à ce qui semble être une jeune fille de la bourgeoisie d’Amsterdam. Son nom n’est pas identifiable. Spinoza se contente d’un R énigmatique. Il en va d’ailleurs de même des différentes personnes citées dans ces lignes. Quoiqu’il en soit, cette missive surprendra peut-être. On y voit un philosophe aux prises avec une passion qu’il tente de réfuter. On comprendra pourquoi cette lettre n’a jamais été publiée dans les œuvres complètes de l’auteur de l’Éthique.
A R***,
Mademoiselle, j’ai reçu la semaine dernière une nouvelle lettre de votre part, la vingt-deuxième si je compte bien, et vous ne sauriez imaginer à quel point la violence de la passion qui s’y exprime me cause de l’embarras. Sans doute celle-ci ne m’est pas apparue clairement dans vos premiers envois, auxquels j’ai eu la bonté mais aussi la faiblesse de bien vouloir répondre. Il est vrai que l’intérêt que vous me disiez porter à mon Traité théologico-politique me flattait. J’aime voir l’esprit s’élever au-dessus des craintes superstitieuses et votre liberté de ton m’a d’abord charmé. Mais après avoir lu avec soin votre douzième lettre, j’ai compris que cet intérêt que vous dites nourrir pour ma philosophie n’était qu’un prétexte pour me faire entrer dans vos vues. Je vous l’ai marqué dans une réponse que j’ai argumentée more geometrico, mais force m’a été de constater que vous n’entendez rien à la mathématique. Sans doute comprenez-vous bien la nécessité de séparer les pouvoirs politique et théologique, mais vous ne savez pas comment suivre les démonstrations qui sont pourtant les yeux de l’âme. Il est vrai que vos dix-huit ans vous valent mon indulgence. Vous avez encore tant à apprendre. Pensez bien qu’il faut chaque jour exercer votre entendement si vous désirez progresser dans votre entreprise de libération que je ne saurais que trop encourager. Mais je reviens à mon propos.
Dans une de vos lettres, vous me rétorquez que ce ne sont de ma part que des arguties, des lubies de philosophe peu habitué au commerce du beau sexe. Les mathématiques, dites-vous, ne sont pas tout. Je vous l’accorde volontiers. Pourtant vous convenez avec moi, dans votre vingtième lettre, que mon Traité n’entre que pour partie dans l’amour que vous me portez. Une certaine ressemblance, dites-vous, entre mon portrait (je ne sais d’ailleurs trop comment vous vous l’êtes procuré) et le visage d’un homme que vous avez autrefois adoré à la folie serait la cause véritable de votre passion. Ce qui, soit dit en passant, n’est guère flatteur ni pour mon Traité ni pour ma personne quoique j’en fasse peu de cas. Pire vous vous réclamez de ma philosophie pour retourner contre moi un de mes principes selon lequel seule une affection de même puissance peut vaincre une affection contraire. Vous ne me désirez en somme que pour chasser un désir plus ancien. Je dois reconnaître que vous raisonnez bien. En effet par cela seul que nous imaginons qu’une chose a quelque trait de ressemblance avec un objet affectant habituellement l’Âme de joie ou de tristesse, nous aimerons cette chose ou l’aurons en haine. Je ne blâme donc pas votre passion que seule la nature de vos affections vous inspire : je voudrais seulement en détourner le cours.
Je vous cède qu’un traité de philosophie, fût-il de la meilleure eau, ne pourra jamais remplacer un plaisir charnel. Les idées ont leur ordre, le corps a le sien et ces deux ordres marchent rarement main dans la main. Je parle bien sûr des idées de la Raison et non des opinions de notre cerveau qui sont, elles, en tous points en parfait accord avec les mouvements de notre corps. Vous semblez être une personne instruite et très au fait de mes pensées : je ne vous rappellerai donc pas comment ce qui se passe dans le corps se retrouve dans notre tête. Vous savez à quel point je juge ridicule la doctrine de Descartes qui a cru un peu vite et sottement que l’âme et le corps étaient deux substances distinctes. Comme si nous étions seulement des substances ! Mais vous savez cela aussi et vous me l’écrivez fort joliment dans votre quinzième lettre. Vous tirez cependant de cette vérité une conclusion hâtive. Parce que je ne suis pas une substance, vous arguez que je ne saurais être insensible à vos charmes. J’admets sans doute, puisqu’il faut bien en convenir sous peine de revêtir l’habit honni des prêtres en tous genres, que mes sens ont été remués par le tableau que vous me fîtes parvenir à grand frais il y a quatre semaines. Votre teint pâle, la générosité de vos chairs, l’ampleur de votre poitrine encore si ferme ont fait trembler mes mains quand je polissais mes lentilles. Je suis heureusement parvenu à chasser cette idée confuse de mon esprit grâce à un raisonnement dont je vous fais grâce. Mais je m’échauffe en me rappelant les détails de votre anatomie et je perds de vue le but que je poursuis dans cette lettre qui sera, je l’espère, la dernière.
Mon refus de vouloir vous rencontrer lors de votre venue à Voorburg vous a mise au désespoir, me dites-vous. Sachez cependant que ce refus m’a de mon côté mis au supplice. Vous m’accusez de m’opposer à votre béatitude dont il ne vous a pas échappé qu’elle est la fin de toute ma philosophie. Enfin, faute de la trouver dans mes bras, vous me mandez un moyen d’atteindre la béatitude qui ne soit pas hors de votre portée. Vous désirez, si je vous lis bien, un bonheur un peu plus rapide et plus commode que celui que promettent la plupart des philosophes pour lesquels il semble qu’il faille être sur le point de mourir pour entrevoir comme la lueur du jour. Chère enfant, je ne puis vous donner tort sur ce point : les philosophes ont écrits tant de sornettes sur le souverain bien ! Mais c’est assez sur ce sujet. J’en viens aux faits.
Pas plus que moi, Mademoiselle, vous n’êtes une substance. En vous, tout dépend de ce qui existe dans la nature. Vous n’êtes pas un empire dans un empire. Dans mon système, j’ai donné le nom de mode aux êtres qui existent individuellement. Or un mode est nécessairement limité par un autre mode. Les êtres ont donc nécessairement des rapports de toutes sortes entre eux, des rapports qui ne peuvent manquer de les affecter et de causer chez eux des idées inadéquates. Ainsi de ce grand amour d’enfance dont je ne suis que la reprise. Vous désirez de moi ce qu’il n’a pu vous donnez, à moins qu’il ne vous l’ait donné à votre corps défendant, si je lis bien entre vos lignes. Mais puisqu’il est entendu que vous n’obtiendrez rien de moi, songez que je vais bientôt avoir quarante ans et que je pourrais être votre père, il me faut vous proposer un moyen de vous sortir de ce mauvais pas. Et c’est là où mon système de la nature montre toute son utilité.
Je ne vous recommande pas de renoncer à toute forme d’affection, la chose est du reste impossible, mais de les multiplier de sorte que la puissance de ces affections ajoutées les unes aux autres en viennent à contrebalancer cette passion si vive qui me vaut tant de lettres de votre part. Et voici comment.
Il existe à Amsterdam, dans le quartier du Voorburgwal, une maison particulière facile à repérer car elle est signalée par une lanterne rouge. Vous y trouverez bonne chère et bonne compagnie. L’endroit est fréquenté par des personnes de rang, comme le duc de M***. Là vous vous présenterez en vous recommandant de moi. J’étais dans ma jeunesse passablement connu dans cette maison. La patronne que je sais être toujours aux commandes de cet établissement se souvient sans aucun doute des soirées que nous avons passées ensemble : elle vous ouvrira et vous fera bon accueil. Une pinte de bière et un verre de genièvre vous seront servis afin de vous mettre à votre aise. Il y a dans la pièce principale un âtre qui chauffe assez pour cuire dix poulardes. Ne soyez pas surprise par les offres qui vous seront faites. Sachez qu’il n’est plus temps maintenant de faire l’enfant. Mme de *** vous proposera de vous déshabiller : on cause mieux quand on est dans le plus simple appareil. Les impressions sont plus vives si les corps peuvent entrer directement en contact les uns avec les autres. Or c’est bien d’affections puissantes dont vous avez le plus besoin. C’est d’ailleurs dans cette tenue naturelle que vous trouverez la plupart des commensaux. Vous seriez gênée de ne pas vous mettre à l’unisson. Un baiser vous sera donné, puis deux, et encore un troisième. Telle est la coutume de la maison. On n’y est pas comme chez Descartes, seul dans un poële. Vous serez impressionnée par tant de faveurs. Vous vous amadouerez. Un homme, le comte de V*** peut-être, vous proposera de le pomper. C’est un homme charmant, philosophe à ses heures et fort bien pourvu. Ne lui résistez pas car il déteste qu’on se refuse à lui. Répétez-vous seulement : je ne suis pas une substance mais un mode ouvert à tous les autres modes. Répétez-vous ce principe autant de fois qu’un homme ou une femme vous proposera de vous doigter. Quand enfin vous sentirez qu’on vous fout par devant comme par derrière, vous serez prise d’une émotion si vive que vous comprendrez peut-être ce que j’ai voulu dire en affirmant que Dieu ou la nature, c’est exactement la même chose. Vous découvrirez alors que le souverain bien n’est pas aussi difficile à atteindre qu’ont pu le prétendre Platon, Aristote et tant d’autres. Sachez bien que seule une farouche et triste superstition nous interdit de prendre du plaisir.
Et puis, charmante enfant, vous m’oublierez. Vous m’oubliez d’autant plus vite que vous retournerez probablement dès le lendemain dans cette charmante maison dont vous deviendrez vite une habituée. L’idée de m’écrire ne serait-ce que quelques mots en hâte vous paraîtra alors aussi saugrenue que vaine.
Votre Baruch.






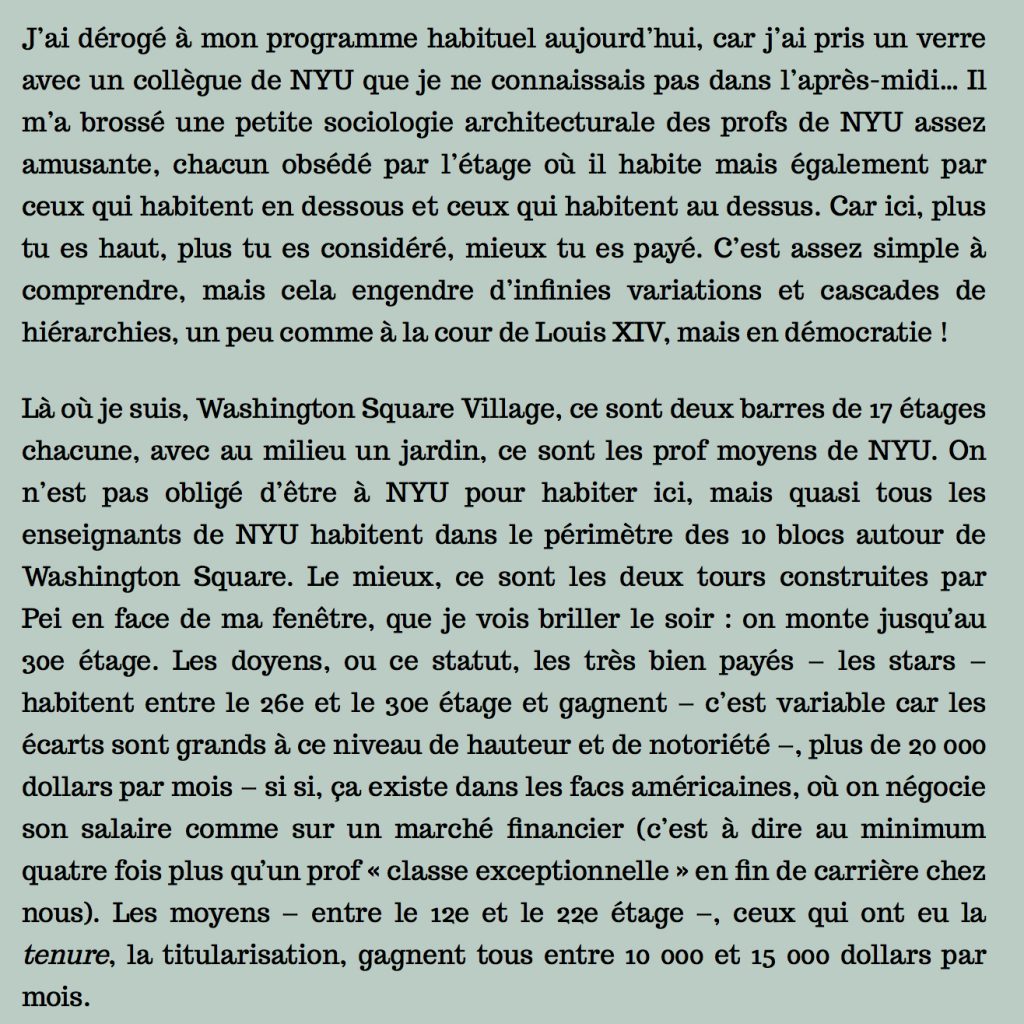

Une bonne blague, mais il est loin d’être critique d’imprimer des lettres fictives… Voulez-vous accomplir quelque chose avec cela, M. Pétel, ou était-ce juste un passe-temps de bricoler cette lettre?