Andy Warhol… Avec le nom, le sentiment d’une œuvre que l’on connaîtrait déjà. Un kaléidoscope de rose, vert, jaune, noir, bleu. Une panoplie d’images ultra efficaces inlassablement répétées (des fleurs, des vaches, le visage de Marilyn, celui de Jackie Kennedy, ou celui de Mao, ou encore celui de Warhol lui-même). Une recherche d’iconicité et de superficialité. “If you want to know about Andy Warhol, just look at the surface of my paintings and films and me, and there I am. There’s nothing behind it”, dit un jour Warhol. (“Si vous voulez connaître Andy Warhol, regardez à la surface de mes peintures et de mes films. Me voilà. Il n’y a rien derrière.”)
Andy Warhol… Un nom qui fait “pop”, cette compression de “populaire”, tout aussi efficace qu’une onomatopée de comics et qui servit de qualificatif pour tout une partie de l’art de la deuxième moitié du XXe, le sauvant de justesse des griffes de tous les -ismes qui avaient jusqu’alors monopolisé la taxinomie de l’histoire de l’art : impressionnisme, pointillisme, fauvisme, cubisme, surréalisme, expressionnisme (abstrait), minimalisme et, soudain, POP ! Le terme est si génial que, depuis 1955, il court toujours et se trouve aujourd’hui associé au succès de Jeff Koons ou de Takeshi Murakami.
Andy Warhol… Le nom a beaucoup résonné en 2015. Il a surgi à Metz d’abord, au Centre Pompidou, avec “Warhol Underground”, exposition d’Emma Lavigne dans laquelle le Warhol peintre s’effaçait pour laisser passer sur le devant de la scène le Warhol de la Factory, celui qui créa et filma les “Superstars”, produisit le Velvet Underground, et scénographia pour eux les concerts-happenings du Exploding Plastic Inevitable. Le nom fut ensuite repris par le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, pour l’exposition de Sébastien Gokalp et Hervé Vanel, “Warhol Unlimited” (jusqu’au 7 février 2016). Le clou de l’exposition, se trouve dans l’ultime salle de l’exposition où les cent-deux toiles de la série Shadows sont accrochées en bandeau continu. Mais l’exposition présente aussi – outre quantité de sérigraphies – les Silver Clouds, des films d’Exploding Plastic Inevitable, une série de Screen Tests ou encore le film Empire, sommet de l’immobile au cinéma. Le nom d’Andy Warhol s’entend aussi de l’autre côté du parvis du Musée d’Art moderne, au Palais de Tokyo, où il résonne discrètement entres les murs de l’exposition “Ugo Rondinone : I ♥ JOHN GIORNO” (jusqu’au 10 janvier 2016), exposition pour laquelle on s’est déjà enthousiasmé dans ces colonnes. Warhol, fut admirateur, amant et metteur en scène de John Giorno. Giorno est l’homme qui dort de Sleep (présenté au Palais de Tokyo), mais il apparaît aussi – sculptural à en couper le souffle – dans un des Screen tests montrés au Musée d’Art moderne.
Outre l’anglais de leurs titres, “Warhol Underground” et “Warhol Unlimited” partagent un point commun : celui de ne pas se contenter d’accrocher des “petits carrés” sur des murs blancs pour faire exposition (selon l’expression même de Warhol, placée en exergue de l’exposition du Musée d’Art moderne). L’un et l’autre proposent un parti pris audacieux qui jette sur l’œuvre de Warhol une lumière autre et vivifiante.
Dans l’exposition de Metz, le projecteur glissait depuis Andy Warhol, l’individu, vers un Andy Warhol pris dans l’univers collectif de la Factory, rappelant combien ce lieu et ses occupants furent consubstantiels de l’œuvre de Warhol. On entrait dans une salle d’exposition aux murs couverts d’aluminium, à l’instar de l’immense loft de la 47ème rue où Warhol travaillait et vivait en compagnie d’un groupe mouvant d’amis, d’aspirants-stars, d’admirateurs, de curieux, etc. Mais le choix de couvrir d’argent les murs de l’exposition ne répondait pas uniquement à un projet de reconstitution. Luisants, les murs cessaient d’être cantonnés à une fonction de supports et d’intervalles. Ils appelaient l’attention à eux. L’espace répondait aux œuvres, les poursuivait, devenait leur miroir et non pas leur contour indifférent. Au long du parcours, l’exposition jouait d’effets de continuités et de recouvrements, empêchait d’établir de nettes frontières entre telle section ou telle autre, entre tel médium et tel autre – photographie, vidéo, danse ou encore musique – restituant la porosité de l’univers artistique d’Andy Warhol. Et surtout, l’exposition était bruyante : bandes-son de vidéos, tubes du Velvet Underground, ou captations du Exploding Plastic Inevitable, doublaient l’espace visuel d’un espace sonore. Or travailler le son, c’est s’exposer à une circulation fluide et qui résiste à toute tentative d’endiguement. Le bruit est invasif – et c’est sans doute pour cela qu’il fut une des passions de Warhol qui écrit, dans Popism, ses mémoires des années 1960 : “Assis là, j’écoutais le moindre son : le monte-charge grinçant dans sa cage, la porte s’ouvrant et se fermant devant les gens qui allaient et venaient, le trafic régulier tout en bas sur la 47ème rue, le projecteur qui tournait, l’obturateur d’un appareil photo, les pages tournées d’un magazine, quelqu’un craquant une allumettes, les feuilles de gélatine ou d’aluminium bougeant sous l’effet du ventilateur, etc.”. “Warhol Underground” replaçait l’art de Warhol dans une phénoménologie multisensorielle, interdisait les stases contemplatives en sollicitant constamment le spectateur, en refusant de le laisser au calme. Or, il n’est sans doute rien que Warhol détestait plus que le calme.
L’exposition parisienne, “Warhol Unlimited” fait le choix d’une scénographie plus classique. Mais si l’exposition est plus sage, elle est tout aussi finement conçue. Pas de murs argentés ici, mais le rappel de certaines présentations originelles conçues par Warhol. Ainsi, celle des Electric Chairs, qui furent d’abord présentées sur des murs que Warhol avait tapissés au préalable avec le Cow Wallpaper. Les images de l’objet le plus tragique de la culture américaine étaient ainsi éparpillées sur celles de la tête démultipliée d’une vache en jaune et rose. Là encore, le mur a une fonction inédite, celle de contredire l’œuvre, d’établir la pastorale sur le fond de laquelle se joue (et se déjoue) la tragédie. Encore une fois, on comprend que c’est en contexte que l’œuvre de Warhol existe pleinement. Et la série des cent-deux Shadows, dont chacune semble le photogramme d’une pellicule immense qu’on aurait développée dans l’espace, en atteste magistralement. Encore une fois, le continu l’emporte sur l’individuel.
Le Warhol 2015 est un Warhol formidable. Un Warhol qui échappe aux réductions qui cantonnent son œuvre à une imagerie bien sentie. Mais le Warhol 2015 a aussi ses inconvénients : il révèle, par contraste, la pauvreté du pop art d’aujourd’hui qui, lui, n’a retenu que l’imagerie et oublié le reste. En 2014, quand le Whitney Museum puis le Centre Pompidou Paris exposèrent Jeff Koons, de “petits carrés” devenus grands étaient accrochés sur des murs blancs, tandis que des sculptures étaient placées au milieu de la pièce – souvent sur socle. Chaque médium était à sa place et l’espace se taisait pour laisser entendre le monologue silencieux de l’œuvre autonome, chic, et choc. Un ennui consensuel, pas pop pour un sou.
Nina Leger
“Warhol Unlimited”, jusqu’au 7 février 2016, au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 11 avenue du Président Wilson, 75016 Paris, du mardi au dimanche, de 10h à 18h (nocturne le jeudi jusqu’à 22h).
“Ugo Rondinone (“I ♥ JOHN GIORNO”)”, jusqu’au 10 janvier 2016, au Palais de Tokyo, 13 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris, tous les jours sauf le mardi, de midi à minuit.
[print_link]









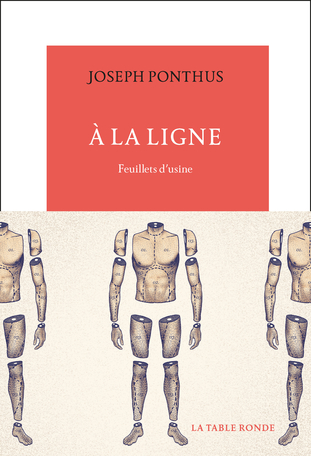


0 commentaires