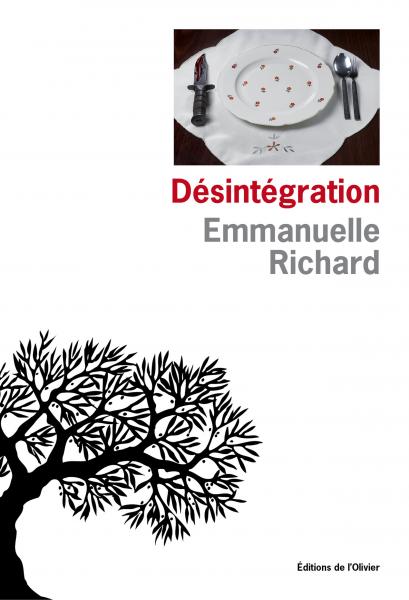 Ça se joue à très peu d’années près : Emmanuelle Richard, venue du 91, aurait pu être l’un de ces visages qui paraissent toujours un peu blêmes derrière les barrières de sécurité et sous les caméras, s’entendant dire par le Président que pour le boulot, suffit de traverser la rue. Elle aurait noté la peau soignée de l’élu, peut-être le sentiment de puissance d’un garde du corps, une de ces personnes qu’elle mentionne dans Désintégration, qui vous tutoient mais attendent en retour d’être vouvoyées. Elle aurait peut-être envisagé en passant de « pilonner leurs dents saines. En scier leurs racines. Écraser leurs petites gueules imbues sur un coin de trottoir ou une arête de mur du bout de ma chaussure. »
Ça se joue à très peu d’années près : Emmanuelle Richard, venue du 91, aurait pu être l’un de ces visages qui paraissent toujours un peu blêmes derrière les barrières de sécurité et sous les caméras, s’entendant dire par le Président que pour le boulot, suffit de traverser la rue. Elle aurait noté la peau soignée de l’élu, peut-être le sentiment de puissance d’un garde du corps, une de ces personnes qu’elle mentionne dans Désintégration, qui vous tutoient mais attendent en retour d’être vouvoyées. Elle aurait peut-être envisagé en passant de « pilonner leurs dents saines. En scier leurs racines. Écraser leurs petites gueules imbues sur un coin de trottoir ou une arête de mur du bout de ma chaussure. »
Quelque chose comme ça, ligne 13, heure de pointe. Mais Emmanuelle Richard n’a pas attendu de présidentiels conseils pour traverser la rue, et souvent. Elle a durablement expérimenté ces boulots qui ne sont « pas exactement ce qu’on veut peut-être au début ». (Ni à la fin, d’ailleurs.) Pas le choix quand on poursuit des études dites supérieures, et que la vie est chère, qu’on co-loque avec de jeunes gens qui, eux, peuvent toujours passer chercher les 600 euros du loyer chez les parents quand il y a dèche. Fils de. Pas elle. On lui rappelle un peu souvent qu’elle n’en est pas, mais l’humiliation est toujours très cool.
Donc, sur un trottoir le magasin de fringues et son sous-sol, sur un autre une boutique de l’avenue des Ternes, dans la file d’attente pour les hôtesses d’accueil (avant, on l’a lu dans un précédent roman, il y a eu Joué club) : un panoramique des boulots qui ont en partage d’être précaires, mal payés, épuisants et annihilants. Ce n’est pas Édouard Louis, le lumpen du Nord. La violence est la même, la traversée de rue à haut risque aussi.
Mais ce qu’Emmanuelle Richard dit (et c’est pourquoi tant de lecteurs-trices s’y reconnaissent, même si la teigne à l’évidence n’aime pas ses fans), c’est le détail étouffant d’une société, d’un monde, où en apparence tous se côtoient (citoyens…), où la notion de classe est délibérément floutée et d’autant plus pernicieuse, où les plus riches portent des jeans troués (« ils peuvent se le permettre », dit son père devant la télé) et les presque pauvres s’arrangent et ce faisant, se désignent comme tels. Pimkie n’est pas The Kooples.
Il y avait, dans La Légèreté, ce regard adolescent acéré à hauteur de vacances sur l’île de Ré, qui de la modestie sociale n’ignorait déjà rien. Pas de misère, juste cette invisibilité, on sait en trois romans que les traites du pavillon ont mangé les années des parents, qu’il y eut des rêves progressivement éteints, et qu’au casino de Fréjus on les refoula, pas assez présentables, c’était la sortie de l’été.
Alors, croisant une manifestation de sympathiques jeunes gens clamant dans les rues de Paris, « J’sais pas quoi faire, qu’est-ce que je peux faire », elle n’est pas très Anna Karina. L’explosif, c’est elle.
Bien sûr qu’on pense à Annie Ernaux, peut-être plus à Mémoire de fille qu’à La Place, histoire de celles qui n’ont pas les codes mais tentent les traversées, à deux différences près. Annie Ernaux appartient à une génération qui vivait le savoir, et le diplôme comme émancipation possible, Emmanuelle Richard à celle qui emprunte la même voie, genre impasse. Et que la seconde, à la fois plus rugueuse et plus désarmée, se demande soudain si elle pourrait retraverser dans l’autre sens.
Car au terme d’une décennie de boulots, études et manuscrits non publiés, il y a eu le succès, les invitations, la reconnaissance. Elle en est, désormais. Cette découverte quand on a si longtemps examiné les étiquettes de prix de la supérette, « plus on réussit, plus tout devient gratuit », les robes qu’on vous prête, les voitures noires pour vous emmener aux radio-télé. On longe les rues, on ne les traverse plus.
« Je ne sais plus quand ce que j’avais arraché à coup de poing américain et cru ne jamais vouloir lâcher m’est devenu indifférent, tout autant que la possibilité de faire marche arrière et de changer de vie m’est devenue impossible. Est impossible.
Je ne sais plus quand l’été a cessé d’être immense. »
Non, on ne sait pas, dans ce livre plus violent que les précédents, qui fusille au passage ceux qui achèteront le texte et se pâmeront, comment on repasse de l’autre côté de la rue, sans perdre en chemin le désir et la rage qui portent tout. C’est l’angoisse souterraine du texte, et l’une de ses lignes de force, au moment où, on le pressent, la voie de l’autofiction pourrait être abandonnée. Autre traversée.
Dominique Conil
Ordonnances littéraires
Désintégration, d’Emmanuelle Richard, éditions de l’Olivier, 204 pages.




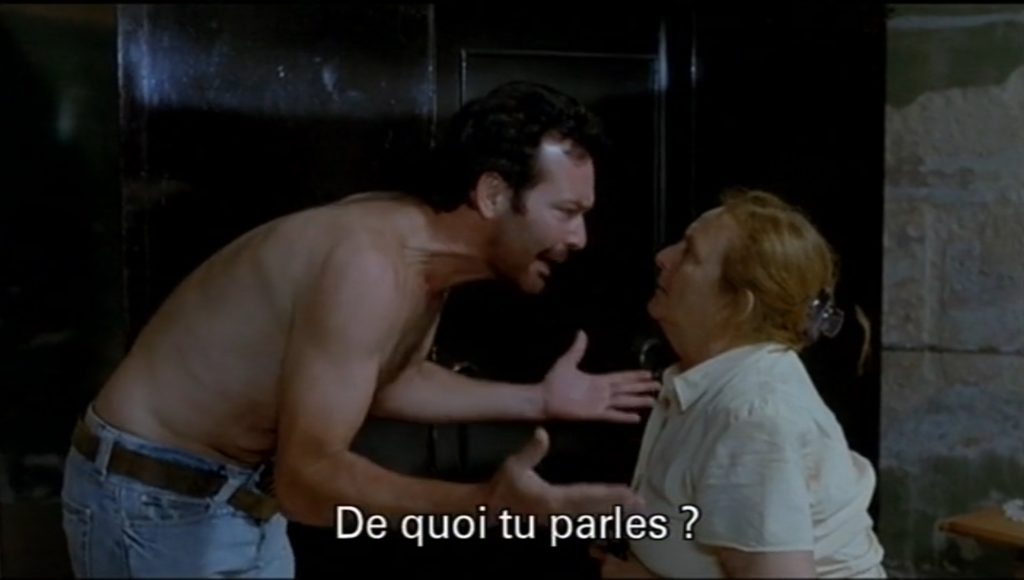


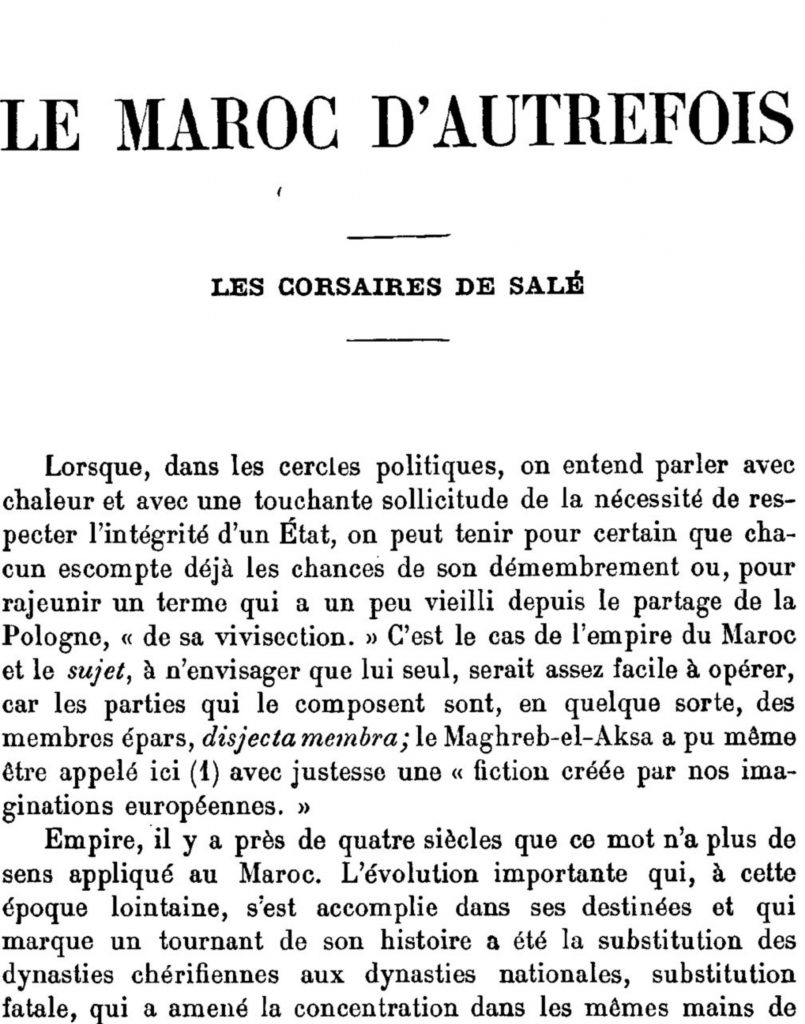

0 commentaires