Ces mots sont d’Antoine Vitez, le « saint patron laïc » de notre Maison. Un toit pour les traducteurs, tel était, en 1991, l’un des cris de ralliement de la Maison Antoine Vitez, Centre international de la traduction théâtrale, née dans la foulée des 6e Assises de la traduction d’Arles dont l’intitulé était, justement, « traduire le théâtre ».
Un toit pour les traducteurs et les traductrices – il vaudrait mieux dire « les traductrices et les traducteurs », si l’on veut respecter la préséance du nombre ; mais cela, c’est un autre sujet, – sur lequel nous pourrons revenir. Étaient-ils donc des sans-abris, des SDF du passage des langues et de la culture ? Au début des années 1990, le théâtre achevait intranquillement de larguer les amarres des grandes maisons d’édition de littérature, c’en était pour ainsi dire fait des Manteaux d’Arlequin et autres collections, il n’y avait plus de toit de ce côté-là. Pour les auteurs français et pour les autres, et leurs intermédiaires. Tout ce petit monde n’avait pas à espérer non plus trouver refuge dans les théâtres, autres édifices pourtant solides où l’on se méfiait d’eux comme de trouble-fêtes potentiels des noces des metteurs en scène et du plateau.
Les auteurs n’ont pas tardé à réagir. Diverses maisons d’éditions ont vu le jour : Théâtrales, Actes sud papiers, Les Solitaires intempestifs, Espaces 34… L’Arche, de son côté, a élargi son catalogue.
Les traducteurs, eux – les traductrices, elles – ont d’abord dû se souvenir des mots de Marx sur le destin du prolétariat et se convaincre que « l’émancipation des traducteurs sera l’œuvre des traducteurs eux-mêmes ». Début des années 90, époque bénie où le militantisme associatif pouvait bénéficier de l’appui des instances gouvernementales ! Jack Lang, ministre de la Culture a non seulement salué, mais immédiatement proposé d’apporter l’aide de l’État à la création et à l’existence de la Maison Antoine Vitez. Ce soutien financier du ministère de la Culture est sans faille depuis près de 30 ans.
Les traductrices et les traducteurs de la Maison Antoine Vitez peuvent donc se réunir sous ce toit, explorer le répertoire dramatique des langues qu’ils traduisent, proposer des pièces qui, une fois traduites avec une aide financière de la M.A.V., viendront enrichir le répertoire des pièces disponibles en français. Ils peuvent se retrouver pour discuter de leur condition, dénoncer des abus ou des manques – parmi les problèmes récurrents qu’ils rencontrent, il y a le comportement de tel ou tel metteur en scène tenté de s’accaparer les droits qui leur reviennent en se basant sur leur traduction pour en signer une nouvelle ; les supports de communication des théâtres, des festivals, ou de compagnies qui omettent leurs noms… Comme si Shakespeare, Tchekhov, Strindberg, Büchner, Lars Noren, Caryl Churchill ou encore Angélica Liddell avaient écrit leurs pièces en français… Pourquoi l’art de la traduction devrait-il s’accoupler à celui de la disparition ? Et bien d’autres incivilités dont la liste pourrait faire l’objet de quelque(s) Coin des traîtres à venir.
Derrière les mots de l’auteur, il y a les mots du traducteur. Tout l’art de ce dernier pourrait se résumer à faire en sorte que l’œuvre soit la même tout en étant différente (ou l’inverse). À ce sujet, Thomas Bernhard a poussé le bouchon assez loin : à une journaliste qui lui demandait un jour pourquoi il n’assistait jamais aux premières de ses pièces dans un pays étranger non germanophone, il a un jour répondu : « Parce que ce ne sont plus mes pièces. » Elles avaient glissé dans un autre champ culturel où les rythmes, les sons, la musique de la langue, la manière d’articuler la pensée, d’exprimer les émotions n’étaient plus les mêmes, avaient une autre logique, s’organisaient différemment.
Et pourtant, suis-je toujours tenté de dire, c’est bien Thomas Bernhard que l’on retrouve derrière cette métamorphose. C’est lui tout en n’étant pas lui. Donc c’est lui. Lui qu’on a transporté. C’est à la fois exaltant et terrorisant, comme expérience. Peut-être cela ressemble-t-il à l’acte d’écrire ? Toujours est-il qu’à titre personnel, je suis toujours un peu gêné quand quelqu’un, pour louer une de mes traductions, me dit : « C’est merveilleux, on dirait que cela a été écrit en français ». Parce que justement, non…
Pour clore ce petit texte, de façon provisoire, j’ose une image, qui vaut ce qu’elle vaut : le traducteur est une sorte de mathématicien fou qui rêve qu’au fond, les asymptotes finissent quand même par se toucher, voire… se croiser ! Le point de jonction, si par miracle il existe, ne relève cependant pas de son expérience, mais de celle de ces autres intermédiaires que sont les metteurs en scènes, les acteurs et chaque individu présent dans le public.
Laurent Muhleisen,
directeur artistique de la Maison Antoine Vitez






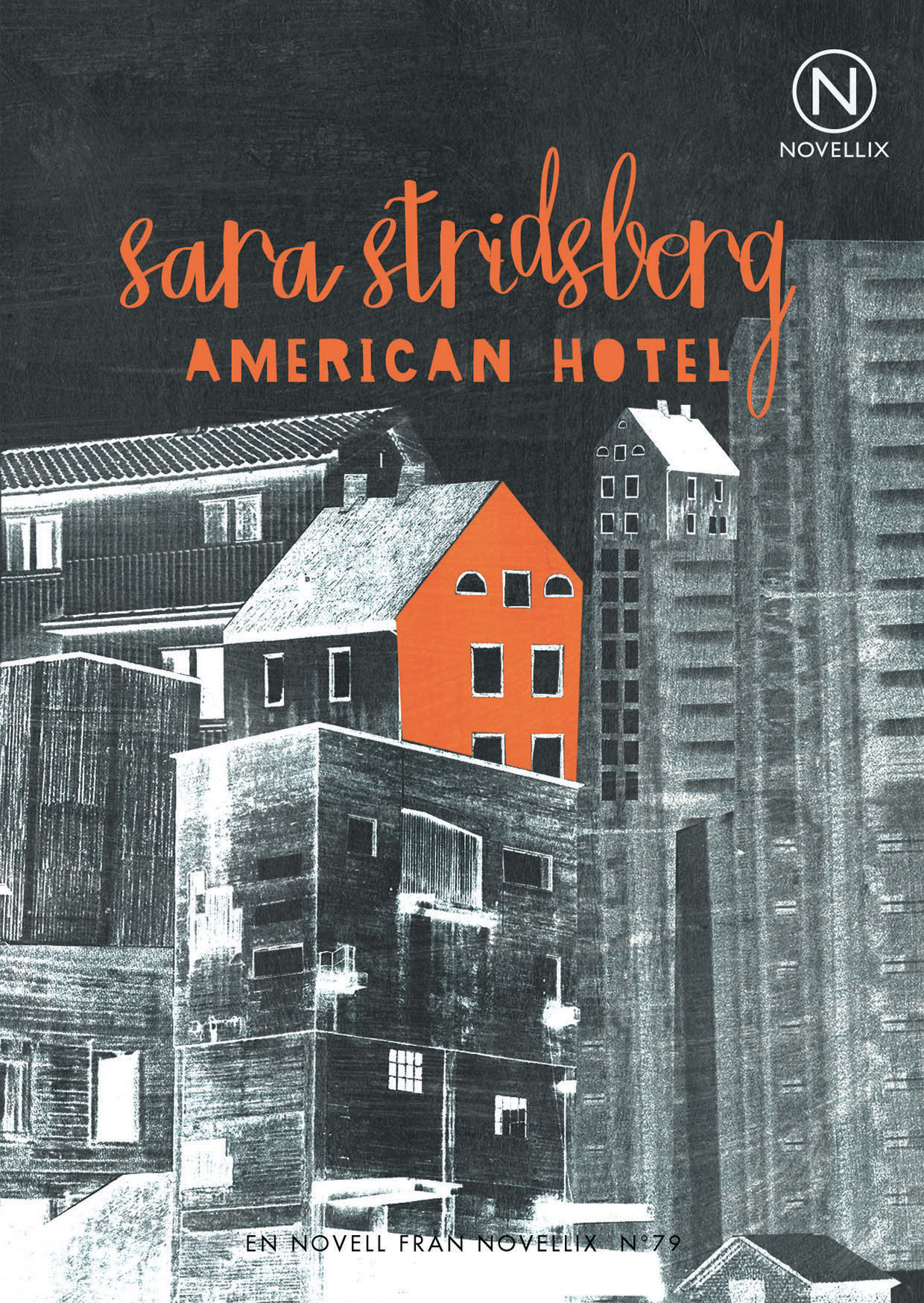
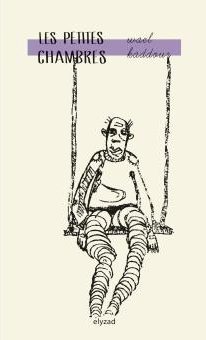
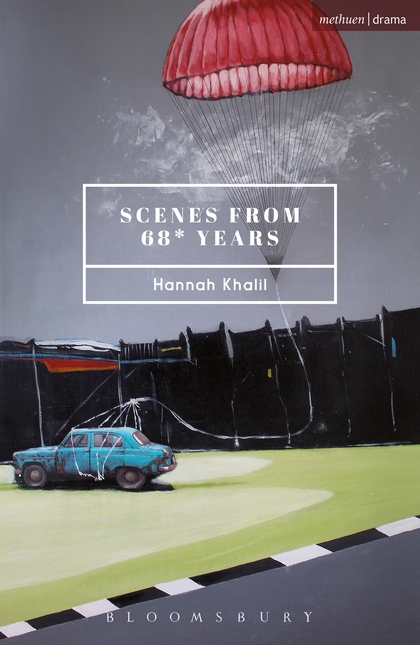

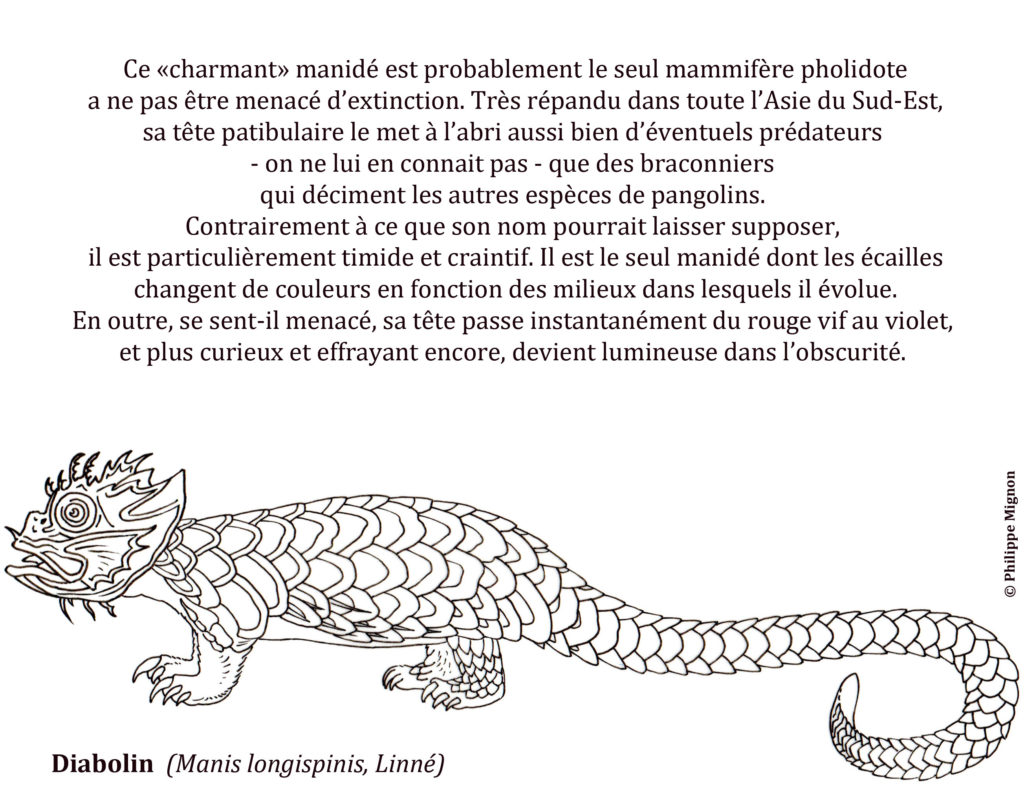



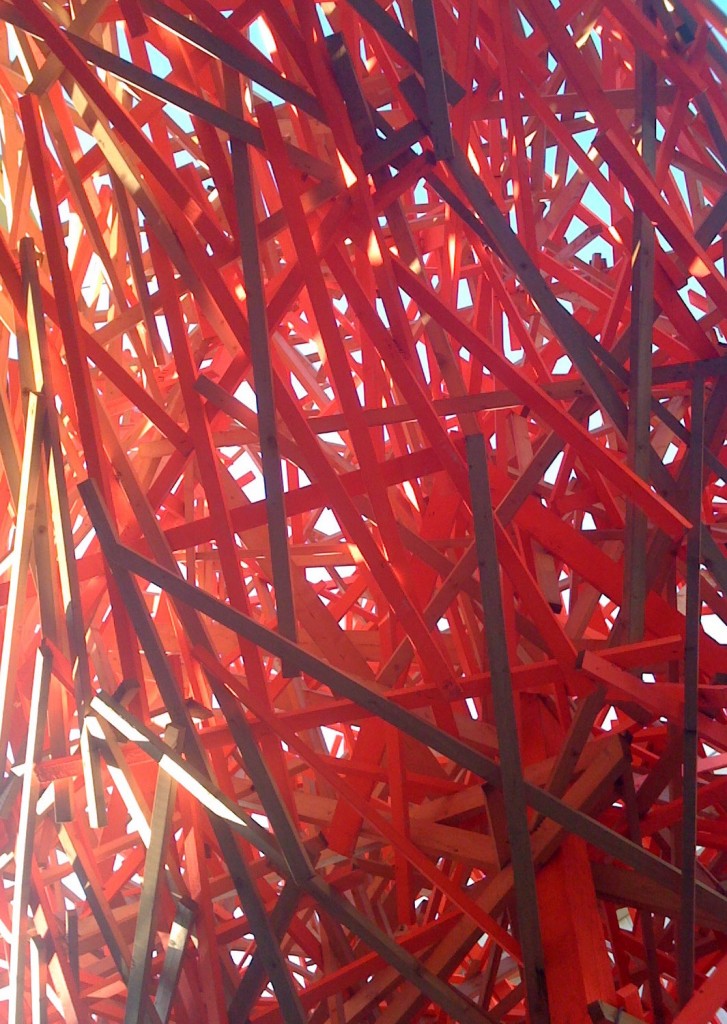
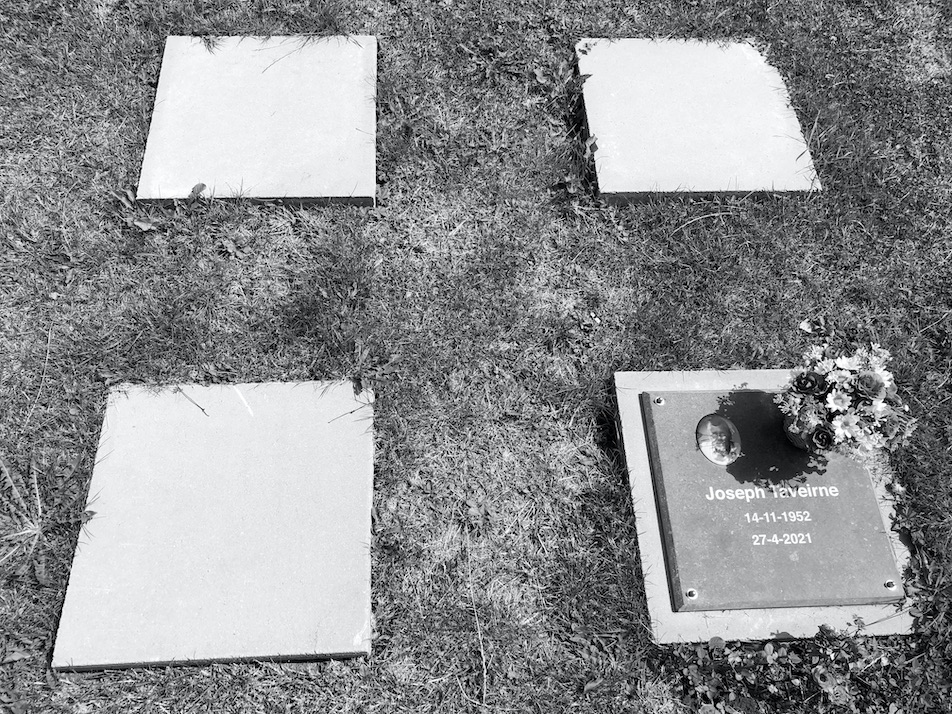
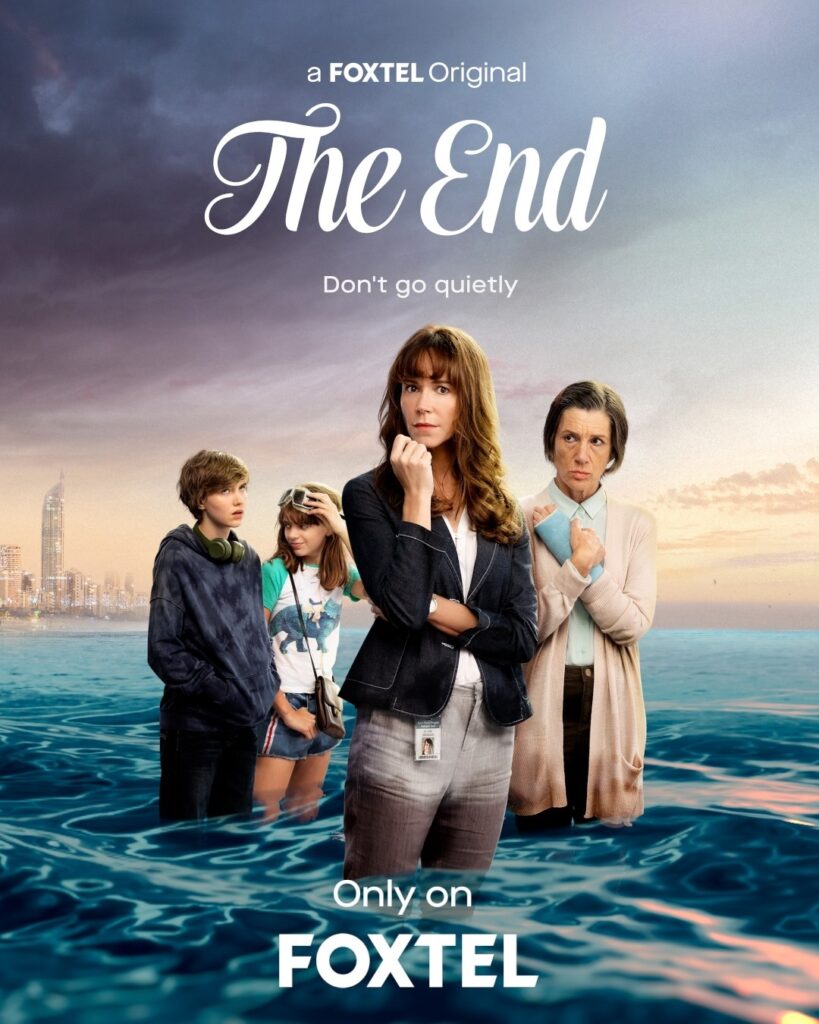

0 commentaires