Pendant quinze ans Valérie Mitteaux et Anna Pitoun ont filmé Salcuta Filan, une Rom de Roumanie exilée en France en quête d’une vie meilleure. Veuve et mère de deux enfants scolarisés à l’école d’Achères, Salcuta lutte et surmonte avec force et détermination tous les obstacles qui se dressent sur le chemin des Roms pauvres, ces éternels présumés coupables. Les habitants, l’institutrice, le maire, se montrent solidaires et apportent à Salcuta l’aide indispensable pour faire face aux chicanes administratives, aux brimades préfectorales et aux multiples difficultés empêchant les Roms de France de vivre leur vie sans exclusion.
Un documentaire passionnant autant qu’énergisant, qui nous a donné envie de rencontrer les réalisatrices.
Juliette Keating : Votre film commence avec l’expulsion d’un campement de caravanes. Il met en évidence le rôle de l’amitié dans la mobilisation autour des familles roms expulsées…
Anna Pitoun : Un événement dramatique a fondé cette amitié ou cette bienveillance des Achérois envers les familles roms. En 2003, au moment de l’expulsion, les familles vivaient sur ce terrain depuis trois ans. La préfecture était très virulente, elle les poussait à partir à la fin de chaque trêve hivernale. Un jour, une famille a pris peur et a décidé de s’en aller avec sa voiture en tractant sa caravane brinquebalante. Ils se sont engagés sur l’autoroute, il y a eu un accident qui a fait quatre morts dont des enfants. Toute la ville a été traumatisée et le terrain est devenu intouchable pendant quelque temps. En 2002, le nouveau ministre de l’intérieur était Sarkozy. À la fin de la trêve hivernale, le bras de fer a recommencé. Une quarantaine de terrains ont été évacués dont celui d’Achères.
Valérie Mitteaux : Pour nous, avec Salcuta, c’est une vraie histoire d’amitié. Elle nous a tout de suite impressionnées par sa force de caractère. Elle avait aussi un statut particulier sur le terrain en tant que jeune veuve, seule avec ses enfants. On avait déjà beaucoup d’affection pour elle quand on a vécu ensemble le moment terrible de l’expulsion.
JK : Votre de manière de filmer Salcuta a-t-elle changé au fil des ans ?
VM : On éprouve une certaine fascination pour Salcuta qui est très cinégénique, alors on aime la mettre en valeur. Quand on l’interroge sur son image dans le film, elle répond tranquillement qu’elle se trouve très bien.
AP : Ce qui est apparu dans le temps, et que j’ai ressenti physiquement aussi, c’est un sentiment de détente. On a commencé à filmer dans une situation très violente, on a souffert avec elle (pas comme elle évidemment), parce qu’elle ne savait pas si elle allait avoir un toit, si elle allait être expulsée. Alors, au jour le jour on se disait : c’est déjà un Noël de gagné, c’est déjà une rentrée en sixième de gagnée, quelques cours de français ou de mathématiques, c’est déjà ça. Quand on filmait la famille, on était toujours fébriles, on espérait que ce que l’on faisait ne leur portait pas atteinte. On se posait la question du trop montrer, du pas assez montrer. Au fur et à mesure, quand Salcuta a eu ses papiers puis son travail, son appartement, on a vécu de plus en plus de moments de joie et de détente. Quand on se voyait, on laissait vite la caméra pour être ensemble, manger et rigoler. Filmer devenait une fête. En 2015, nous nous sommes rendues place de la République après les attentats à Paris, au Bataclan. On voit ce moment dans le film, quand Salcuta et son fils se recueillent devant la statue. À cet instant, nous sommes ensemble, on a autant de peine, on est aussi touchées. Quelque chose s’est passé pendant ces années de l’ordre de l’inclusion. Une femme rom m’a dit, lors d’un débat à Lisbonne, qu’elle n’aime pas le mot « intégration », qu’elle préfère le mot « inclusion » même si aucun de ces mots n’est satisfaisant. Il y a quinze ans, nous filmions une personne dans une situation très différente de la nôtre et, peu à peu, on est devenues les mêmes, on se sentait déjà les mêmes, mais nos situations sont devenues les mêmes.
JK : Vous filmez un voyage de retour en Roumanie, les maisons construites dans le village par les familles qui reviennent de France. Vous teniez à ce que la Roumanie soit présente dans le film ?
VM : Le rapport à la Roumanie est compliqué. Pour Salcuta et ses enfants, il est très tiraillant et paradoxal. C’est la terre où ils sont nés, où ils ont vécu mais, en même temps, là n’est plus leur vie. Finalement, le voyage en Roumanie les ramène en arrière. Le mari de Salcuta est mort jeune de maladie. Il était très apprécié dans le village et son fils lui ressemble beaucoup. Sa belle-famille a aidé Salcuta à avoir un terrain et à construire une maison. La maison est un symbole de réussite. Les Roms disent : si tu es resté cinq ans en France et que tu ne peux pas te faire construire ta maison au village, ça veut dire que tu as échoué.
AP : Salcuta affirme qu’elle a besoin de retourner en Roumanie, d’aller sur la tombe de son mari. Dans le village, il n’y a pas d’hôtel, elle ne veut pas envahir sa famille, donc la construction d’une maison est obligatoire même si ça coûte de l’argent. C’est ce que les Français qui l’entourent, un peu paternalistes, ne comprennent pas forcément.
VM : En arrière plan, il y a la peur de l’expulsion toujours présente. Il faut penser à une solution de repli si ça tourne mal en France. On comprend que Salcuta pense à cela, surtout en ce moment.
JK : On entend cette critique, que les photographies, les films portant sur les Roms sont faits par des non-Roms s’appropriant la situation de Roms qui ne serviraient qu’à nourrir le discours produit sur eux sans qu’on leur donne la parole. Comment éviter de tomber dans les travers du film non-Rom sur les Roms ?
AP : On a eu cette règle : pas de sachem ! On a beaucoup lu, on a travaillé avec une historienne qu’on adore : Henriette Asséo. Mais les universitaires n’interviennent pas dans le film.
VM : On ne voulait personne en position de surplomb. D’ailleurs, du point de vue de la grammaire du film, ça n’aurait pas marché. Ça serait un autre film.
AP : Dans Des poules et des grosses voitures, une commande de la Région Ile-de-France sur les discriminations qui touchent les Gens du Voyage français, il n’y a que des Voyageurs qui parlent pendant les 70 minutes. On leur a posé une seule question : est-ce que vous subissez des discriminations aujourd’hui ? Ils ont d’abord ri en nous demandant si c’était une vraie question et puis ils ont démonté, l’un après l’autre, six ou sept préjugés discriminatoires que l’on entend fréquemment sur les Voyageurs. Dans mon film de 2011 Pologne aller-retour, qui raconte le voyage commun de jeunes Juifs et de jeunes Roms à Auschwitz, on entend le rapport différent des Juifs et des Tsiganes à la parole sur le génocide qu’ils ont subis. Les Juifs disaient aux Tsiganes : « mais vous, vous n’en parlez jamais ? Ah, nous on en parle tout le temps ! » Une Tsigane très émue dit : «Nous, on ne parle pas. On est parlés mais on ne parle pas. Tout le monde parle de nous, mais nous on ne parle jamais. »
JK : Les institutions ne les aident pas beaucoup à se souvenir et à parler du génocide. C’est très récent, le devoir de mémoire pour le Samudaripen, et encore trop discret…
AP : Absolument. C’est pourquoi dans nos films qui touchent à l’histoire des Roms, à ce qu’ils vivent, ce sont les Roms qui parlent. Ce sont eux qui racontent ce qu’ils veulent raconter.
Comment qualifiez-vous vos films ? Est-ce qu’on peut parler de films militants ou engagés ?
VM : Plutôt que « militants », nous préférons dire que nos films sont des objets de pensée. Nous voulons que les spectateurs sortent de la projection avec une autre façon de voir les choses. On travaille avec peu de moyens, donc la forme, pour nous, n’est pas obsessionnelle : on cherche à créer des déclics dans la pensée du spectateur.
JK : Cela impose un travail sur le long terme. Quinze années de tournage pour 8, avenue Lénine…
AP : Dans la surenchère actuelle d’images et de films, nous ne voulons pas en rajouter. Nous avons deux lignes conductrices. D’abord, être dans la recherche, en travaillant sur du long terme comme j’en avais l’habitude à l’université. Valérie qui était journaliste, en avait assez d’être obligée d’aller vite, de faire des trois minutes pour la télé. On s’est dit dès le début : prenons le temps. Soit pendant le tournage, soit pendant le montage. Notre film sur les États-Unis nous a pris deux ans de montage, le temps de retravailler, de laisser évoluer la pensée. Pour mon film sur la banlieue, le portrait d’un garçon, il y a eu six ans de tournage. Ensuite, nous travaillons sur des problématiques politiques, sur des questions souvent sombres et qui posent problème mais toujours avec des personnages et des idées qui apportent quelque chose : de la lumière, des propositions. C’est important pour nous de faire des films qui nous servent à penser tous ensemble, sans donner de leçons.
JK : Les projections de 8, avenue Lénine sont souvent suivies d’un débat que vous animez. C’est important de donner la parole au public ?
AP : Nous tenons beaucoup aux débats. Après avoir vu 8, avenue Lénine, les gens parlent bien sûr des discriminations. C’est un film sur les Roms mais c’est aussi un film sur les Français : comment ils résistent, comment ils sont solidaires ou pas. Qu’est-ce que c’est la solidarité aujourd’hui ? Qu’est-ce que c’est que le politique aujourd’hui ? S’engager, pourquoi ? Quel sens ça a ? Nos films sont ouverts sur ces questions et donnent aux gens la place pour y répondre, pour donner leur point de vue depuis leur histoire. Par exemple, une jeune femme Roumaine est intervenue lors d’un débat. Elle a expliqué que ce n’était qu’ici, en France où elle fait ses études, qu’elle a compris que la façon dont elle traitait les Roms en Roumanie, ce mépris qui lui paraissait si naturel, était en fait du racisme et que ce racisme était construit, fabriqué.
VM : Nous avons fait aussi des projections sur les terrains un peu partout en France. Les Roms de ces terrains ont découvert le film avant sa sortie nationale, en roumain et romani sous-titré en français.
JK : Est-ce qu’il est difficile de produire ce genre de film ?
VM : Oui, c’est difficile. Pour 8, avenue Lénine on a du recourir au financement participatif. On continuait à filmer avec l’idée qu’un jour on raconterait l’histoire de Salcuta quand Manuel Valls a eu cette phrase sur les Roms et leur « mode de vie extrêmement différent » qui justifierait leur expulsion. C’était en 2013, juste dix ans après Caravane 55. Alors, on s’est décidées à faire le film. Nous n’avons pas reçu d’aide à l’écriture, ni de soutien d’un diffuseur : on a dû aller chercher l’argent ailleurs, nous tourner vers les organismes intéressés par cette thématique. Le crowdfunding a bien marché, les gens qui avaient aimé Caravane 55 voulaient savoir ce que Salcuta était devenue.
AP : Beaucoup de documentaristes sont obligés de travailler à côté, sur des commandes, pour pouvoir manger. Surtout quand on veut faire des films sur le long terme, assez militants, ce n’est pas ce qui fait vivre.
VM : Il y a de bonnes critiques dans la presse, on parle du film, mais seulement deux salles diffusent 8, avenue Lénine à Paris. On ne fait pas des films pour avoir nos têtes dans le journal, mais pour qu’ils soit vus. Est-ce qu’il faut proposer des documentaires sur des sujets clinquants ou devenir des stars pour être diffusées ? Pourtant le public est là : lors des projections suivies d’un débat, la salle est comble.
♦
8, avenue Lénine. Heureuse comme une Rom en France, un film de Valérie Mitteaux et Anna Pitoun. Sortie en salles le 14 novembre 2018. Calendrier des projections


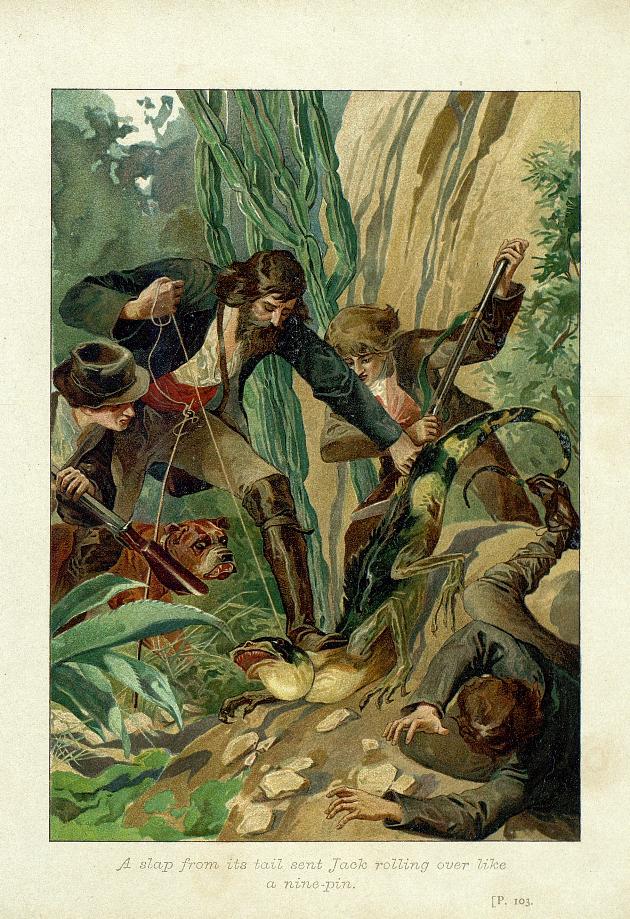


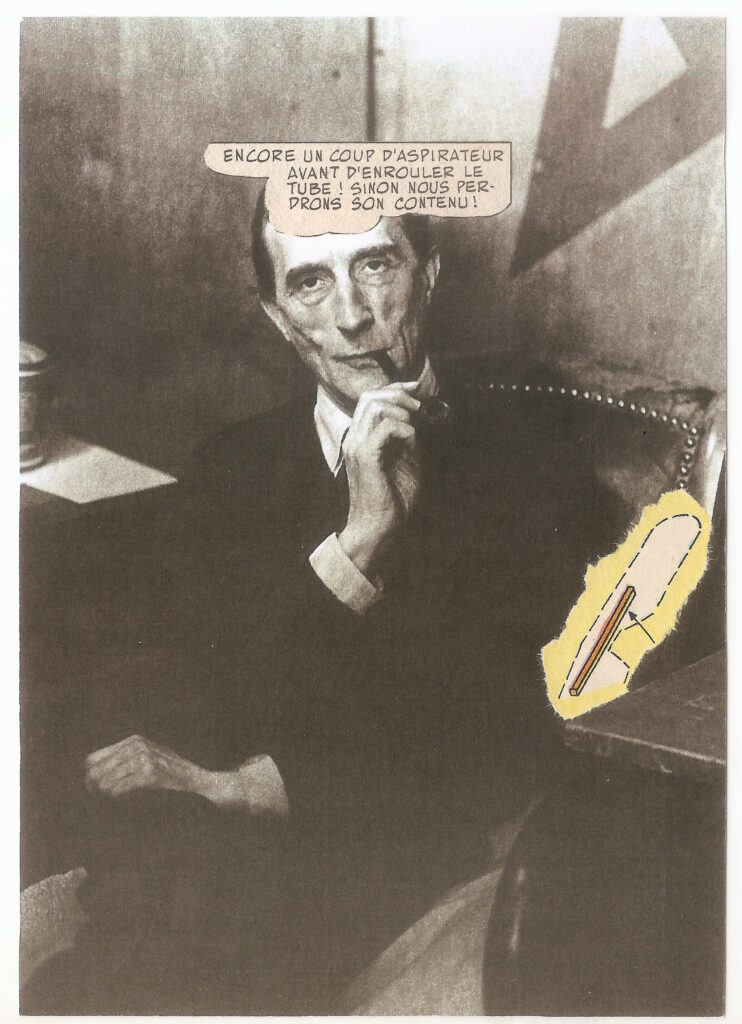
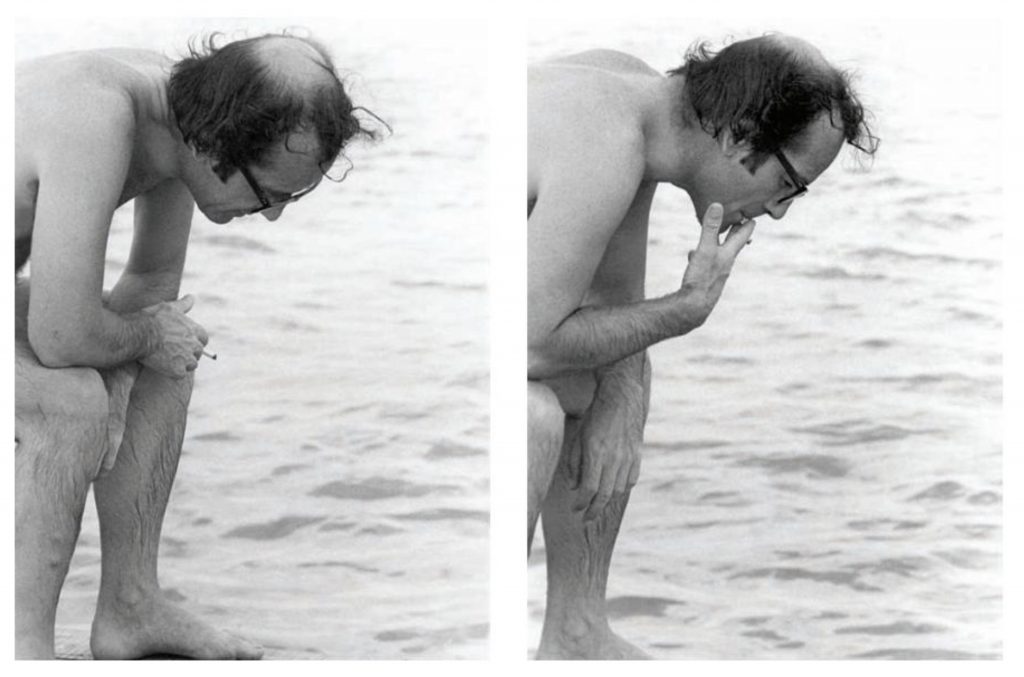



0 commentaires