 J’aime les enterrements, on s’y sent tellement vivant. Il est possible que l’existence ne soit qu’une illusion, mais lorsqu’un proche arrive au terme de la sienne, nous sentons la nôtre devenir soudain plus palpable : il ou elle meurt, donc nous sommes. De ce point de vue, l’enterrement d’Ilona fut très réussi. Nous n’étions qu’une vingtaine sous un ciel absolument bleu, personne ne pleurait vraiment, l’air vif d’avril claquait comme un drapeau, la vie triomphait. Au loin, les îles de Herm, Jethou et Sercq flottaient sur une mer constellée de points blancs. Une régate probablement.
J’aime les enterrements, on s’y sent tellement vivant. Il est possible que l’existence ne soit qu’une illusion, mais lorsqu’un proche arrive au terme de la sienne, nous sentons la nôtre devenir soudain plus palpable : il ou elle meurt, donc nous sommes. De ce point de vue, l’enterrement d’Ilona fut très réussi. Nous n’étions qu’une vingtaine sous un ciel absolument bleu, personne ne pleurait vraiment, l’air vif d’avril claquait comme un drapeau, la vie triomphait. Au loin, les îles de Herm, Jethou et Sercq flottaient sur une mer constellée de points blancs. Une régate probablement.
Je ne connaissais personne. Ilona elle-même était presque une inconnue pour moi ; j’ignorais en tout cas qu’elle était née à Guernesey et qu’elle avait émis le vœu de s’y faire inhumer. Cela, je l’ai appris par un coup de téléphone de sa mère, en même temps que la nouvelle de son suicide. La cérémonie a été brève, l’éloge funèbre agréablement succinct, si bien que, une demi-heure à peine après y être entré, je suis ressorti presque gai du cimetière de Candie Road, joli jardin de pierres perché au-dessus de Saint-Pierre-Port. La page était tournée, l’horizon était net. J’étais libre.
Elle ne parlerait plus à quiconque, le secret que nous partagions ne risquait plus d’être éventé. Je suis redescendu en ville en sifflotant. J’ai bu cinq ou six bières sur le port à l’Albion House, et c’est à peu près ivre que j’ai repris le ferry pour Saint-Malo. J’ai regardé l’île disparaître à la poupe — rocher, puis nuage, puis ombre, puis rien… — avant d’aller m’affaler dans un fauteuil gris qui sentait le vomi et la clémentine ; je m’y suis endormi presque immédiatement. J’habite dans cet immense rêve de l’océan, je deviens peu à peu un somnambule de la mer.
Son dernier appel remontait à février. Il y avait eu beaucoup de blancs dans la conversation, dans son monologue en fait. Elle attendait que je lui retourne des « Moi aussi parfois, je… » et des « Tu as raison, mais… ». Elle aurait sans doute voulu que je fasse écho à son désespoir ou bien que je cherche à l’en distraire, mais je l’avais laissé ressasser son malaise sans dire un mot car c’était un air que j’avais trop entendu ces derniers mois. Il n’y avait plus rien à ajouter, plus rien à répondre. J’avais raccroché en prétextant un autre appel. Elle s’est pendue dans son studio de Londres avec une rallonge électrique. Cela aussi, c’est sa mère qui me l’a appris. Je ne sais pas pourquoi cette pauvre femme a tenu à me parler de la rallonge, du tuyau auquel elle était nouée et du tabouret en osier renversé sous le corps rigide. Elle a dû penser que partager les détails de cette scène avec moi la lui rendrait moins insupportable ; nous serions deux autour du tabouret au moment fatal, et tandis que sa fille battrait des pieds une dernière fois, nous nous soutiendrions — elle ne pouvait plus mal tomber. Puis ce fut une litanie de pourquoi ?. À son retour, sa fille n’était plus la même, elle l’avait bien senti, mais elle ignorait tout des raisons de son geste. Elle les ignorerait toujours : Ilona n’avait pas parlé, et moi je ne lui dirai rien.
J’étais arrivé tard, n’avais serré aucune main, ne m’étais présenté à personne. Près de la tombe, trois femmes âgées essuyaient des larmes discrètes, je n’ai pas su laquelle était la mère d’Ilona. Il y avait aussi un homme qui, comme moi, se tenait en retrait, apparemment étranger au cercle familial comme à celui des amis. Son regard allait du cercueil à la mer, et de la mer au ciel. Il portait un costume froissé bien trop petit pour lui ; j’ai cru que c’était un employé du cimetière, mais aujourd’hui je suis convaincu que non. Cet homme était là pour la même raison que moi : vérifier que tout était fini. Ci-gît Ilona Beirach, 1986-2012. Paix à son âme tourmentée !
Et paix à la mienne, si possible. Car il m’a fallu des mois pour réaliser que la page n’était pas tournée, qu’elle ne le serait jamais, qu’elle ne pouvait tout simplement pas l’être. Mais moi, aujourd’hui, je n’ai personne à qui téléphoner. Qui me croirait ? Souvent je suis à deux doigts de rappeler la mère d’Ilona, de tout lui raconter, de lui dire ce qu’ont fait sa fille et l’inconnu qui lui parle, et lui révéler le reste, mais à quoi bon ajouter des cauchemars à son deuil. De toute façon, elle refuserait de me croire, elle aussi.
Toutes les images odieuses de notre équipée absurde ressurgissent dès que mes yeux se ferment. Avant de me les rouvrir aussitôt. Elles me reviennent avec tant de précision que je pourrais les dessiner, si je savais dessiner. À défaut, je peux toujours les décrire.
Le reste, l’impensable, je ne peux que le suggérer.
Alors voilà.
Édouard Launet


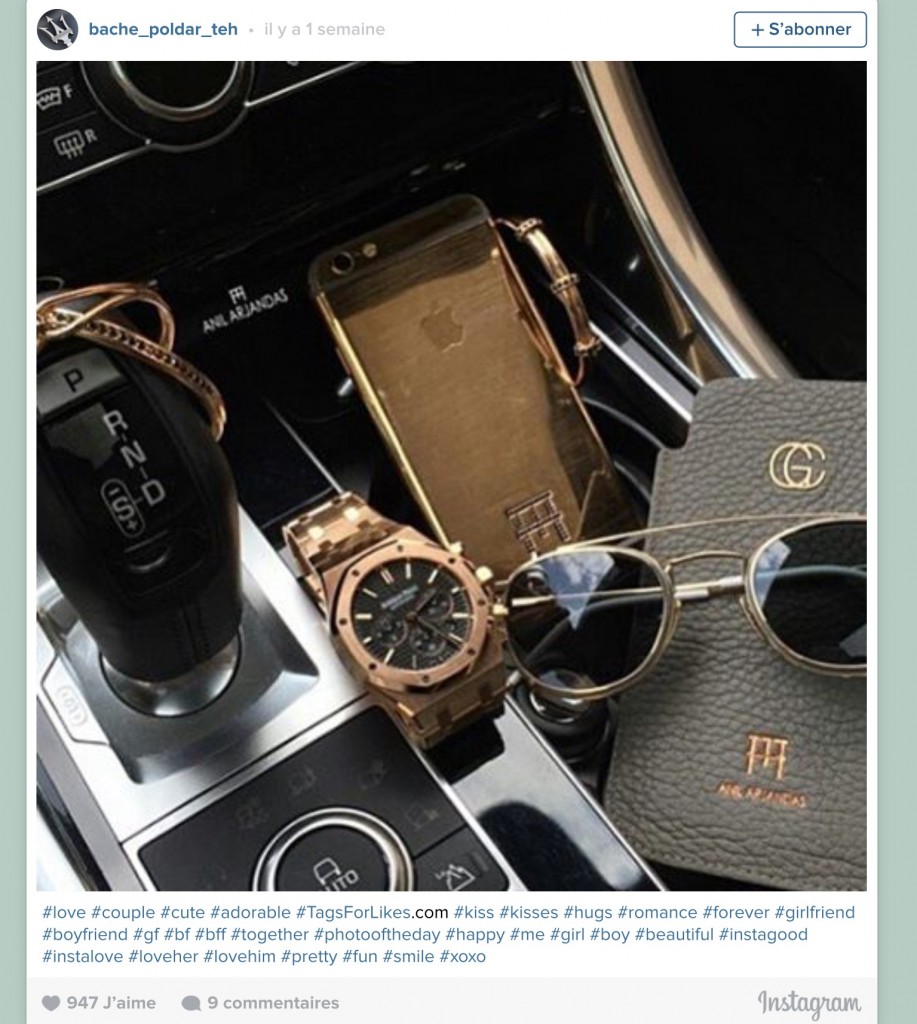
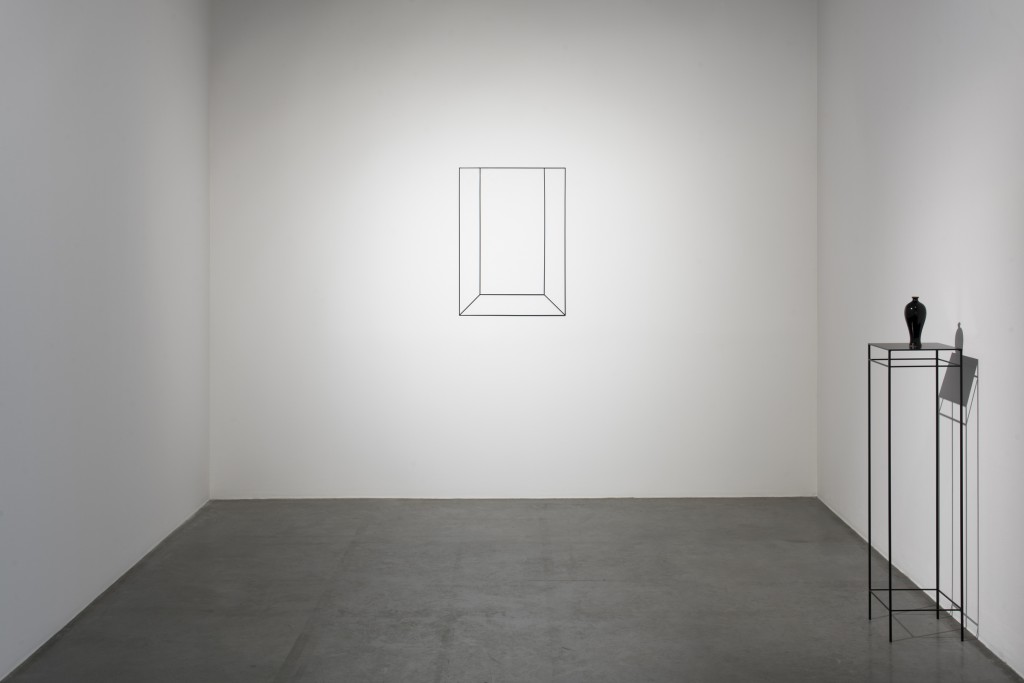





0 commentaires