Gilles Pétel interroge l’actualité avec philosophie. Les semaines passent et les problèmes demeurent. « Le monde n’est qu’une branloire pérenne » notait Montaigne dans les Essais…
La fonte des glaciers s’accélère à un rythme qui dépasse toutes les prévisions comme le rappelle un article du Monde du 10 avril : « ces sentinelles du climat ont perdu plus de 9600 milliards de tonnes de glace au cours des cinquante dernières années. » Le niveau des mers s’est élevé de 2,7 cm sur la même période. Christian Vincent, spécialiste des glaciers de montagne, affirme enfin que « la situation est en réalité pire ».
La fonte des glaces vient nous rappeler que notre monde est à la fois hasardeux et fini. Cet événement plus que regrettable, et dont il semble que nous soyons responsables, annonce des bouleversements climatiques : tempêtes herculéennes, tornades gigantesques, raz de marée titanesques, pluies diluviennes, sécheresses bibliques, fournaises dantesques. La catastrophe en somme. Il n’est pas sûr qu’à terme notre espèce comme tant d’autres y survivent. Notre monde semble rouler hors de ses gonds.
Dans le Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, Rousseau avait envisagé une hypothèse comparable puisqu’il attribuait la sortie de l’état de nature à « de grandes inondations ou des tremblements de terre » :
« Des révolutions du globe détachèrent et coupèrent en îles des portions du continent. »
En modifiant le climat, ces événements auraient contraint les hommes à se rapprocher les uns des autres et à quitter leur solitude originelle. La géologie expliquait les débuts de notre sociabilité, c’est-à-dire, pour Jean-Jacques, de notre malheur.
Mais l’hypothèse de Rousseau qui, de son propre aveu, commence « par écarter tous les faits », n’est pas très sérieuse. Il n’en va pas de même de celle du poète latin Lucrèce. Dans son célèbre poème De la nature des choses, celui-ci envisage de façon raisonnable la fin de notre monde :
« … considère en, premier lieu les mers, les terres et le ciel : leur triple nature, leurs trois corps, ô Memmius, leurs trois aspects si dissemblables, leurs trois tissus si solides, un seul jour suffira pour les détruire ; après s’être soutenue pendant tant d’années, s’écroulera la masse énorme de la machine qui forme notre monde. » (livre V, 95. Traduction A. Ernout)
Lucrèce est le dernier représentant de l’atomisme antique. Après Démocrite et Épicure, il renouvelle la théorie matérialiste à l’aide d’un argument original : le clinamen. Pour Lucrèce, comme pour ses prédécesseurs, l’univers infini est constitué de matière et de vide. Dans leur mouvement incessant, les atomes s’entrechoquent, s’agrègent les uns aux autres dans des combinaisons de tous genres jusqu’à ce qu’enfin l’une d’entre elles soient viables : un monde naît. Le fameux clinamen qu’on ne trouve ni chez Démocrite ni, semble-t-il, chez Épicure, intervient pour expliquer le choc des atomes. Ceux-ci en effet tombant de haut en bas, à la façon des gouttes de pluie, ne se rencontreraient jamais s’il n’existait une infime déclinaison qui les fait dévier de leur trajectoire rectiligne. Cette inclinaison, ce clinamen en latin, est purement hasardeuse. Aucune raison ne l’explique ni ne la justifie. Cela signifie qu’il faut des milliers de coups, à la façon d’un coup de dés, avant qu’une combinaison « heureuse » n’apparaisse. Il aurait même très bien pu se produire qu’aucun coup ne produise jamais un résultat viable. Notre monde aurait pu ne jamais voir le jour. Le fait que nous n’ayons encore pu découvrir aucun autre monde habité confirme ce qu’a d’exceptionnel la naissance du nôtre. Peut-être sommes-nous seuls dans l’univers. Mais si cette rencontre est bel et bien exceptionnelle, elle n’a rien pour autant de miraculeux : Lucrèce décrit au livre V du De rerum natura la naissance et non la création de notre monde. Après Épicure, il a en effet rejeté les dieux dans un ailleurs si lointain qu’ils ne peuvent jouer aucun rôle dans notre existence. Comme pour Épicure, les dieux chez Lucrèce sont parfaitement indifférents à notre sort. Mais si le monde a bel et bien commencé un jour, par le pur effet du hasard, il périra également un jour dans une catastrophe tout aussi imprévisible :
« … il ne manque pas non plus de corps qui, jaillissant en masse des profondeurs de l’infini, seraient sans doute capables de renverser l’ensemble de notre monde dans un tourbillon impétueux ou de lui infliger quelque autre désastre… » (V, 365)
La fonte des glaces pourrait bien être le début d’une de ces catastrophes mortelles. Car l’homme pas plus que le monde n’est éternel. Le récent incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris montre hélas que les œuvres d’art elles-mêmes ne peuvent échapper à l’inexorable destruction qu’impose le jeu capricieux de la matière. Dans ces temps de crise économique et politique, la nature vient ainsi nous rappeler notre fragilité et notre insignifiance. Nous aurons ainsi fait « beaucoup de bruit pour rien » comme l’écrit Shakespeare.
Sans doute est-il utile, sinon nécessaire, de tout faire pour ralentir le réchauffement climatique, pour autant que nous en ayons encore les moyens. Mais il faudrait aussi en avoir la volonté. Il est à craindre qu’après le déni de la catastrophe, dont Trump est un des illustres représentants, nous nous tournions vers la culpabilité religieuse. Les grands cataclysmes sont souvent l’occasion d’un regain de la superstition. Si les banquises et les glaciers fondent, n’est-ce pas parce que nous avons commis quelque faute inavouable ?
L’atomisme de Lucrèce n’est pas sans raison un matérialisme. Affirmer que l’univers n’est composé que de matière et de vide, c’est en même temps s’interdire tout recours à une explication divine de la nature. C’est tenter de chasser les peurs qu’engendre la superstition de l’esprit malade des hommes. Malgré les siècles qui nous séparent, malgré les progrès de nos sciences et de nos techniques, il semble que nos mentalités ne soient pas tellement différentes de celles que dénonce Lucrèce dans son poème. Les hommes sont aussi crédules aujourd’hui qu’hier. Le renouveau de différentes formations religieuses, tels les évangélistes ou les salafistes, auxquels nous pouvons ajouter dans un tout autre genre le véganisme (ou anti-spécisme), montre que ce n’est pas seulement la nature qui est déréglée mais bien une bonne partie de l’humanité. En cette période de troubles aussi bien matériels que spirituels, il n’est peut-être pas inutile de se remettre à un peu de philosophie. La lecture du poème de Lucrèce peut être un bon point de départ.
Gilles Pétel
La branloire pérenne







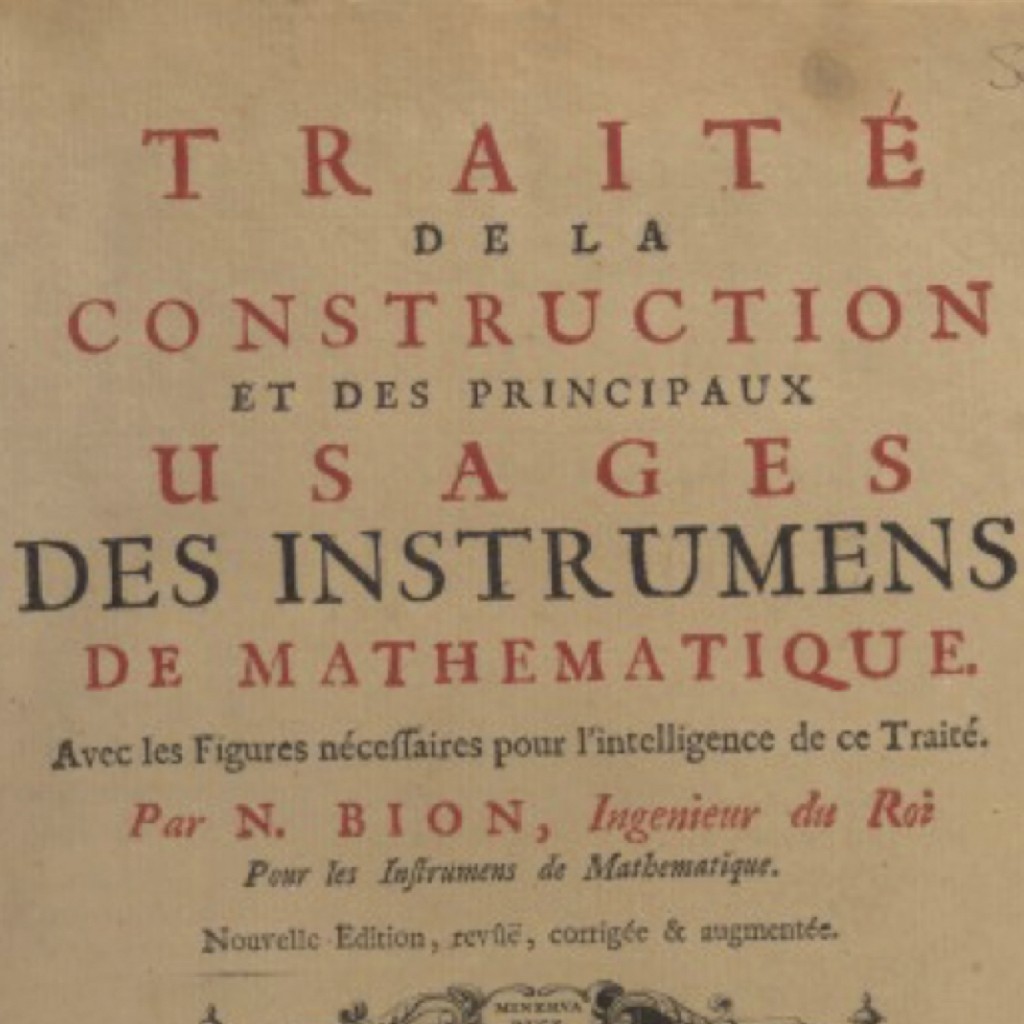

0 commentaires