Le genre idéal est noir. Comme un polar, un thriller, une enquête judiciaire ou un roman naturaliste. Et c’est de l’humain, de la tragédie grecque, du meurtre, en série, passionnel, accidentel, d’État, ordinaire parfois.
Un mur. Un mur, si haut qu’il faudrait un grappin pour l’affronter et des gestes cent mille fois répétés à la force des bras pour se hisser vers la voûte céleste qui borde sa limite. Un mur si long que le suivre des jours pour y trouver une porte, un arbre, un banc ne servirait qu’à revenir à son point de départ et la fin de sa vie. Un mur si profond, profond qu’il se forge en traversant les laves du cœur de la planète et ressort de l’autre côté du globe pour grimper vers le ciel.
Mon mur. Ma pensée. Je m’y appuie, les genoux repliés. Le dos se niche dans l’alcôve creusée par l’habitude. Chaque jour ce mur, rassurant comme une angoisse, toujours là, fidèle. Je m’y réchauffe, il me supporte, je ne le fatigue pas, aucune larme dans ses yeux. Il est celui qui reste quand les autres ont filé droit devant en quête de verdure. Et s’il ne donne rien, pas de promesse, à peine de l’ombre le jour, une digue la nuit contre les créatures, il ne cherche pas non plus à convaincre et ne sauvera personne. Pas un seul nid dans sa muraille. Pas même une mouche bleue posée par là par hasard. Juste une fois, sur le sol, une libellule aux ailes de dentelles.
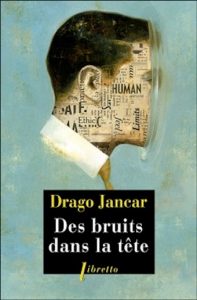 Et contre ce mur adossé, l’absence de perspectives communes à perte de vue, dit-on, le roman de Jancar dans les mains. Des bruits dans la tête. L’histoire d’une prison. Un autre enfermement. L’allégorie de la servitude. Un homme qui se révolte, d’autres qui ne veulent que suivre ou profiter en oubliant que, si la richesse de l’autre lui est ôtée – liberté, rêves, famille, maison, argent – jamais elle ne sera partagée. La puissance de l’ordre partout, dedans et hors les geôles, qui favorise l’erreur et attend le bon tempo pour permettre le massacre. Vies, rêves et poumons piétinés dans le sable. Trahisons. Hélicoptères. Projecteurs. Armes. Pillage. Chaos. Destruction. Scène répétée au travers des siècles. Et des murs toujours, des plus petits, partout, par milliers. La peur. Qu’une tête dépasse, il faut la disperser en molécules de néant.
Et contre ce mur adossé, l’absence de perspectives communes à perte de vue, dit-on, le roman de Jancar dans les mains. Des bruits dans la tête. L’histoire d’une prison. Un autre enfermement. L’allégorie de la servitude. Un homme qui se révolte, d’autres qui ne veulent que suivre ou profiter en oubliant que, si la richesse de l’autre lui est ôtée – liberté, rêves, famille, maison, argent – jamais elle ne sera partagée. La puissance de l’ordre partout, dedans et hors les geôles, qui favorise l’erreur et attend le bon tempo pour permettre le massacre. Vies, rêves et poumons piétinés dans le sable. Trahisons. Hélicoptères. Projecteurs. Armes. Pillage. Chaos. Destruction. Scène répétée au travers des siècles. Et des murs toujours, des plus petits, partout, par milliers. La peur. Qu’une tête dépasse, il faut la disperser en molécules de néant.
Et pourtant. Toujours, l’homme revient. L’absence de perspectives communes, dit-on ? Idée fausse ! Cette défaite supposée est une chimère à repousser comme une araignée noire. Partout des initiatives. De l’idée. Du partage. Du concret. La société civile. Des femmes écrivent, sortent de prison, publient, parlent, meurent et enfantent. Des hommes cherchent et refusent l’à-quoi-bon, le cynisme, la fatalité. La révolte et l’humanité féroces des chapitres de Jancar, histoire carcérale, ont transformé mon mur en mirage. Le dénommé Keber, légende vivante, incarcéré dans la prison Maribor, Monténégro, y raconte la révolte qui l’a mené là. Les voix dans sa tête vrombissent dans la mienne comme des frelons. Brume d’eau, vapeur. Temps qui passe. Les pages tournent. Avec elles, nous traverserons la pierre.
Lionel Besnier
Le genre idéal
Des bruits dans la tête de Drago Jancar, traduit du slovène par Andrée Lück-Gaye, Éditions Passage du Nord Ouest et Libretto (2015).
[print_link]








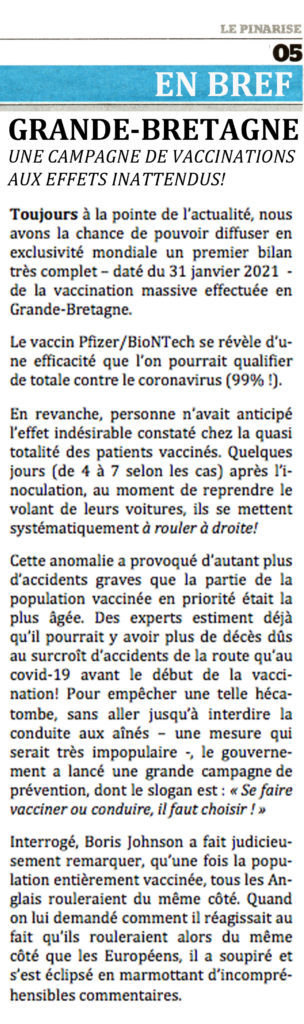
0 commentaires