Lorsque les temps sont durs, et ils le sont souvent pour elle, Theresa May se replonge dans Jane Austen. Qui traitait avec grâce de l’économie, matrimoniale du moins. Mais les divorces, même européens, dépassent toujours les affaires matérielles. Deux auteurs, Graham Swift et Jon McGregor, bien contemporains, eux, viennent à point rappeler que les livres se moquent des no deal. Et ce que l’on aime tant, dans la littérature anglaise.
C’était le 10 novembre, avec l’habituelle grisaille détrempée sur ce village de l’Ouest où l’on a tant aimé le crépi. On avait tous l’air de sortir d’un roman anglais automnal, moutonnement de doudounes et d’écharpes, avec un unique et fier monsieur au béret incliné brandissant un drapeau, convergeant vers la salle des fêtes de Vasles, village des Deux-Sèvres que les Anglais, fort nombreux alentour, avaient surnommé « Dallas » lors des dernières élections municipales, hautes en couleur il est vrai.
Les Anglais, donc, conviaient à une lecture de lettres et poèmes de femmes écrits pendant la guerre de 14-18, allant de l’engagement guerrier radical au pacifisme et à la perte. Près d’un million de morts qui traversent le Journal de Virginia Woolf, et de bien d’autres, une génération fauchée. Le 11, il y eut belle photo avec enfilade de présidents et chancelière, gaffe majeure avec la Serbie qui avait payé un lourd tribut mais qu’on avait expédiée sur le banc de touche, et pas un Anglais, Theresa May boudant en commémoration belge. La veille, ce qui ne fit aucun bruit hormis dans La Nouvelle République, doudounes et écharpes et drapeau, après lecture anglo-française (et parmi ces femmes anonymes, toutes oubliées, certaines savaient écrire), allèrent en ce samedi après-midi vers le monument aux morts, celui d’un de ces villages où la liste des morts de 14-18 est toujours plus longue que celle de 39-45. Ce mot, Alliés, qui reprenait substance sous la bruine.
Cathédrale du non-dit
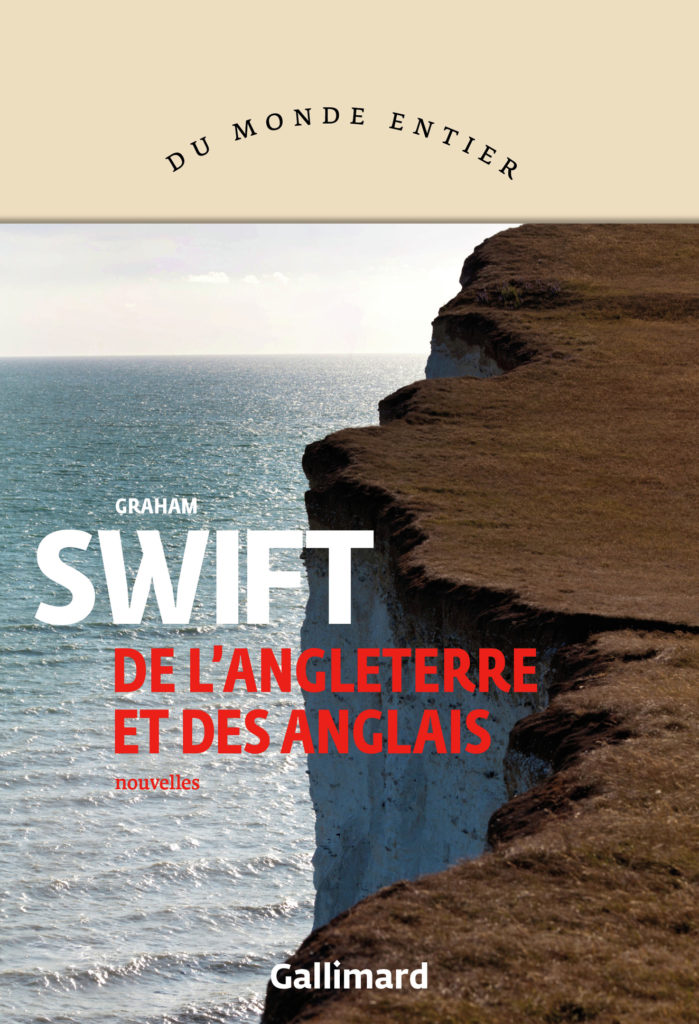 Sur les vingt-cinq nouvelles qui composent De l’Angleterre et des Anglais, de Graham Swift, une dizaine ont trait à la guerre, ou à son souvenir. Pas de méprise, à deux exceptions près, elles sont bien ancrées dans le contemporain, avec pizzas et portables, mais l’héritage mémoriel est présent. Jusqu’au titre original, England and other stories, qui s’inspire d’un titre de D.H. Lawrence de 1915, England, My England, traversé par la guerre. Swift, c’est le roman anglais dépouillé à l’os, minimaliste. Capture d’écran en trois phrases. C’est une cathédrale du non-dit, un monument d’understatement (oui, c’est très drôle parfois, mais pas les Monthy Python non plus). « À présent, ils étaient mariés, et on leur avait conseillé de faire leur testament, comme s’il s’agissait de l’étape suivante dans la vie » : et un jeune couple connaît ainsi un épisode vivifiant et érotique (mais la lettre d’amour écrite au petit matin ne sera jamais donnée).
Sur les vingt-cinq nouvelles qui composent De l’Angleterre et des Anglais, de Graham Swift, une dizaine ont trait à la guerre, ou à son souvenir. Pas de méprise, à deux exceptions près, elles sont bien ancrées dans le contemporain, avec pizzas et portables, mais l’héritage mémoriel est présent. Jusqu’au titre original, England and other stories, qui s’inspire d’un titre de D.H. Lawrence de 1915, England, My England, traversé par la guerre. Swift, c’est le roman anglais dépouillé à l’os, minimaliste. Capture d’écran en trois phrases. C’est une cathédrale du non-dit, un monument d’understatement (oui, c’est très drôle parfois, mais pas les Monthy Python non plus). « À présent, ils étaient mariés, et on leur avait conseillé de faire leur testament, comme s’il s’agissait de l’étape suivante dans la vie » : et un jeune couple connaît ainsi un épisode vivifiant et érotique (mais la lettre d’amour écrite au petit matin ne sera jamais donnée).
 Deux « losers » sociaux – « ils n’avaient rien de mieux à faire un jeudi après-midi. Que voulez-vous, le chômage » – assistent aux obsèques d’un ancien prof et l’un est confronté au souvenir très incarné et embarrassant de son dépucelage. Un éminent cardiologue aime en fin de consultation évoquer la « chance » de son Indien de père fou de l’Angleterre : autre époque, autres cruautés, autres résiliences. Polly et Holly, insémineuses professionnelles, découvrent gaiement l’amour sans le pénis. Un personnage s’interroge sur le fait qu’à deux reprises on vient d’employer devant lui ce mot, « décent ». La décence, et les culpabilités enfouies d’un homme qui a peut-être autrefois envoyé un homme vers un enfer judiciaire mais a construit sa vie professionnelle – et peut-être sexuelle – sur deux brèves rencontres dans un jardinet de banlieue et devant un siphon bouché où il apprit qu’Ajax, avant de devenir poudre à récurer, était un héros de la mythologie grecque. Rien de si événementiel, cependant : c’est précisément dans les silences, la retenue, la vie empêchée, que Swift brille.
Deux « losers » sociaux – « ils n’avaient rien de mieux à faire un jeudi après-midi. Que voulez-vous, le chômage » – assistent aux obsèques d’un ancien prof et l’un est confronté au souvenir très incarné et embarrassant de son dépucelage. Un éminent cardiologue aime en fin de consultation évoquer la « chance » de son Indien de père fou de l’Angleterre : autre époque, autres cruautés, autres résiliences. Polly et Holly, insémineuses professionnelles, découvrent gaiement l’amour sans le pénis. Un personnage s’interroge sur le fait qu’à deux reprises on vient d’employer devant lui ce mot, « décent ». La décence, et les culpabilités enfouies d’un homme qui a peut-être autrefois envoyé un homme vers un enfer judiciaire mais a construit sa vie professionnelle – et peut-être sexuelle – sur deux brèves rencontres dans un jardinet de banlieue et devant un siphon bouché où il apprit qu’Ajax, avant de devenir poudre à récurer, était un héros de la mythologie grecque. Rien de si événementiel, cependant : c’est précisément dans les silences, la retenue, la vie empêchée, que Swift brille.
Le thriller à l’envers
 Jon McGregor, la quarantaine, et qui a passé six années à écrire Réservoir 13, a construit, en le montant comme un film, un petit chef-d’œuvre de roman rural en forme de thriller qui piège le lecteur de bout en bout. Et mieux que cela, le passionne.
Jon McGregor, la quarantaine, et qui a passé six années à écrire Réservoir 13, a construit, en le montant comme un film, un petit chef-d’œuvre de roman rural en forme de thriller qui piège le lecteur de bout en bout. Et mieux que cela, le passionne.
Tous les ingrédients sont là. Rebecca, Becky, Bex, 13 ans, 1,55 m, haut blanc à capuche, gilet bleu, cheveux blonds aux épaules, disparaît un 31 décembre d’un village du Peak district, dans le Derbyshire, où elle est venue en vacances avec ses parents, dans les granges reconverties des Hunter. Outre les habitants qui partent en battue vers les landes, les immenses réservoirs d’eau et les anciennes mines de plomb, déboulent bien sûr les policiers, la presse, les hélicoptères qui tournent là-haut. Au Gladstone, on sert beaucoup à boire. Mais une semaine, un mois, plusieurs mois passent, l’adolescente n’est pas retrouvée.
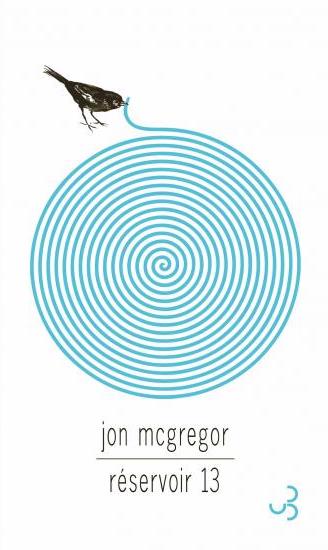 Réservoir 13 est la chronique des treize années qui suivent la disparition. Il y a, bien sûr, le persistant tremblement qui suit les faits divers là où ils ont eu lieu, et chaque excursion, chaque plongeon, ouverture de chaudière réactivent celle-ci. Il y a des soupçons non dits, un père qui revient et n’a pas l’air de tourner rond. Des ados qui connaissaient Rebecca et sont restés cois. Des incendies parfois.
Réservoir 13 est la chronique des treize années qui suivent la disparition. Il y a, bien sûr, le persistant tremblement qui suit les faits divers là où ils ont eu lieu, et chaque excursion, chaque plongeon, ouverture de chaudière réactivent celle-ci. Il y a des soupçons non dits, un père qui revient et n’a pas l’air de tourner rond. Des ados qui connaissaient Rebecca et sont restés cois. Des incendies parfois.
Mais la vie du village reprend son cours, intègre l’inquiétude, et c’est ici que le récit bascule. Le thriller change d’objet. Ceux qui forment le décor, les habitants, le cadre habituel de l’intrigue deviennent l’élément central, Irène et son fils sans doute Asperger, M. Wilson son chien et sa hanche, Su qui travaille à la BBC et Martin qui porte à bout de bras le journal local, les fils Jackson et les moutons, Gordon le séducteur, Susanna la « hippie » qui ouvre un cours de yoga, et du mouvement, amours qui commencent mais peuvent tourner court, séparations, divorces, morts, études au loin et retour pour certains. Le boucher qui fait faillite et se retrouve à vendre la viande pré-emballée au supermarché, les Londoniens qui achètent des résidences secondaires, les gens qui sont licenciés, le prêtre qui est une femme et qui s’en va, le match annuel, le théâtre amateur. Le tout raconté comme à distance – on a vu, on a su – et porté, enveloppé, de court chapitre en court chapitre, par les strates de vie animale qui bruisse et occupe l’espace (blaireaux et renards anglais paraissant plus civilisés que leurs camarades français), la vie végétale omniprésente, du jardin communautaire aux arbres qui bordent rivières et réservoirs. Ici seulement la langue, délibérément en retenue et comme factuelle, se charge de lyrisme.
Désormais habitué de la sélection du Booker Prize et auteur à succès, Jon McGregor retoque assez sèchement ceux qui lui disent à quel point il écrit merveilleusement sur les « gens ordinaires ». Qui n’existent que dans les yeux de ceux qui les évoquent : « la vie de chacun est intéressante, compliquée et nuancée ».
Il dit encore qu’il a été heureux d’écrire (chaque histoire, chaque thème séparément, puis montage et reprise phrase à phrase pour fondre et parvenir à la fluidité) dans une période comprise entre la crise de 2001 et le vote sur le Brexit, qui dans ce village sans nom, aurait divisé comme ailleurs. « Mais en regardant mes personnages, je crois que je peux dire qui aurait voté pour le leave, qui pour le remain… »
Dominique Conil
Livres
Graham Swift, De l’Angleterre et des Anglais, traduction de Marie-Odile Fortier-Masek, Gallimard, 21 €
Jon McGregor, Réservoir 13, traduction de Christine Laferrière, Christian Bourgois éditeur, 22 €


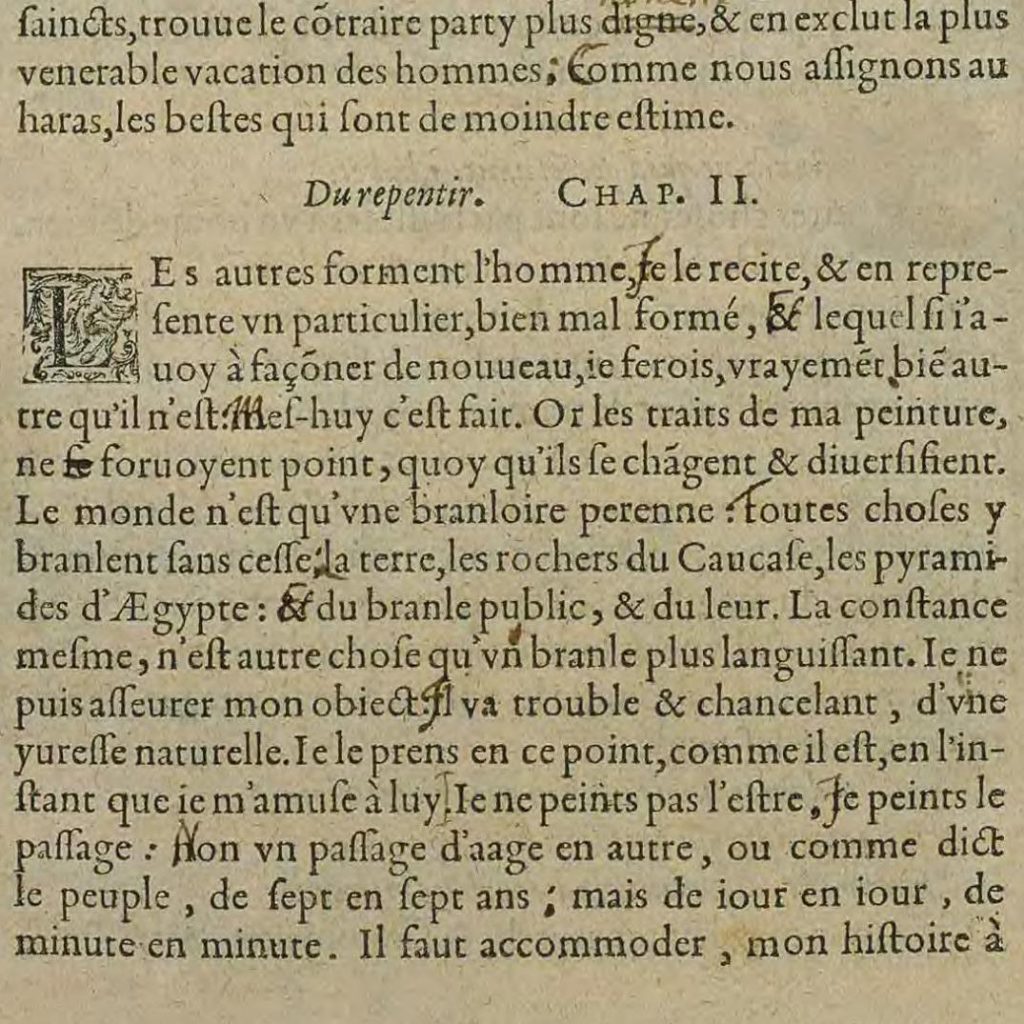




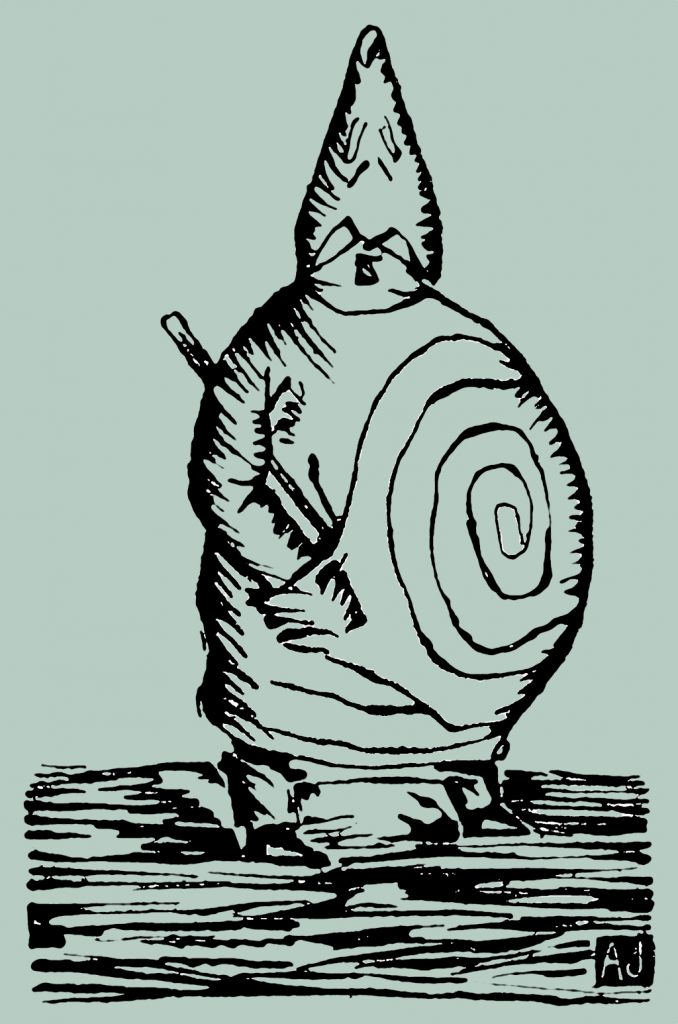

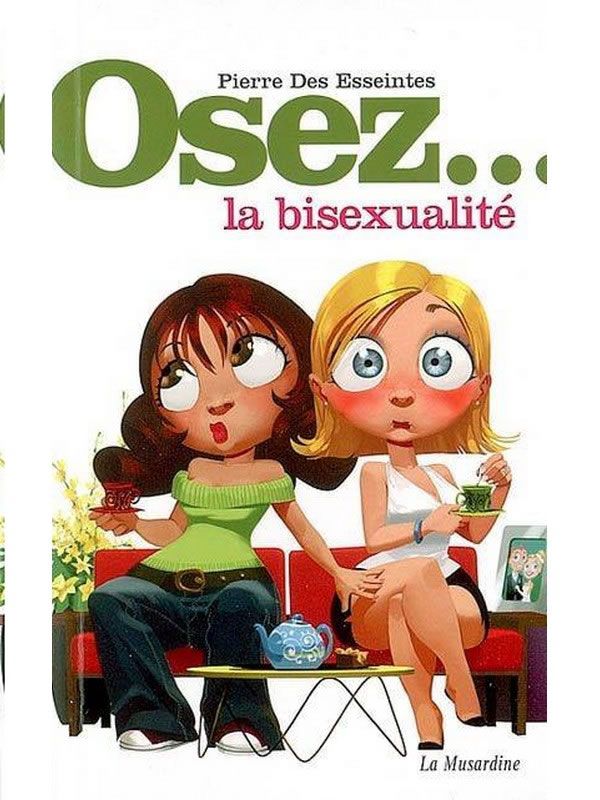
0 commentaires