« Tout va très bien pour les riches dans ce pays, nous n’avons jamais été aussi prospères. C’est une guerre de classes, et c’est ma classe qui est en train de gagner. »
La citation devenue culte de Warren Buffet [1] n’a jamais semblé si vraie que dans la France de Macron, celle où le « pognon de dingue » offert aux patrons, aux lobbys ou aux plus riches suivent des courbes inversement proportionnelles aux droits et revenus des salariés comme des plus modestes, sans parler de ce qui est promis aux services publics ou aux aides sociales.
« Le propre de l’action ouvrière, dans ce conflit, lorsqu’elle s’exagère, lorsqu’elle s’exaspère, c’est de procéder, en effet, par la brutalité visible et saisissable des actes. Ah ! Le patronat n’a pas besoin, lui, pour exercer une action violente, de gestes désordonnés et de paroles tumultueuses ! Quelques hommes se rassemblent, à huis clos, dans la sécurité, dans l’intimité d’un conseil d’administration, et à quelques-uns, sans violence, sans gestes désordonnés, sans éclat de voix, comme des diplomates causant autour du tapis vert, ils décident que le salaire raisonnable sera refusé aux ouvriers ; ils décident que les ouvriers qui continueront la lutte seront exclus, seront chassés […]. Cela ne fait pas de bruit ; c’est le travail meurtrier de la machine qui, dans son engrenage, dans ses laminoirs, dans ses courroies, a pris l’homme palpitant et criant ; la machine ne grince même pas et c’est en silence qu’elle le broie. »
Cette tirade d’un député de 1906 – le grand Jean Jaurès face au ministre de l’Intérieur d’alors, un certain Georges Clémenceau – n’a jamais semblé si vivante qu’à l’heure où la chemise déchirée d’un cadre d’Air France fait davantage réagir que les centaines d’emplois supprimés et de vies brisées pour complaire aux actionnaires.

Le 5 Octobre 2015, le DRH d’Air France avait été pris à parti, avec un autre cadre, avant d’être exfiltré par des vigiles, par une foule en colère, réunie au siège d’Air France à Roissy, à l’appel de l’intersyndicale, pour protester contre un plan de restructuration menaçant près de 3000 emplois. Le mois dernier, quatre ex-salariés se sont vus condamnés en appel à des peines de 3 à 4 mois de prison avec sursis pour violences.
« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. »
 Et c’est sur cette troisième citation, maxime de Bertolt Brecht qui claque au vent comme oriflamme sur le champ de bataille, en écho aux deux premières, que Stéphane Brizé ouvre son film. En fait de drapeau, c’est ce lambeau de la compagnie aérienne, embrasé de tant de colère, qui mit le feu aux poudres du questionnement du cinéaste, auréolé déjà de la reconnaissance critique et publique qu’avait mérité son précédent long métrage. La loi du marché : tout un programme qui vaudrait aussi pour ce film-ci, l’un comme l’autre en immersion dans la violence du capitalisme et la peau de Vincent Lindon, surface sensible s’il en est.
Et c’est sur cette troisième citation, maxime de Bertolt Brecht qui claque au vent comme oriflamme sur le champ de bataille, en écho aux deux premières, que Stéphane Brizé ouvre son film. En fait de drapeau, c’est ce lambeau de la compagnie aérienne, embrasé de tant de colère, qui mit le feu aux poudres du questionnement du cinéaste, auréolé déjà de la reconnaissance critique et publique qu’avait mérité son précédent long métrage. La loi du marché : tout un programme qui vaudrait aussi pour ce film-ci, l’un comme l’autre en immersion dans la violence du capitalisme et la peau de Vincent Lindon, surface sensible s’il en est.
Car cette entreprise de démolition que mène une élite en sécession, si bien barricadée dans ses CA ou son XVIe qu’elle refuse de faire champ commun avec le reste du pays, Brizé choisit de nous y projeter comme le ferait un film de guerre au milieu de l’apocalypse. De nous la rendre organique, aussi palpitante qu’un suspense – ou plutôt, qu’un cœur ouvert sur la table d’opération. D’en faire le principe de sa dramaturgie, en racontant cette histoire de plan social et de grève syndicale, dans une usine automobile que veut bazarder un groupe allemand, à la manière d’une épopée âpre et amère. Chanson de geste d’aujourd’hui, où l’on ferraille dur pour reconquérir des territoires et franchir des frontières, pour rester debout dans le champ et extraire l’ennemi du bunker de son hors champ ; mais où la partie de wargame grandeur nature voit chaque offensive victorieuse aussitôt anéantie d’une contre-attaque. Les pions finiront par découvrir le Roi, mais c’est lui qui les mettra échec et mat.
Acteurs non professionnels qui jouent leurs propres rôles, décor naturel des halls de gratte-ciel ou des parkings d’usines, rendu réaliste… : on reconnaît là tous les traits d’un certain cinéma social, avec son esthétique et son éthique véristes apparentées au documentaire, identifiées aux génies de Ken Loach, Peter Watkins ou des frères Dardenne. Mais il y a là une intelligence du cadre et de l’image, du son aussi, qui excède la caméra portée et la lumière crue, qui rend au septième art, en même temps que sa puissance d’incarnation, son pouvoir d’interprétation du monde, avec la grâce ou la rage d’une épure ici.
Ainsi du face à face, sur la ligne de front des négociations, entre le camp des salariés et celui des patrons : deux mondes si étanches l’un à l’autre qu’ils ne peuvent se mêler, chacun enfermé de son côté du champ / contre-champ, pas plus que ne peuvent s’entendre leurs idiomes respectives – novlangue bien policée de DRH ou de CAC 40, contre paroles du peuple, cris du cœur et phraséologies post-marxistes. Si bien que l’État lui-même, posé au centre du dispositif en la figure d’un conseiller social de l’Élysée censé servir d’arbitre au match, ne s’avère que faire figuration.
Ainsi aussi de la guerre devenue civile entre syndicats eux-mêmes, frères ennemis engagés à s’entre-tuer, puisque toujours les puissants réussissent à ce que leurs victimes se fassent la guerre entre eux plutôt qu’à eux-mêmes les coupables. Tenue par la tension du plan-séquence, une longue focale filme de l’intérieur les Assemblées qui s’improvisent dans un local sans âme, et voilà que notre œil circule d’un leader à l’autre au rythme de leurs passes d’armes, l’avant-plan occulté ou l’arrière plan bouché par les silhouettes des soldats, caméra plongée dans la mêlée et perdue tel Fabrice à Waterloo.
Ainsi enfin de ces deux scènes où les grévistes, coagulés en un seul corps collectif pour faire siège du commandement patronal, puis de leur propre fabrique, s’agrippent désespérément les uns aux autres. Ils doivent « résister » face aux CRS qui s’efforcent soit de les expulser, soit d’arracher chacun à la force du groupe – deux métaphores bien parlantes, ou plutôt hurlantes, bras tordus et poings serrés. Car si c’est surtout à coups de déclarations et de répliques qu’on s’affronte ici, ce sont au final les corps qui paient. Nos pauvres chairs d’êtres humains, vaincues par la machine, sacrifiées à la détresse, tel celui du (anti-)héros ici, tel celui du père d’Édouard Louis.
Merci donc Stéphane Brizé, puisqu’il en est ainsi de tout art de la guerre, de mettre en ordre tout ce chaos – ou peut-être l’inverse, on ne sait plus. Merci Stéphane Brizé, avec quelques autres sentinelles (tels Nicolas Silhol et son co-scénariste Nicolas Fleureau dans Corporate, thriller consacré au suicide en entreprise et au management par la terreur), de nous rappeler d’où vient et où va vraiment la violence. Merci Stéphane Brizé de nous transmettre un cocktail molotov si bien tassé, à balancer à la tronche de tous mes bons amis socio-démocrates, ceux qui donnent des leçons de savoir-vivre ou de savoir-voter, braves gens de la gauche caviar/tarama pour qui rester progressiste, c’est s’exprimer en modéré ou s’obséder de laïcité, mais la Loi Travail, plus rien à foutre [2]. Vous qui depuis des décennies déjà, avez trahi les prolétaires, fermez vos gueules enfin, et écoutez-les crier. Et l’on entendrait presque comme un chant pour nous réveiller tous, nous sortir de nos salons home DVD et nous jeter à la rue, un vieux chant révolutionnaire qui appelle au combat : Aux armes, citoyens !
Thomas Gayrard
Cinéma
En Guerre (1h53), de Stéphane Brizé, avec Vincent Lindon, Mélanie Rover…
[1] Ainsi avouait, en mai 2005 sur le plateau de CNN, ce singulier multimilliardaire philanthrope, patron de fonds d’investissements parmi les hommes les plus fortunés de la planète, connu pour vouloir payer davantage d’impôts et léguer 99% de sa fortune dans le caritatif.
[2] Spécial dédicace à Daniel Cohn-Bendit, ancien crypto-marxiste libertaire passé fan d’un Président ultra-libéral autoritaire ; ou à Luc Vaillant, qui a bien raison de se demander « et si moi aussi j’étais de droite ? », en un hallucinant article, où sur tant de paragraphes où il se rassure à cocher toutes les bonnes cases républicaines qui le font rester « de gauche » selon lui (il n’est ni antisémite ni communautariste, patriote juste comme il faut, etc.), sans même consacrer une seule ligne à la question sociale ou à la condition ouvrière, et sans même s’en rendre compte.






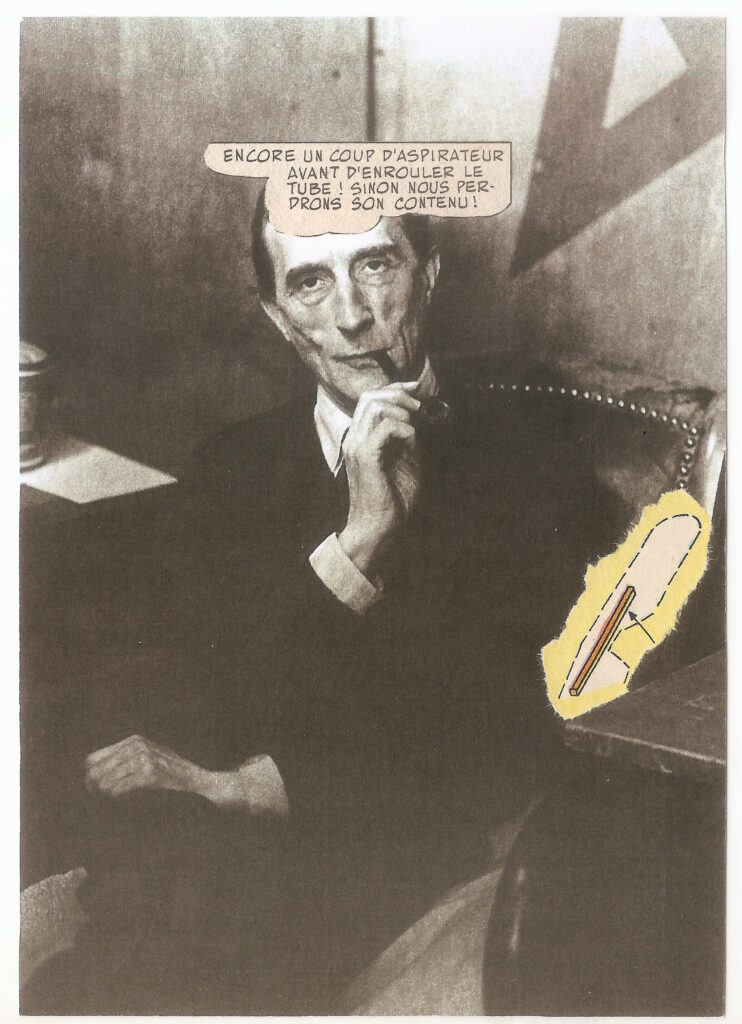


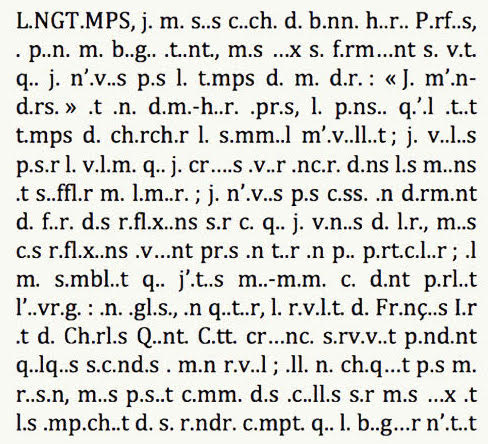
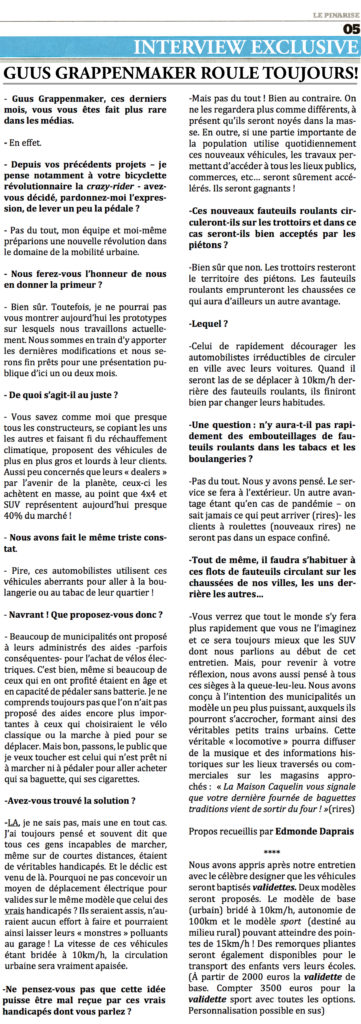


0 commentaires