Je préfère être clair : j’étais pour l’Islande. De toute éternité, tout le monde était pour l’Islande – tout le monde à part les Autrichiens, et encore.
L’Islande : une nation deux cents fois moins peuplée que la France (à qui elle a tout de même planté quatre buts lors de leurs deux dernières confrontations), un pays où, selon toute vraisemblance, les mecs s’entraînent sur des glaciers en feu, où le mot “cumulus” doit être compris comme “pluie de cendres volcaniques” – une terre régulièrement agrémentée d’oppositions trolls-vikings arbitrées par un geyser qui viendrait de perdre sa mère.
Je suis allé voir ce match parce que, au temps naïf de ma jeunesse (2015), je tenais absolument à voir un match au stade de France. On connaît la chanson : il y a eu un genre de loterie chelou et j’ai eu le malheur de gagner.
Quand j’ai pris connaissance du tirage, j’ai été pris d’un rire nerveux. Sur le papier, c’était l’affiche la moins sexy de la Voie lactée. Thomas Bernhard dans la toundra, en gros. Il faut que tu revendes ces deux places, me suis-je dit/m’a dit ma femme. Si tu te démerdes bien, tu pourras te payer un A/R pour Reykjavik et aller vaincre tes petits préjugés de merde. Mais personne n’en voulait, de ces places : les Islandais avaient dû réserver les leurs depuis 1926, et il n’était pas question de faire le moindre cadeau à des gugus ayant voté à 49,65 % pour Norbert Hofer.
Ne me restait plus qu’à m’auto-convaincre. Ça m’a pris quatre mois. Islande-Autriche. Sigur Ros vs Kurt Waldheim. L’humble caillou désertique contre le gros machin pangermanique hautain. Voilà qui était mieux.
Je n’ai pas eu besoin d’expliquer à mon fils pour qui on était. C’est une antienne universelle, dans le foot, cette espèce d’amour pour les faibles, les sans-grades, les no-palmarès. On avait été pour l’Algérie, la Corée, le Costa Rica ; maintenant, on supportait Björk et ses cousins.
Notre tribune était bourrée d’Autrichiens anxieux mais on n’entendait que les autres. 6000 supporters islandais, les gars. 6000, soit un habitant sur 55 en comptant les vieillards, les infirmes et les nouveau-nés. Comme si un million de supporters français avaient fait le voyage. Des purs, ces Islandais. Des non-euclidiens aux dents blanches affublés de casques à cornes.
L’hymne résonne. Ses ornements pseudo-monothéistes ne trompent personne. Devant toi un seul jour est comme mille ans, et mille ans un jour, Ô Seigneur, une fleur d’éternité, sur la lande tremblant, qui adore son Dieu et puis meurt. “Et puis meurt”. Le voilà, le vrai message. Ces gens sont contents de mourir, ils viennent pour ça – Walhalla attitude. Derrière nous, une jeune femme essuie ses larmes en chantant. Mon fils veut l’épouser. Qui suis-je pour l’en dissuader ?
Coup d’envoi. L’Islande pratique un genre de football que l’on a appris à connaître. C’est le football de ceux qui n’ont pas le choix. Le football des rameurs de drakkar. Tactiquement, l’affaire se résume ainsi : on défend à neuf, on plie sans rompre et, sur un malentendu, on plante une ou deux banderilles. Le secret de l’opération réside dans le taux d’efficacité des percées. Rate une frappe, mon pote, et tout est foutu.
18ème minute. Après une longue touche de Gunnarsson, Arnason prolonge de la tête, Bodvarsson récupère, contrôle et frappe du droit. Almer est aux fraises. L’Islande explose. Trop beau, ce but. Trop bleu intense. On gueule comme des perdus, et les copains d’Egon Schiele ne font même pas l’effort de nous mépriser.
Calmons-nous, fils. A ce stade, nous savons bien que, statistiquement, il nous faudra attendre cinquante minutes avant d’assister à une autre action, dans la mesure où celle-ci était déjà la deuxième de nos chouchous (la première, une frappe surpuissante de Gunnarsson qui prenait le chemin de la lucarne, s’est écrasée sur la transversale autrichienne après 2 minutes de jeu).
L’Autriche s’ébroue lentement. 35ème minute : penalty plus que litigieux. Dragovic s’élance, le ballon rebondit sur le poteau droit de Halldorsson. Merci, ô police du karma ! (Oui, oui, notre objectivité est partie s’acheter une bière à 5€, et il y a la queue).
Les rouges poussent, monopolisent le ballon. A la 60ème, Schöpf, servi plein axe par Alaba, s’infiltre dans la surface et pivote sur son pied gauche. 1-1. Fascistes.
En bons Français, nous cédons à la résignation. (Dans l’autre match, Ronaldo-Hongrie, on se dirige vers un 3-3 qui ne fait pas du tout l’affaire du Petit Peuple).
Et puis à la 93ème, alors que les Autrichiens se sont lancés à l’abordage, le miracle arrive. Sur un contre-éclair de Bjarnason, tout le pays part en contre-attaque. Cours, Bjarnason-dont-nous-ne-savons-rien !
Il s’approche. Il est là. Il pourrait tirer, mais il sert Traustason : parce qu’on est comme ça, sur notre île. Traustason reprend du bout du pied. Almer effleure le ballon en pure perte. 2-1. Dans ta face, Egon Schiele.
Le commentateur islandais perd sa voix, votre serviteur & fils perdent toute contenance, une aurore boréale dépenaillée envahit le terrain et son nom est “joie totale”.
C’est le meilleur match de l’Euro du Monde de l’Histoire, me dis-je, et la suite ne peut être que rêvée.
Tremble, perfide Albion ! Les Strákarnir okkar se moquent du réel.
Fabrice Colin
Fabrice Colin vient du jeu de rôle, et a notamment collaboré à la revue Casus Belli. Editeur aux éditions Super 8, il publie depuis vingt ans dans le domaine de l’imaginaire et du merveilleux, dans des maisons d’édition comme Mnemos ou L’Atalante. Entre autres prix, il a reçu quatre fois le Grand prix de l’Imaginaire. Il écrit aussi pour la jeunesse (notamment, la quadrilogie des Étranges Sœurs Wilcox, chez Gallimard Jeunesse). Son dernier roman, La poupée de Kafka, vient de sortir aux éditions Actes Sud.
[print_link]

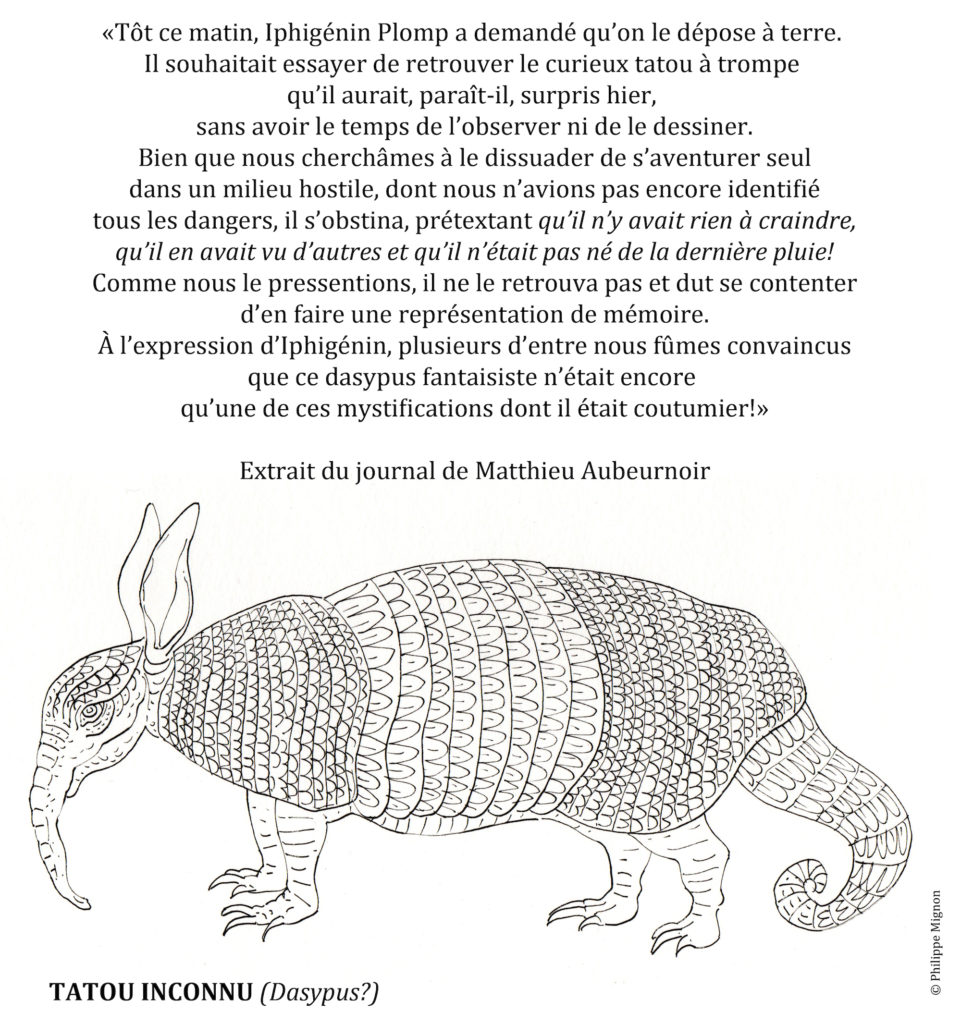







0 commentaires