Le 21 mars 1967, des étudiants occupent les chambres des filles de la cité universitaire de Nanterre pour dénoncer ces « ghettos sexuels carcéraux », jeunes hommes et jeunes femmes exigent la mixité et de pouvoir faire l’amour librement. Le 22 mars 1968, des étudiants occupent la tour administrative de la fac de Nanterre, ils pénètrent au 8e étage, « dans le sommet du phallus », la salle du conseil des professeurs [1]. Ils posent leurs fesses révoltées sur des fauteuils bleu pétrole et les chaises des mandarins, ces sièges-symboles de l’autorité répressive qu’ils rejettent. Le 9 mai, devant la Sorbonne, des étudiants font un sit-in, nouvelle attitude résistante « cool », inspirée des mouvements américains des droits civiques et hippie. Tout le mois de mai, on occupe tout, partout en France, et on adopte des manières rebelles de s’asseoir, de parler, de manger et de dormir, on va spontanément chambouler l’usage des meubles, des objets, des lieux. Improviser un design sauvage.
On monte sur les tables, sur les chaises pour mettre un lycée en grève, on dispose ces mêmes tables en rond dans la classe ou l’amphi pour faire descendre les profs de leurs estrades. On arrache les pieds des meubles pour en faire des bâtons d’auto-défense. On fait tout « ce qui ne se fait pas », surpris que cela puisse se faire « sans entraves ». « L’un des traits les plus étonnants, écrit Jean-Christophe Bailly [2], c’est que la vitesse à laquelle le cours des choses s’emballa nous prit tous par surprise ».
Dans un joyeux bordel, parfois bien organisé, on transforme les espaces intérieurs des universités, des usines et des bureaux en lutte pour en faire des dortoirs, des cantines de fortune et y vivre ensemble « autrement ». On s’empare de l’espace public, on déconstruit les rues du Quartier Latin, on construit des barricades. Sur les pavés, on crie « CRS SS » mais, sous ces pavés, on voit la plage. Et après le bruit de grenades et de ferraille, on entend le silence du pays à l’arrêt. Il a fait très beau en ce mois de mai 1968, les corps se mettent à l’aise, les filles portent plus librement mini-jupes, collants et premiers jeans en velours qui étaient interdits au lycée. Les garçons ont lâché la cravate pour le col roulé, mais portent encore des tenues classiques. Un look gaucho va se dessiner, en treillis vert comme le Che et chaussures Clarks à la mode, les cheveux vont se lâcher et pousser.
La relation entre intérieur et extérieur devient plus fluide. On vit dans la rue, au travail un peu comme chez soi, on veut vivre à la maison comme sur le macadam-agora. La famille, bourgeoise ou ouvrière, est malmenée, dépassée, ou ragaillardie par les irruptions des jeunes qui n’ont plus d’horaires, qui veulent tout, tout de suite. Les étudiants poursuivis par les flics vont se réfugier chez certains riverains du quartier latin, dans les cafés qui leur offrent à boire et à manger.
Dans Depuis maintenant, l’écrivaine Leslie Kaplan décrit l’usine en grève en 68 : « Une fois, Marie m’avait demandé la première chose qui me venait à l’esprit à propos de la grève. J’avais dit : l’espace. L’espace sans fonction, la sensation de l’espace. Les escaliers et les couloirs. La cour et les chaînes. Les gens qui se promenaient, regardaient. Les uns et les autres se faisaient visiter leur atelier, leur coin. Ils expliquaient, considéraient l’ensemble, s’appropriaient… Sensation physique, comme d’un corps en face d’un autre corps... Grimper aux portes, s’asseoir par terre, s’appuyer contre un mur… L’espace s’ouvrait, énorme… l’espace vide, et le temps… On était amené à penser, à penser ce que c’est, penser… Il faisait beau, c’est vrai. » Des histoires d’amour se nouent et se défont. Les rituels de vie explosent, la subversion devient fête surprise. « Faites l’amour et recommencez » ou « Plus rien ne sera jamais plus comme avant ».
Parmi tous les mots d’ordre qui ont fleuri sur les murs, « Cache toi, objet » est une injonction claire. Il est relayé par « Consommez plus, vous vivrez moins » ou « La société est une plante carnivore ». Ce design graphique des rues, hilarant et populaire comme les affiches agitprop de l’atelier de l’école des Beaux-Arts, va entrer en résonance avec les livres critiques des années 1960 françaises. Tous ces ouvrages s’attachent à décoder les objets et le consumérisme. Les Choses, de Georges Perec, décrivent minutieusement les attitudes d’un couple moderne face aux choses matérielles. Jusqu’à leur abdication. Le situationniste Guy Debord démine la civilisation du loisir et la société du spectacle. 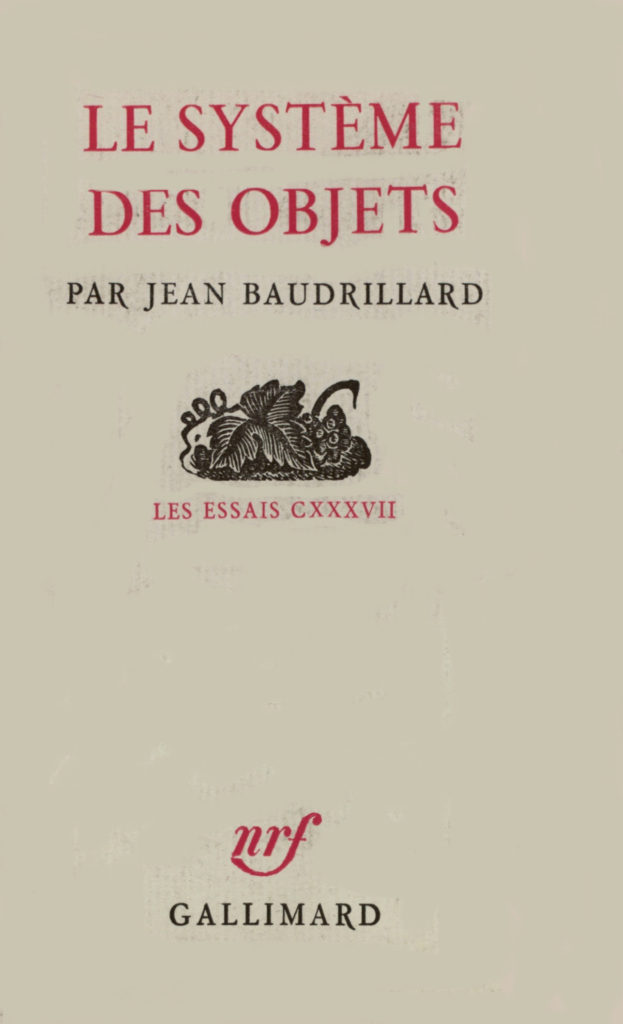 Dans Mythologies, Roland Barthes met à jour les signes qui se dissimulent derrière nos nouveaux mythes, comme la DS-cathédrale. Jean Baudrillard est pile au rendez-vous, Le Système des objets paraît juste avant Mai 68. Les objets, anciens meubles-monuments patriarcaux et objets modernes escamotables, ne sont pas que style et fonction. Ils forment un système cohérent de signes sociaux dont le message publicitaire, « discours disproportionné », est devenu l’objet idéal révélateur.
Dans Mythologies, Roland Barthes met à jour les signes qui se dissimulent derrière nos nouveaux mythes, comme la DS-cathédrale. Jean Baudrillard est pile au rendez-vous, Le Système des objets paraît juste avant Mai 68. Les objets, anciens meubles-monuments patriarcaux et objets modernes escamotables, ne sont pas que style et fonction. Ils forment un système cohérent de signes sociaux dont le message publicitaire, « discours disproportionné », est devenu l’objet idéal révélateur.
Alors regarder Mai 68 du côté du mode de vie, du côté de l’architecture intérieure, du design (même si ce mot n’est pas encore utilisé en France), n’est pas anecdotique. « On veut changer toute la vie ! » Le designer italien Ettorre Sottsass est tout à fait dans le coup quand il dit : « Faire du design, ce n’est pas donner forme à un produit plus ou moins stupide pour une industrie plus ou moins luxueuse. Pour moi le design est une façon de débattre de la vie. » Le design, né et systématisé avec la révolution industrielle, a été immédiatement placé en responsabilité politique et sociale. Pas étonnant qu’il ait été prêt à faire les barricades. Nombre de designers, particulièrement les italiens, ont anticipé, comme une utopie, tout ce qui va exploser en 68, et après plus massivement dans les années 1970, dans nos maisons, appartements.
On le sait, des bouleversements incroyables ont fait irruption dans nos paysages domestiques. Dans Le vrai Lieu, Annie Ernaux constate : « Si l’on compare les villes, l’intérieur des maisons, la différence est certainement plus grande entre 1950 et 2000 qu’entre 1850 et 1950. » La reconstruction de l’après guerre a en effet produit en masse des logements sociaux plus grands et confortables, où les familles populaires vont soudain disposer, comme les bourgeois, mais avec d’autres codes, de cuisines séparées, de salle d’eau avec douche, de plusieurs chambres pour une famille nombreuse, et de salons surtout, ou « séjours ». La France se modernise, la croissance et l’emploi sont là, et on peut acheter tout ce qui se présente à crédit. Les objets s’électrisent, la réclame les fait désirer, machines à laver et cocote-minute veulent libérer les femmes qui deviennent dans leurs cuisine équipées « des plantes vertes à tête pivotantes », les hommes vrombissent en voiture. Boris Vian chante « Ah, Gudule ! Viens m’embrasser / Et je te donnerai / Un frigidaire / Un joli scooter / Un atomixaire… / Et nous serons heureux. »
C’est dans cette reconstruction moderniste effrénée que la jeunesse du baby-boom fait son entrée massive, elle s’affirme vite en rupture avec parents et grands-parents, invente ses loisirs et plaisirs spécifiques. Si la révolte se répand comme une tache d’huile inflammable en 68, c’est qu’elle a été bien attisée par une multitude de mouvements artistiques et politiques. Où l’on trouve les dadaïstes, la Beat Generation, le Pop Art, le psychédélisme, l’Internationale situationniste, la mode, la musique – jazz, yéyé, rock et pop –, l’esprit hippie, la pilule, la Nouvelle Vague, le Nouveau roman, la psychanalyse de Freud et Reich, les voyages en Asie ou vers l’Orient, la critique des bureaucraties communistes, les luttes « héroïques ! » de Cuba et du Vietnam… Et le design, comme tous les arts, s’est nourri de tout ce kaléidoscope hétéroclite. Dans ce grand bain contre-culturel coloré et flamboyant, chacun cherche son Graal, sa petite mythologie.

Roger Tallon, Téléviseur portatif P111, Téléavia, 1963 © Les arts Décoratifs, Paris / A.D.A.G.P. 2016
Alors, les tourne-disque, le transistor, objet mobile et héros de 68, les premières chaines Hifi, la télé-meuble ou la portable Téléavia (1963) de Roger Tallon, tous ces nouveaux objets d’information et de divertissement (d’asservissement ?) vont percuter les intérieurs comme jamais. Fini d’écouter religieusement, comme dans les années 1940 et 1950, le gros poste de radio assis à côté de lui ; de regarder, sages comme images, Thierry La Fronde, Âge tendre et Tête de bois ou Dim, Dam Dom sur la grosse télévision des grands-parents, autour de la table de salle-à-manger Henri II, sur des chaises rigides. On rejette ces vieux meubles qui organisent l’ordonnancement étriqué de la famille, de la vie en société, parfaitement représentée à Colombey-les-Deux-É glises par La Boisserie du vieux général de Gaulle aux meubles raides et anciens.
La télé, cette invasive qui apporte le monde dans les séjours, fait entrer avec elle canapés, tables basses, poufs, coussins pour s’écrouler. On veut de la souplesse, de la liberté corporelle, de la légèreté, une certaine érotisation des meubles, du vide et du confort, on se décolle des murs. Ce sont les matériaux nouveaux comme tous les plastiques qui permettent de nouvelles formes. Le canapé va être entouré par des bibliothèques moins sacralisées, le livre de poche a démocratisé la lecture. Au sol, les moquettes apparaissent, profondes ou pas. Les luminaires changent de formes avec le néon. Tout se pare de matières colorées, la vaisselle en plastique remplace la fragile porcelaine, le Formica détrône le bois, dans ces années Prisunic, Tupperware et Club Med.
Le plastique-roi est particulièrement scruté par Roland Barthes : « Malgré ses noms de berger grec (Polystyrène, Phénoplaste, Polyvinyle, Polyéthylène), le plastique… est essentiellement une substance alchimique… La hiérarchie des substances est abolie, une seule les remplace toutes : le plastique. Le monde entier peut être plastifié, et la vie elle-même, puisque, paraît-il, on commence à fabriquer des aortes en plastiques. » Et Baudrillard écrit à propos de ces nouveaux meubles allégés : « Cette table neutre, légère, escamotable, le lit sans pieds, sans cadre, sans ciel, qui est comme le degré zéro du lit, tous ces objets de lignes pures qui n’ont même plus l’air de ce qu’ils sont, réduits à leur plus simples appareils… Ce qui a a été libéré en eux… c’est leur fonction. Celle-ci n’est plus obscurcie par la théâtralité morale des vieux meubles. »
Le fauteuil emblématique de cette année-là, qui n’a pas l’air de ce qu’il est, est créé exactement en 68. C’est le Sacco, conçu par Piero Gatti, Cesare Paolini et Franco Teodoro (Zanotta). Inspiré du « sac » qu’utilisaient les paysans en Italie pour récolter les feuilles de châtaignier destinées à rembourrer leurs matelas, composé de billes de polystyrène, ce siège est une rupture avec la bonne tenue, il se répand comme une nouvelle esthétique anti-bourgeoise, informe, le siège « pour flirter ». Il casse les lignes droites d’un design moderne trop fonctionnel, invente une autre mise en scène, plus pop, moins froide. À ses côtés, les éléments de rangements mobiles et empilables d’Anna Castelli Kartell (1967) se poussent facilement. Les lampes ne ressemblent plus à des lampes, comme l’Eclisse et son réflecteur mobile de Vico Magistretti (1965). Tous ces nouveaux produits bizarres viennent d’Italie.
Car si dans les années 1950, c’est le « beau » design américain et streamline qui a séduit et innové, des cuisines ouvertes équipées aux sièges révolutionnaires de Ray et Charles Eames, dans les années 1960, c’est l’Italie qui monte au front, de manière radicale et contestataire, avec forces débats et polémiques. Les architectes des mouvements Archizoom et Superstudio, très politisés, vont particulièrement se servir du design pour fustiger la société capitaliste, la consommation, le progrès asservissant et la fonctionnalité moderniste industrielle standardisante. Promulguer les œuvres manifestes d’un « anti-design », comme la chaise Mies si oblique que l’on ne peut plus s’y asseoir, et défendre des productions plus artisanales. Ils s’amusent beaucoup, certains vont même créer des boîtes de nuit polito-utopistes. Parmi ces architectes trublions du bon goût : Ettore Sottsass, Andréa Branzi, Enzo Mari, Alessandro Mendini, Gaetano Pesce, Massimo Morozzi…

L’Altro Mondo, Rimini, 1967. Architectes: Giorgio Ceretti, Pietro Derossi, Riccardo Rosso. Photographie d’époque, courtesy Pietro Derossi
En France, le design n’est pas aussi combattant et intello, Pierre Paulin ne théorise pas, mais il observe, voyage, saisit intuitivement l’air du temps, et projette mille manières de s’asseoir au plus près du sol, inspirées du tatami japonais ou du tapis oriental. Dès 1963, il imagine pour les jeunes La Langue, les Rubans, les Champignons, assises aux formes organiques, sensuelles, dont les coques sont moulées dans le jersey, cachant leurs structures. Ces icônes sculpturales participent à une deuxième modernité plus jouissive. Particulièrement, son siège, inclassable, pour Roche-Bobois, dessiné dès 1965, qui transforme un tapis aux bords relevés en divan collectif. On lui disait : « Mais c’est un baisodrome ! » Le Danois Werner Panton invente dans le même temps des cellules « psychédéliques » formant des ensembles colorés, composés de formes incurvées et de lumière, le tout occupant l’intégralité de l’espace du sol au plafond.
Mais tout a-t-il tant changé au fin fond de toutes les maisons, de la ville à la campagne ? Ces meubles dits modernes restent minoritaires, peu édités, ils sont rêvés dans les magazines, la publicité, les salons des arts ménagers qui déplacent les foules. Ou rejetés et moqués au cinéma. Dès 1958, avec Mon oncle, Jacques Tati démonte la maison futuriste Arpel, dont la vie domestique fonctionne comme une usine, le design est y transformé en absurdes gadgets technologiques. Les sièges Djinn d’Olivier Mourgue sont vus comme des objets extraterrestres futuristes dans 2001, l’Odyssée de l’espace, sorti en salles en 68.  Dans La Piscine de Jacques Deray (1969), les Module 400 en métal et mousse noire alvéolée de Roger Tallon, ou son Lit métamorphique trapézoïdal en plastique moulé, sont regardés comme des ovnis. Qui se cognent contre la pesanteur du style, contre la tradition Arts décoratifs française, si tenaces en France.
Dans La Piscine de Jacques Deray (1969), les Module 400 en métal et mousse noire alvéolée de Roger Tallon, ou son Lit métamorphique trapézoïdal en plastique moulé, sont regardés comme des ovnis. Qui se cognent contre la pesanteur du style, contre la tradition Arts décoratifs française, si tenaces en France.
Pourtant mai 68 va débloquer cette envie de vivre moins coincé. Non sans contradiction, entre rejet de la consommation capitaliste et envie de consommer ces nouveaux objets désirables qui représentent aussi une libération des espaces et des corps. Les jeunes, qui n’ont pas les moyens d’acheter ces nouveautés trop chères, vont se débrouiller dans leurs piaules, ou dans les communautés. Bricoler des étagères avec des briques et des planches récupérées, transformer de simples plaques de mousse en lits. Et mélanger tout cela avec des petits meubles et objets chinés aux Puces. Réunir le moderne tabouret pas cher Tam Tam en plastique, créé pile en 68, et une vieille commode branlante repeinte. Si on ne pédale pas comme les Vietnamiens pour faire son électricité, on va refuser un certain temps le gaspillage, particulièrement dans les communautés installées dans le Sud de la France qui vont adopter ces systèmes D, dans un esprit nature préfigurant l’écologie.
Dans les années 1970, les designers italiens vont encore exacerber leurs recherches ironiques. En 1969, le collectif Archizoom expose « No Stop City », qui connait un fort retentissement : ce plan urbain pour une ville artificiellement éclairée et climatisée exacerbe avec dérision le modernisme à l’extrême.
Ugo La Pietra décloisonne les disciplines, abolit les frontières entre intérieur et extérieur. La ville devient son objet privilégié, il la décode, la détourne avec des installations, il déplace des sofas ou des lits dans la rue. Et inversement. « Habiter la ville, c’est être partout chez soi », dit-il. Avec la Maison télématique (71-72), il anticipe une cellule d’habitation connectée avec des informations diffusées sur des écrans placés en ville.
En 1974, Enzo Mari, crypto-marxiste, publie Proposta per un’autoprogettazione. Il donne accès aux plans de construction de meubles en bois, facilement réalisables à l’aide de planches, d’un marteau et de quelques clous. N’importe qui devait pouvoir meubler en deux jours son appartement en tables, chaises, bancs, armoires, bibliothèques, bureaux et lits. Un manifeste contre la société de consommation.
 Un objet avait aussi un look soixante-huitard, c’est la Valentine, machine à écrire Olivetti de Sottsass, qui va séduire nombre de gauchistes en 69. Elle est rouge, portative, pop, pratique pour taper les tracts. Mais « la Valentine, c’est un désastre ! racontera plus tard le maestro. Je voulais une machine populaire, pas chère. Le programme a changé : en plastique rigide, donc plus coûteuse, elle est devenue la machine de tous les intellos du monde. »
Un objet avait aussi un look soixante-huitard, c’est la Valentine, machine à écrire Olivetti de Sottsass, qui va séduire nombre de gauchistes en 69. Elle est rouge, portative, pop, pratique pour taper les tracts. Mais « la Valentine, c’est un désastre ! racontera plus tard le maestro. Je voulais une machine populaire, pas chère. Le programme a changé : en plastique rigide, donc plus coûteuse, elle est devenue la machine de tous les intellos du monde. »
En France, le designer se nomme encore « dessinateur industriel », le design, « esthétique ou beauté industrielle ». Ce n’est que vers 68 que le mot design va être écrit et employé, dans l’Express. Pour le réduire à un style plutôt qu’à une démarche, un projet social. Il ne sera vraiment popularisé que dans les années 1980, avec Philippe Starck.
Design ou pas design, l’éditeur Michel Roset explique clairement que le Togo, de Michel Ducaroy (1973) a été créé en écho à 1968. C’est un siège-coussin, « en forme de tube de dentifrice replié sur lui-même comme un tuyau de poêle et fermé aux deux bouts », qui a l’air fripé avec ses plis. Il dénote alors complètement dans le paysage de l’ameublement. Le clic-clac Gao de Cinna sera le symbole suivant de cette période, ou en un clic clac, on transforme facilement ce canapé en lit. Tout le monde en a un, François Mitterrand en avait deux.
Le Britannique Terence Conran va bien comprendre ce qui s’est passé en 68, lui qui avait déjà saisi l’esprit Singing London quand il a créé Habitat en 1964. Il ouvre son premier magasin en 1973 à Montparnasse, à Paris. Avec le slogan « L’utile peut être beau et le beau accessible », l’enseigne veut attirer les jeunes modernes en quête de fantaisie, elle séduit les post-soixante-huitards babas. Profusion de couleurs, mélanges des cultures du monde, tous les articles destinés à la maison sont réunis dans un seul magasin self-service, dans un art de vivre global, avec du jazz en fond sonore. De nouveaux produits aèrent les intérieurs français : tables à tréteaux, meubles à roulettes, « la » couette, les boules japonaises, le pin naturel, mélange de bois et plastique, de chrome et lave, tout cela correspond à la façon de vivre de l’après-68. La brique à poulet fait un tabac, on propose aussi une nouvelle manière de manger.
Pierre Paulin, anar de gauche, « qui n’a pas été dans le coup en 68 », a bien compris le place jouissive que la jeunesse des sixties entendait occuper dans la société. À partir de 1969, il va servir un autre pouvoir, le vainqueur de droite « des événements », Georges Pompidou. À l’Élysée, il va aménager un salon, un fumoir, une bibliothèque et une salle à manger pour le couple présidentiel féru d’art moderne. Il crée « des choses lisses comme des galets », il re-sculpte les pièces avec du tissu élastique pour créer une sorte de tente intérieure, un cocon. La modernité fait son entrée au Palais en 1972, avec verre, plastique, formes arrondies et trompettes polémiques. « Cela m’a valu des tas d’ennuis », dira Paulin. Il y avait un climat très anti-Pompidou. La gauche me prenait pour un déviationniste, la droite trouvait cela trop onéreux. Avec le recul, alors que certains de mes meubles n’ont pas pris une ride, cet aménagement était un peu vieillot, conforme à l’idée que l’on se fait de la bourgeoisie. Au beige, j’aurais préféré le bleu. » En 1974, Giscard élimine ce travail, fait retour au style Louis XV. Mais Paulin fera un bureau pour François Mitterrand, et beaucoup de designers vont créer pour l’État grâce à Jack Lang.

Pierre Paulin, Siège Déclive (1968), par Pierre Paulin (1927-2009) © Coll. Centre Pompidou, musée national d’art moderne / Photo P. Migeat
Toutes les désirs de vivre autrement vont se ranger, devenir plus classiques ou vintage, être rattrapés par une hyper-consommation encore plus violente, elle qui avait été si honnie. Les designers italiens vont finir par proposer leurs icônes contestataires, devenues luxueuses pièces d’exception, de collections dans les galeries, les ventes, les musées.
Et aujourd’hui ? Et si la récupération et le réemploi des matériaux, l’autoconstruction des Zad ou des squats, le design social des collectifs pluridisciplinaires, les fablabs mutualisés, l’open source étaient des poursuites très concrètes, pragmatiques, sans dogme, de ce qui a été improvisé en mai ? Même sans s’y référer, c’est si loin. Avec les rêves et l’optimisme en moins, même si certains se nomment Encore Heureux !
Anne-Marie Fèvre
Design
[1] Le Roman vrai de Mai 68, Patrick Fillioud, Lemieux éditeur, 2016, 28 euros.
[2] Un arbre en mai, Jean-Christophe Bailly, Seuil, 2018, 10 euros.
À voir : « Mai 68. L’architecture aussi ! », Cité de l’architecture, 1, place du Trocadéro et du 11 novembre, 75016 Paris. Jusqu’au 17 septembre 2018.


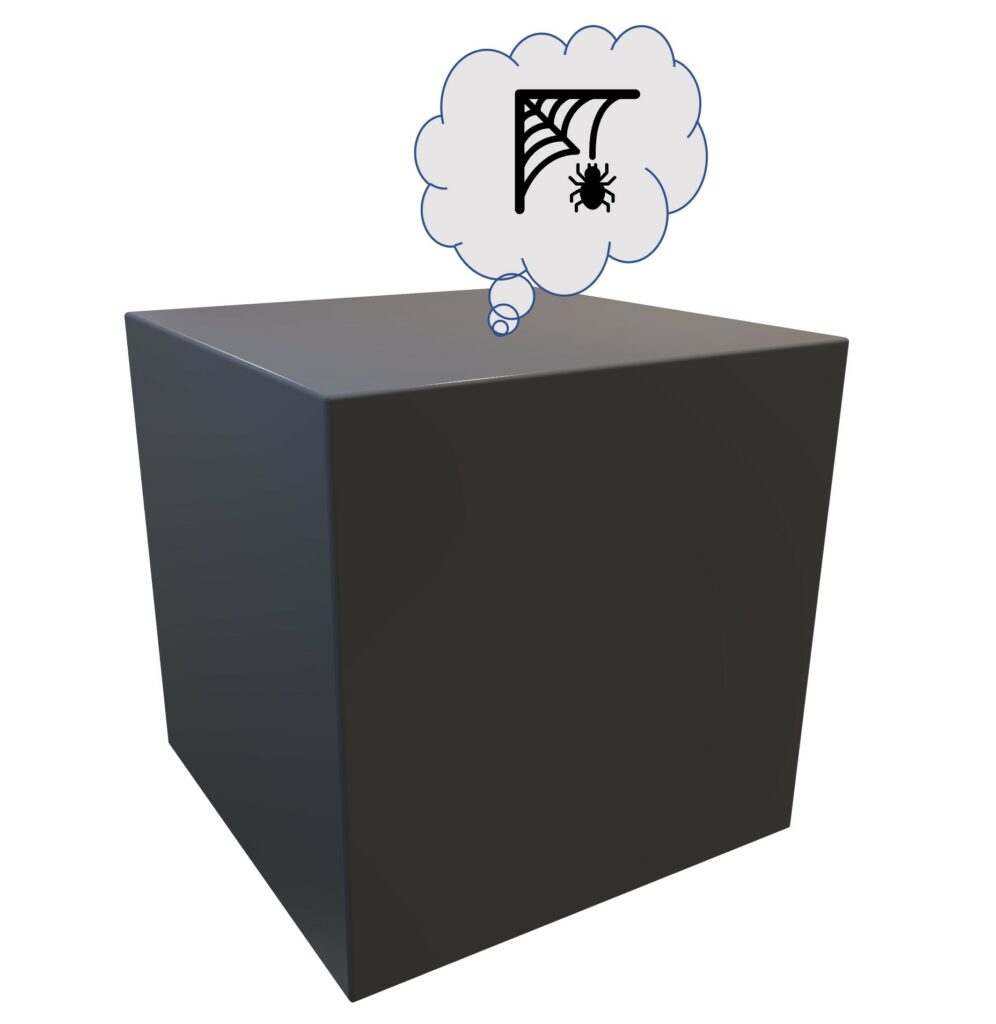
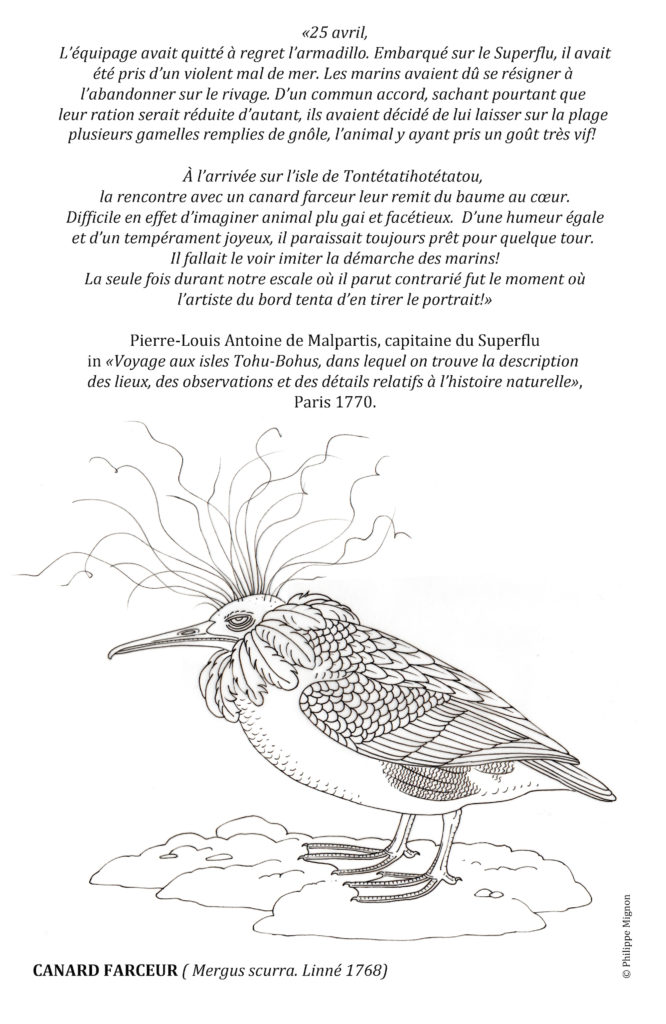






0 commentaires