Il est des œuvres qui vous engourdissent. Ce sont des œuvres froides, silencieuses, comme les mondes désertés de Giorgio De Chirico, avec leurs espaces plans, leurs façades alignées, leurs monuments, leurs ombres longues et plates, leur angoisse de désert.

“Rudiments” par Maude Maris (2015), huile sur toile, 150 x 250 cm. Cliquer sur l’image pour l’agrandir.
Les grandes peintures que Maude Maris présente actuellement à la galerie Isabelle Gounod appartiennent à cette famille. Maude Maris construit des scènes infinies, où aucune ligne d’horizon n’interrompt la modulation des couleurs (blancs, gris pâles ou sombres, bleus francs, verts tendres…), où le temps comme l’espace semblent avoir disparu, et au milieu desquelles s’élèvent de précaires constructions faites de cylindres rosés, de blancheurs plissées de statues, de morceaux de pierre bruts. Avec ces éléments épars, Maude Maris élève des colonnades, des arches, des blocs compacts – jamais de tas ou d’éparpillements : la verticalité prime, elle encadre les épanchements et structure ce rêve de pierre.
Les ruines sont précises et aseptisées. Elles se reflètent dans des sols aux luisances de linoléum ou y plaquent une ombre stricte. La lumière, violente, tranchée, découpe les formes en plans lumineux et en méplats sombres. Ainsi, l’invisible projecteur qui semble braqué sur les Vestales, ces colonnes bipartites, telles des bustes ajustés sur des troncs, corps immobiles saisis dans une lumière pétrifiée qui les soumet à l’observation.

“Vestales” par Maude Maris (2015), huile sur toile, 160 x 130 cm. Cliquer sur l’image pour l’agrandir.
La peinture de Maude Maris est clinique. Elle ne fait l’économie d’aucune précision, et on ne s’étonne pas d’apprendre que l’artiste peint d’après photographie. La peinture est la dernière étape d’un processus en trois temps. D’abord, l’artiste réunit ses modèles. Parmi eux, il y a bien sûr des éléments minéraux, trouvés ici ou là, mais il y a aussi des moulages en plâtre, réalisés à partir d’objets (ou d’extraits d’objets) récupérés – statuettes et figurines, ustensiles, poupées, etc. L’empreinte par contact, parfaitement fidèle à la forme de ces objets, les rend étrangers à leurs origines, fonctions et destinations premières. Par le moulage, ils se rapprochent des pierres auxquelles Maude Maris les associe avant des les photographier. Vient ensuite le temps de la peinture, souvent sur (très) grand format. Ainsi, pour le spectateur placé face à la toile, l’observation révèle parfois le contour d’un pied ou d’une tête de cheval, le plissé d’une toge : une forme surgit de l’informe, mais la certitude est rarement acquise, car ces plis, qui nous semblent ceux d’un drapé sculpté de main d’homme, ne seraient-ils pas, en fait, des plissements géologiques ? Matière brute ou matière fabriquée, le doute est reconduit, qui renforce l’étrangeté des mondes de Maude Maris. Ceux-ci ont la bizarrerie des univers clos – aquariums, terrariums, et autres vivariums – où éléments naturels et artificiels se côtoient pour constituer un milieu de vie factice. Mais dans ces toiles, rien de vivant. Il n’y a pas l’espoir d’un seul mouvement, ni d’une respiration. Aussi frêles que puissent sembler certaines élévations – telles l’arche de Rudiments – l’immobilité est partout millénaire. Même les équilibres instables semblent pétrifiés dans ce minerarium que Maude Maris nomme un “Foyer” (titre donné à l’exposition en cours).

Vue de l’exposition “Foyer” de Maude Maris, à la galerie Isabelle Gounod © Rebecca Fanuele. Cliquer sur l’image pour l’agrandir.
La vie du spectateur semble parfois en trop dans ce monde fossilisé – comme pour nous permettre d’atténuer le sentiment de notre présence, une moquette sombre couvre d’ailleurs le sol de la galerie Isabelle Gounod, et absorbe le bruit de nos pas. D’ailleurs, on ne pénètre pas ce monde, on ne plonge pas dans ces tableaux. Une distance est produite, et elle est maintenue. D’abord, par un changement d’échelle : quelques indices de structure nous donnent la certitude que les objets réunis par Maud Maris sont de petites dimensions (son processus de moulage, de mise-en-scène et de photographie le confirme). Mais voilà qu’en peinture, ils ont taille de monuments. Leur agrandissement rompt l’intimité de relation que permet le petit objet : aucune des pierres de Maud Maris ne pourrait tenir au creux de la main, aucun contact n’est possible. En outre, dans toutes les compositions, une avant-scène est laissée vide, et creuse un intervalle non peuplé entre l’espace du spectateur et le monde des pierres, intervalle infranchissable par son vide même. Enfin, la touche – ou plutôt son absence – et l’extrême lissé de la couche picturale, accentuent ce travail de distanciation. La peinture ne cède pas à ses modèles, ne cahote pas à la surface accidentée d’une pierre, ne répète pas les striures d’une colonne, ne donne jamais au spectateur l’impression qu’il pourrait toucher ces objets, sentir leur texture sous son doigt. La précision de la forme fait taire la matière bavarde, la peinture disparaît dans les images qu’elle produit.
Ces images lisses demeurent longtemps. Images rémanentes d’abord – flottant quelque part entre la rétine et le cerveau –, elles s’enfoncent progressivement dans le sol meuble de la mémoire et y déposent leur empreinte silencieuse.
Nina Leger.
À voir, jusqu’au 24 octobre 2015 : Maud Maris, “Foyer”, galerie Isabelle Gounod, 13 rue Chapon, 75003 Paris. Ouvert du mardi au samedi, de 11h à 19h.
[print_link]



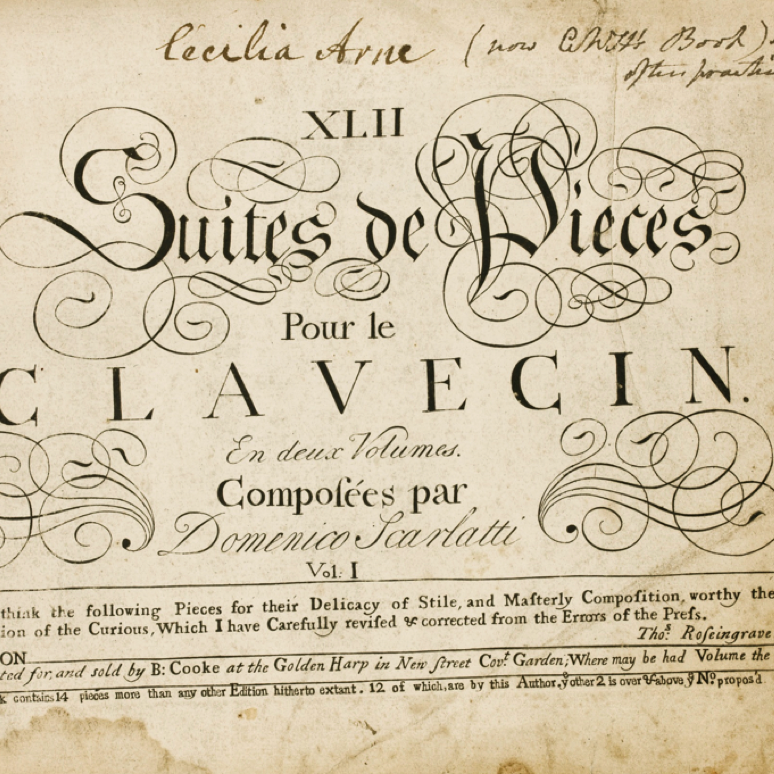

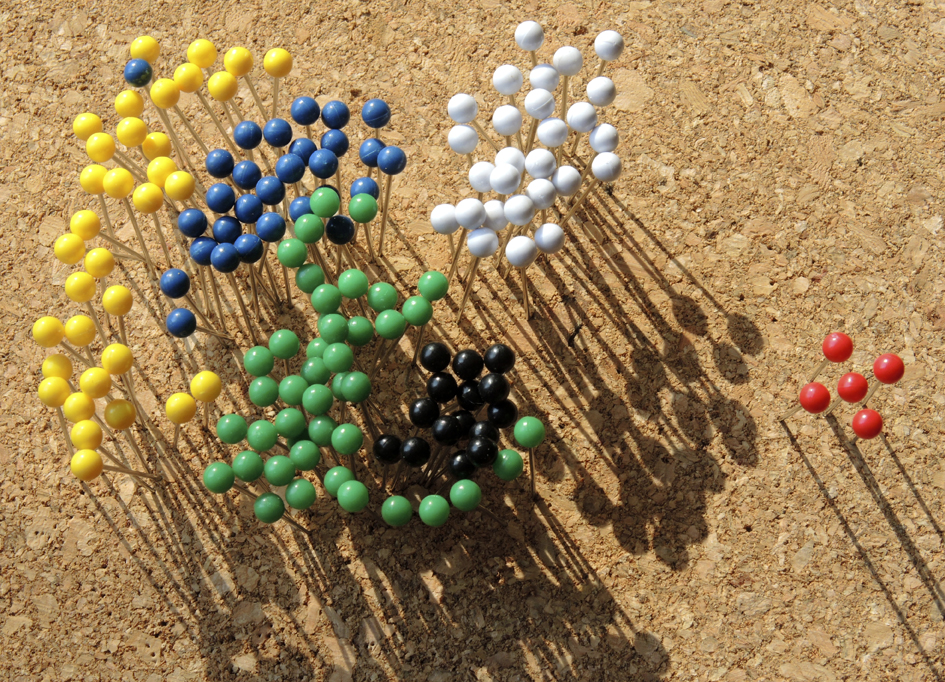
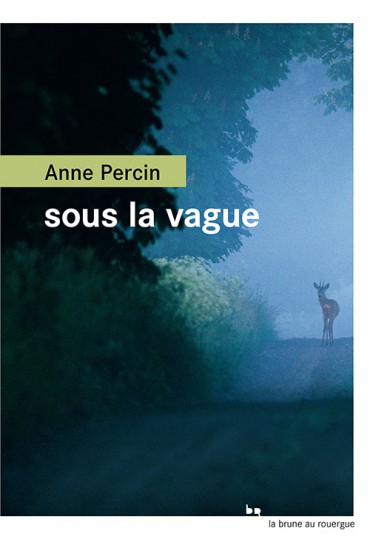


0 commentaires