Je ne suis pas chauvin.
Pas même supporteur de telle ou telle squadra mais, résidant en une ville dont le stade fut l’unique Terre promise accessible aux gamins que la mine et les aciéries rebutaient, je ne pouvais sans trépigner ou – de plus solides y ont laissé leur peau – prendre allègrement le risque d’un infarctus du myocarde, mettre ma plume au diapason des joueurs qui, moins poussifs, moins grevés d’arthrose que votre obligé ― une photographie de 1962, 1964 peut-être, militerait toutefois en faveur de mon zèle footballistique (défendre, récupérer la balle afin de l’adresser dans les meilleures conditions aux chevau-légers de l’attaque, se replier, tacler, colmater les brèches, j’ai suffisamment mouillé le maillot pour m’autoriser les présentes arabesques) ―, électrisèrent ce 14 juin 2016 les aficionados d’une fan zone en bordure de Gironde et les privilégiés massés sur les gradins du “Chaudron” stéphanois, marmite incontestablement plus bouillante que la poêle à frire bordelaise.
L’Euro n’en étant qu’au tour de chauffe (encore que… bandes fascistes et apôtres des identités nationales font exploser les thermomètres), aucun spécialiste, pas un folliculaire gagé au nombre de points d’exclamation ponctuant des phrases saturées de corticoïdes, pas une égérie du petit écran ou l’un des chroniqueurs de poids habitués à déclamer des versets claudéliens sitôt qu’une ganache expédie le ballon dans la stratosphère, n’aurait remercié les dieux du tirage au sort après avoir consulté les affiches du jour : Autriche-Hongrie d’un côté, Islande-Portugal de l’autre, la seconde rencontre se déroulant, on l’a compris, sur la pelouse de Geoffroy-Guichard tandis que l’Histoire, la grande, la sanglante, élisait l’Aquitaine, les disciples de l’inoubliable Kokcis y affrontant les fantômes du Wunderteam de 1930. Naturellement, cela sentait un peu la poudre ou, bien au-delà de l’anecdote, son manuel des sieurs Albert Malet et Jules Isaac, les plus mauvais élèves se souvenant encore des leçons qu’ils récitaient d’une voix prompte à dérailler sans trop saisir les dessous de conflits qui conduiraient,
moi mon colon, celle que j’préfère
à la boucherie de 1914-1918.
La première prestation officielle de l’équipe nationale magyare, le 12 octobre 1902, ayant correspondu au déniaisement simultané de l’Autriche ― 5 à 0 en faveur des Viennois… ―, j’appréhendais quelque neuve “tuerie” mais, le Danube somnolant dans son lit, les épigones des virtuoses hongrois de 1954 ne foulèrent qu’avec civilité une surface de réparation jonchée d’ouvrages de Miklós Szentkhuty et de Thomas Bernhardt.
Quant au Portugal, quant à l’Islande, l’opposition promettait monts et merveilles, la subtile saudade, l’inclination maritime et l’ivresse comme ascétique des Lusitaniens relevant le défi des navigateurs septentrionaux qui – “nous sommes presque uniquement constitués de ténèbres” assène Jón Kalman Stefánsson – se déclaraient prêts à verser leurs tripes de glace et de lave dans la cocotte-minute de la cité manufacturière. On ne rit pas des Vikings. Formés en salle, ils n’accusent plus rien des poulets de batterie dont on plaisantait le plumage, la “génération dorée” qu’entraîne le suédois Lars Lagerbäch se présentant sans complexe face à la seleção de Fernando Santos. Match équilibré, commentait un expert. À sens unique, rétorquait un ancien de la “révolution” des œillets, stipulant que, s’ils abattent ou débitent à la tronçonneuse des stères et des stères de brume puis, d’une pichenette, une aile de pigeon ou d’albatros, déchaînent un vent hyperboréal entre la ligne des six mètres et le rond central, les îliens n’ont ni la grâce mélancolique ni la sagacité collective des buveurs de vin doux, lesquels alternent nonchalance et fureur tout en se souvenant que l’universel, selon Miguel Torga, “c’est le local, moins les murs”. Passements de jambe, roulettes, transversales opportunes, dédoublements, ouvertures précises, appels et contre-appels, débordements latéraux, centres primés dans les concours de balistique, crochets, feintes de corps, les Islandais n’y verraient fatalement que du feu, une Björk sauvage, un Halldór Laxness élevé au rang de barde suprême, ressusciteraient-ils à la pause Grímr le Chauve ou Njáll le Brûlé : Christiano Ronaldo n’est pas qu’un bourreau des cœurs.
Tout curieux averti valant bien deux téléspectateurs, je sortis de chez moi, l’idée de prendre le pouls de la rencontre m’ayant subitement traversé la tête. Las ! On ne se refait pas. Des drapeaux rouges, quelques bannières noircies par la poussière des terrils enchevêtrant leurs flammes autour d’un bus immobilisé devant la Bourse du Travail, je courus sus à l’État et aux partisans d’une modernisation contractuelle du servage. La fête ou, tambours du Bronx à la rescousse, l’enterrement, ne dura pas, la CGT réquisitionnant ses troupes à Paris pour de plus spectaculaires funérailles. Piteux, je revins au port. Café. Sandwich. Sur l’écran, l’arbitre libérait les acteurs.
Dominateurs, les Portugais eurent tôt fait de donner le tournis à leurs rivaux d’un soir, lesquels, le but de Nani leur coupant les jambes dès la trentième minute, n’enrayaient la mécanique adverse qu’à proportion de la suffisance ou du placement litigieux d’une défense qui semblait chantonner en se dispersant un fado d’Amália Rodrigues. Moralité, l’Islande surprit les artistes, Birkir Bjarnasson égalisant d’une malléole assassine. Le temps de digérer l’offense, la cavalerie verte et rouge chargea de plus belle, confiant à son général, son monarque, son héros, la conduite d’un combat de plus en plus douteux, l’astre septième s’éteignant sans avoir brillé. Les poètes le savent : un seul être vous manque et tout est dépeuplé…
Lionel Bourg
Lionel Bourg est l’auteur de nombreux récits, d’essais plus ou moins rêveurs, de quelques poèmes et de carnets, de journaux tenus au gré de son irascible tendresse : on citera Montagne noire (2004), aux éditions Le temps qu’il fait, L’ombre lente du temps (2006), chez Fata Morgana, La croisée des errances (2011), à la Fosse aux ours, L’Échappée (2014), aux éditions L’Escampette et, plus récemment, Un Nord en moi (2015), aux éditions Le réalgar.


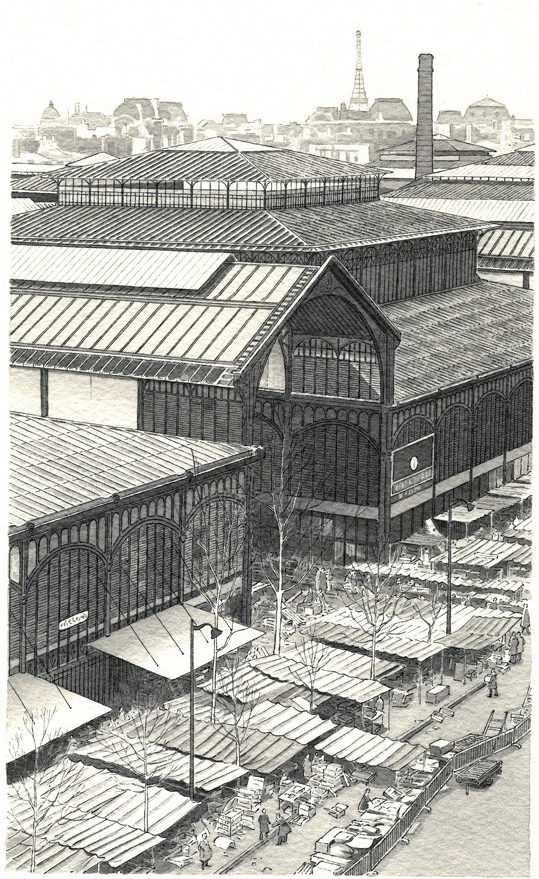

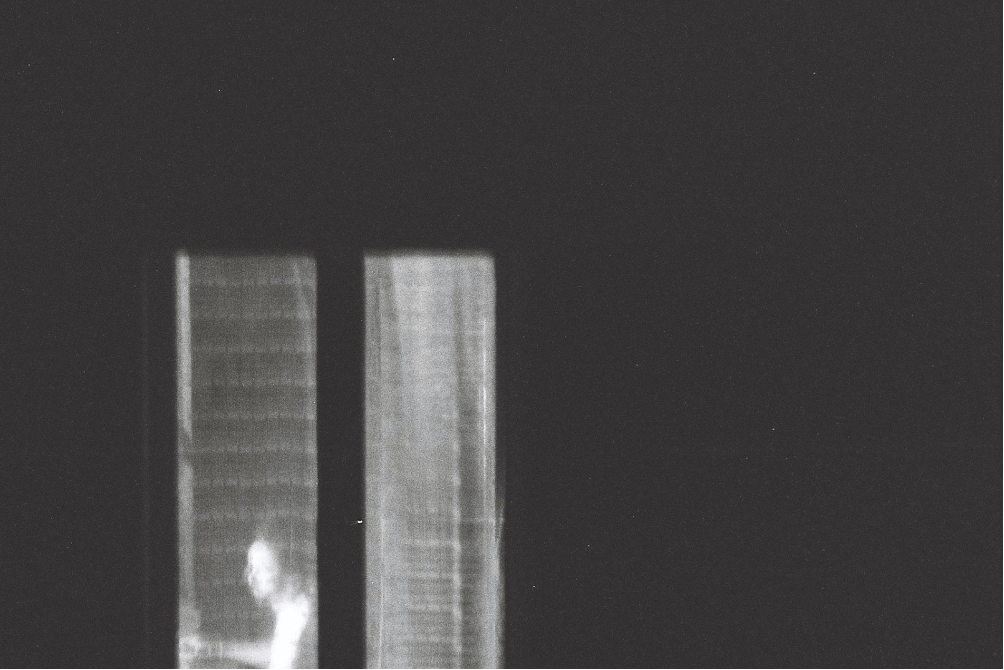
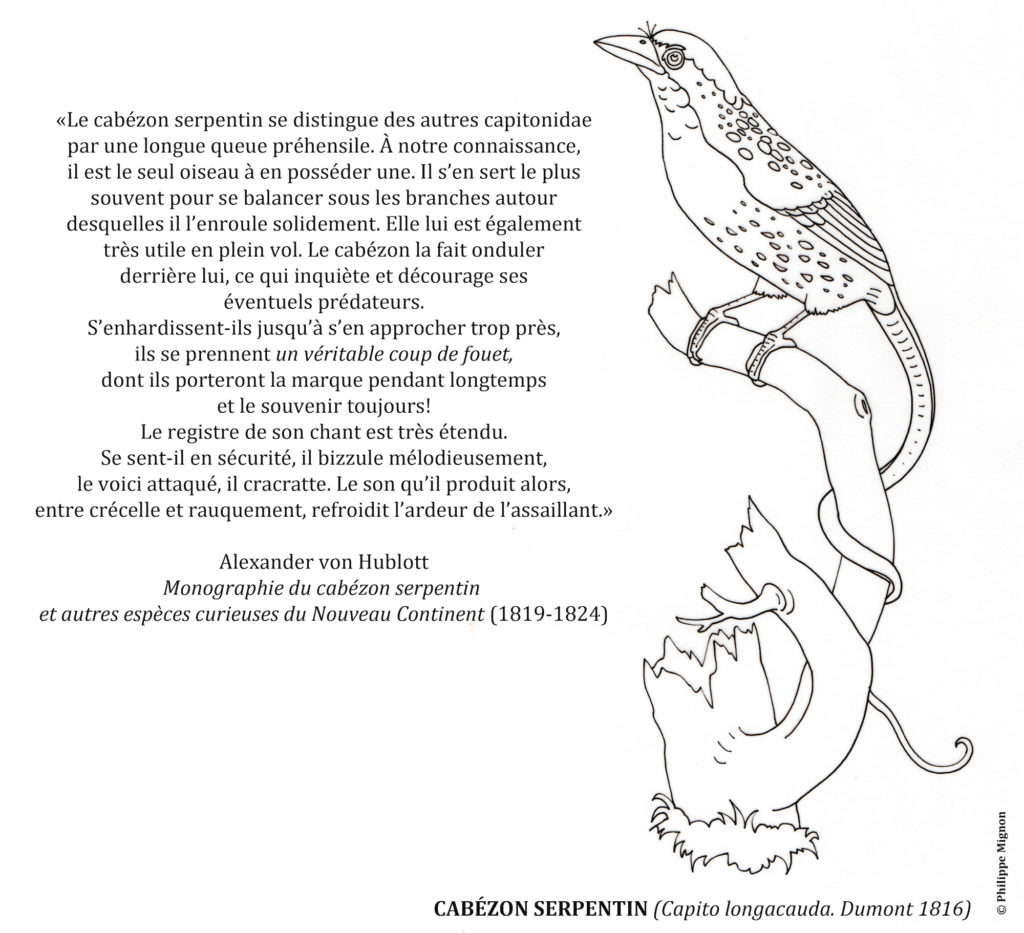
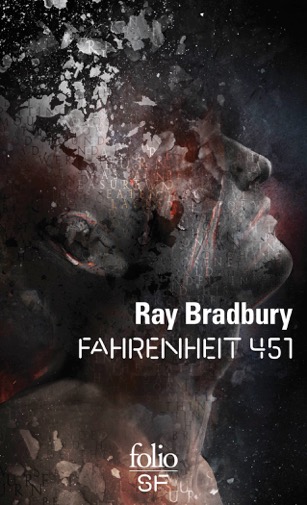

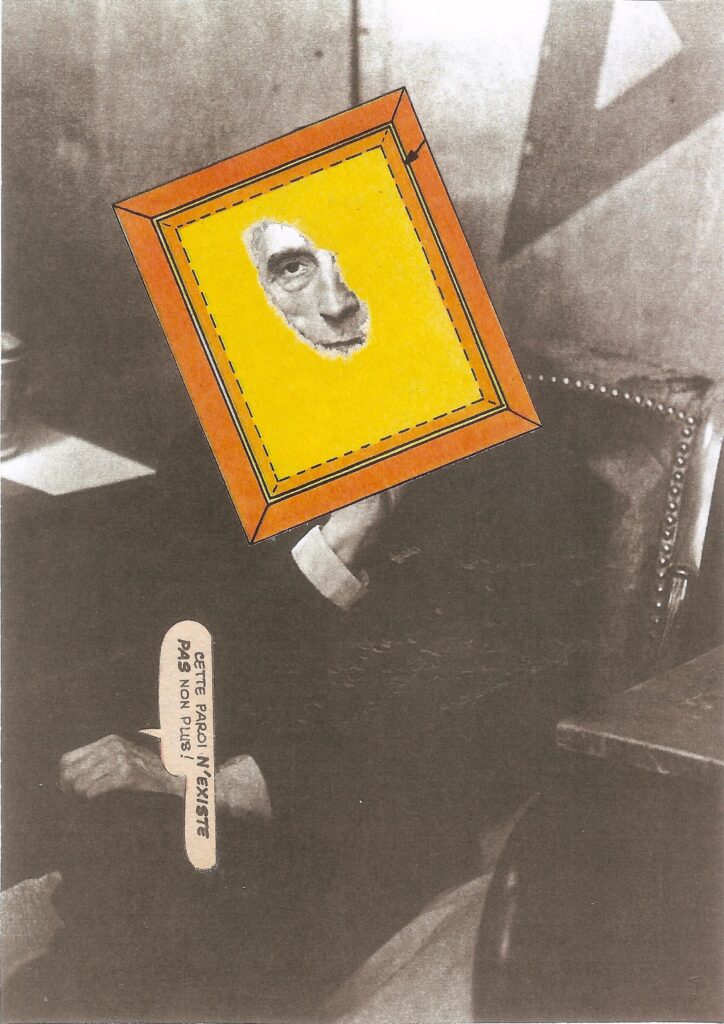
0 commentaires