
Pierre Banos, directeur des éditions Théâtrales © Christophe Raynaud de Lage
Fondées en 1981 par Jean-Pierre Engelbach, les éditions Théâtrales occupent une place essentielle dans la diffusion du théâtre contemporain. À leur catalogue, plus de 700 titres de plus de 300 auteurs et 160 traducteurs, et 20 à 25 livres publiés tous les ans. Pierre Banos, qui dirige désormais la maison, revient sur les difficultés du secteur, sur ses choix éditoriaux et sur les évolutions de « l’écriture dramatique ».
En 2021, avec onze autres éditeurs de théâtre, vous avez co-signé un texte destiné à attirer l’attention des tutelles sur la grave crise que vous traversiez. Votre chiffre d’affaires 2020, disiez-vous, avait chuté de de 20 à 25% par rapport à 2019. Comment vous portez-vous maintenant ?
Depuis la rentrée de cette année, ça sent le roussi. Nos gros mois de vente, c’est septembre, octobre et novembre, en lien avec le début de la saison. Or septembre a été mauvais, octobre aussi. Il y a la conjoncture globale – l’année électorale, la guerre en Ukraine, la baisse du pouvoir d’achat – et la conjoncture professionnelle. Des librairies importantes pour nous ont fermé : le Coupe-papier, rue de l’Odéon, et celle d’Actes Sud au théâtre du Rond-Point. Ça va redémarrer [le Coupe papier a rouvert le 8 novembre], mais il suffit que deux librairies aillent mal pour que ça nous plombe le chiffre. En septembre, traditionnellement notre plus gros mois, on a fait de – 20% à – 25%. Les éditions théâtrales ont une image de structure très subventionnée. C’est une image fausse. Notre chiffre d’affaires, c’est 92% de ventes et 8% d’aide publique. La baisse des tirages et des ventes remonte à loin : quand suis entré dans la maison en 2002, on tirait à 1500 exemplaires dans la collection Répertoire contemporain; aujourd’hui, on est à 6-700… On est obligé d’ajouter dans les contrats d’auteur : interdit de filer votre livre en PDF à vos potes…
C’est depuis le milieu des années 1970 que l’édition de théâtre vivote. Expliquez-nous pourquoi.
Avant 1975, l’éditeur de théâtre était dans la même situation qu’aujourd’hui un éditeur de roman qui vend des droits dérivés – des droits d’adaptation au cinéma, par exemple : c’est 50% pour l’éditeur, 50% pour l’auteur. Les éditeurs qui publiaient du théâtre avaient le droit d’adhérer à la SACD, ils étaient ayants-droit, percevaient leurs 50%. Ils pouvaient à la limite ne pas vendre de bouquins, ça n’avait aucune importance. Ils ne bossaient pas ou pire, ils ne publiaient la pièce que quand elle était jouée.
Les auteurs râlaient, s’inclinaient quand ils pouvaient publier dans la prestigieuse collection Le Manteau d’Arlequin, chez Gallimard. Mais la fronde a grandi et c’est cette année-là, en 1975, que les règles ont changé : les éditeurs ont été exclus de la SACD, ils ne pouvaient plus être ayants-droit. Seule tolérance : les auteurs pouvaient concéder à leur éditeur 5% sur les droits de représentation – à condition que le texte soit publié avant toute création.
En 1975 se publiaient 200 nouveautés théâtrales par an (sans compter les classiques), chez des éditeurs généralistes ou spécialistes (peu nombreux à l’époque : il n’y avait que L’Arche et L’Avant-Scène théâtre). En 1976 : 50 nouveautés. Quatre fois moins. Bien sûr, les éditeurs généralistes – Gallimard, Stock, Seuil – ont arrêté de publier du théâtre, puisqu’ils n’étaient plus intéressés aux droits de représentation. Les auteurs voulaient une plus grosse part du gâteau, et tout à coup il n’y avait plus de gâteau.
Il y a bien eu quelques tentatives, comme celles de Lucien Attoun qui, après l’arrêt des deux collections théâtrales chez Stock, a créé la collection Tapuscrits à Théâtre ouvert. Mais en gros, c’est le statu quo jusqu’à ce que Jean-Pierre Engelbach crée les éditions Théâtrales en 1981, au sein de la Ligue de l’enseignement. Juste après commence l’ère Mitterrand-Lang, Robert Abirached prend la direction du Théâtre et des Spectacles, et l’aide publique ou parapublique permet à des maisons comme la nôtre de se développer.
L’édition de théâtre vivote, mais ses livres, comme ceux de poésie, bénéficient d’un effet de longue traîne, comme on dit dans l’économie du secteur.
Les libraires peuvent renvoyer nos livres au bout de trois mois, mais c’est assez rare, en théâtre la rotation est très lente. De notre côté, en quarante ans d’édition, on a seulement sorti cinq titres du catalogue. Nos textes, les gens peuvent tomber dessus cinq, dix, vingt ans après, et ça peut générer un spectacle. Je pense à une pièce de Daniel Besnehard, Passagères, qu’on a publiée en 1982, et qui l’année dernière a été remise en scène.
On essaie de ne pas dater dans une esthétique théâtrale liée à une époque. Il ne s’agit pas du tout d’assécher la théâtralité, d’aller vers de la « littérature en costumes », comme dit Mnouchkine, mais de virer ce qui cache le texte.
La longue traîne, c’est aussi, par exemple, une pièce de Sandrine Roche, Neuf petites filles, que Philippe Labaune a montée à Lyon, dans une esthétique particulière, que Stanislas Nordey, dans une esthétique tout autre, a mise en scène lui aussi – il y a eu deux ou trois autres créations. Notre travail est réussi si y a deux, trois, quatre créations.
En tout cas, on ne pilonne pas. On a 20% de taux de retour. Mais la vie des livres ne prend pas fin avec ces retours. On demande au distributeur de les trier, d’écarter ceux qui ont été ouverts, abîmés… et le reste revient dans notre stock. La logique n’est pas celle des romans, qu’il coûte moins cher de pilonner que de réintégrer au stock. Cela dit, ce n’est pas sans frais pour nous : chaque année, c’est 16 500 euros de stockage, 20 000 de réimpressions…

Equipe Théâtrales © DR
« Le théâtre, ça se lit aussi » : c’était le slogan du fondateur des éditions Théâtrales dans les années 1980. Il continue de régir la ligne éditoriale de votre maison…
Oui. Si on m’invite à aller écouter un texte en lecture publique, je le lis d’abord, pour ne pas être influencé dans un sens ou dans un autre.
Avec les auteurs, je fais du page à page – ceux qui viennent d’autres maisons ne comprennent pas toujours. Je négocie une version littéraire du texte. Je leur demande de dépolluer leur texte de références trop scéniques. Je me souviens que dans Marzïa, Karin Serres avait écrit, dans une scène qui se passe au bord du Tage : « Tiago sort à cour ». C’est le genre d’indication qui me projette sur une scène de théâtre, je n’en ai pas besoin, je me faisais ma représentation mentale ! Il ne faut pas cadenasser l’imaginaire, comme le faisait Beckett avec ses nombreuses didascalies.
Ma référence, c’est l’historienne Anne Ubersfeld, qui dans Lire le théâtre dit en gros que le texte de théâtre est troué, qu’il a besoin de l’actualisation du plateau pour devenir œuvre, pour se lever. Le texte est troué, d’accord, mais mon critère de choix pour le publier n’est pas qu’il soit joué. On publie quasiment tout le temps avant création. À L’Avant-Scène théâtre par exemple c’est différent: ce sont principalement les théâtres qui proposent les textes à publier lorsque les pièces sont à l’affiche. Il n’y a pas de travail littéraire éditorial.
Mon rêve, c’est d’élargir notre lectorat, mais c’est très compliqué. Dans la collection Lisières, qu’on vient de lancer, on a caché le mot théâtre sur la couverture. C’est parce que quand les gens voient écrit éditions Théâtrales ils se disent, c’est pas pour nous, ils passent leur chemin. C’est aussi parce que l’ambition de la collection, c’est de passer les frontières des genres (théâtre, poésie, roman, narrations diverses). Le théâtre s’écrit aujourd’hui de façon très diverse. Koffi Kwahulé a publié des romans chez Gallimard et Zulma, c’est plein de dialogues, très théâtral, c’est marqué « roman », et ça, ça ne pose de problème à personne.
Depuis 50 ans, le théâtre « performatif » a pris une grande importance sur les scènes (croisement avec la danse, la vidéo en direct, le cirque, la musique live…) Le texte s’est souvent effacé, il n’est plus matriciel, il est devenu un élément parmi d’autres au sein de la polyphonie scénique. Qu’est-ce que ces transformations ont fait à l’écriture dramatique?
La fonction de Théâtrales est bien de se placer du côté de l’auteur qui écrit de façon autonome, presque de façon classique, dans une fonction matricielle.
C’est vrai, les écritures de plateau peuplent les programmations des théâtres, mais je crois que ce sont surtout des modes qui passeront, et que leur essor est lié à des conjonctures économiques. Quand il n’y a pas d’auteur ou d’autrice à rémunérer, la création devient plus simple…
Bien sûr, l’écriture « dramatique » a évolué et même si les auteurs que nous défendons s’éloignent de ces inféodations de plateau, ils doivent les prendre en compte s’ils veulent intéresser les metteurs en scène. Les personnages par exemple : pour que leur pièce soit montée, les auteurs s’arrangent pour que leur nombre soit raisonnable, ou alors ils rusent pour que la distribution soit tenable. François Hien ou Jonas Hassen Khemiri sont habiles à proposer une vingtaine de personnages jouables par trois ou quatre acteurs.
L’écriture dramatique a évolué au contact des contraintes de production, mais elle l’a fait aussi au contact de la littérature non théâtrale. Elle intègre des récits – 40 ans que Noëlle Renaude le fait, avec par exemple son roman ou feuilleton théâtral Ma Solange, comment t’écrire mon désastre, Alex Roux. Elle s’aventure aussi dans des narrations innovantes : La sœur de Jésus-Christ, d’Oscar de Summa (traduit en français par Federica Martucci), c’est un monologue ou une partition pour chœur qui glisse comme un travelling de cinéma. Soudain Romy Schneider, de Guillaume Poix, une sorte de biographie littéraire romancée…
En 2017, avec d’autres éditeurs de théâtre, vous avez créé la société de diffusion Théâdiff. Quel bilan en tirez-vous ?
En 2001, on avait confié notre diffusion au Centre de diffusion de l’édition (CDE), qui appartient à Gallimard. On déléguait, on laissait faire les représentants. Mais le théâtre, en librairie, c’est compliqué à vendre. On s’est dit qu’il fallait qu’on reprenne en main notre diffusion. Aujourd’hui, les éditions Théâtrales diffusent une dizaine d’éditeurs de théâtre – on a presque tout le monde, sauf Actes Sud et L’Arche.
Concrètement, je vais souvent en librairie, avec ma collègue Mahaut on fait les représ [représentants]. Les représ qui ont 200 romans ne peuvent pas tout lire. Nous qui avons 150 nouveautés par an, tous éditeurs confondus, on lit tout, on se fait le porte-voix argumentaire des autres, on peut faire de la dentelle parce qu’on a un petit catalogue.
Par ailleurs, on marie des structures – un théâtre avec un libraire de sa ville, par exemple.
Et depuis septembre, en partenariat avec la Librairie théâtrale, à Paris, on propose une solution de dépôt à tous les théâtres qui n’ont pas de partenariat avec une librairie mais veulent rendre disponibles les textes des spectacles qu’ils proposent. On met en contact théâtres et librairies, on prend la commande, on donne ça à la Librairie théâtrale qui s’occupe de l’acheminement des livres, de la facturation, des retours…
C’est technique, mais c’est ça aussi notre boulot, un travail fin. On fait des bons de commande thématiques. Un librairie nous dit qu’il va faire une table sur la guerre d’Algérie ? On lui propose dix textes autour du sujet aux Solitaires Intempestifs, chez Théâtrales, Espaces 34, etc. On fait aussi des bons de commande régionaux, après avoir épluché toutes les plaquettes de la saison, de tous les théâtres, des nationaux jusqu’aux municipaux – c’est notre gros boulot de l’été. On appelle les libraires : il y a aura cette pièce à tel moment, vous voulez le livre ?
Etes-vous sensible à l’air du temps – la nouvelle vague féministe, le décolonialisme, le brouillage des genres, etc?
Je suis sensible aux voix féministes et décoloniales, je lis beaucoup de livres de sciences humaines. Cela dit, je trouve que la francophonie est un concept creux, avec des relents colonialistes. Il ne faut pas baisser le niveau d’exigence parce qu’un auteur est guinéen ou autre. Koffi Kwahulé, qui est d’origine ivoirienne, on le publie parce qu’il est un immense auteur. Pareil pour Jean d’Amérique, qui est édité chez Cheyne en poésie, chez Actes Sud en roman : j’ai d’abord flashé sur son écriture.
Le catalogue est plus féminin qu’il l’a été. Il y a de plus en plus d’autrices, donc j’en publie plus. Je suis attentif au respect d’un équilibre, on est presque paritaire dans le rapport hommes-femmes. Il m’arrive de pousser des autrices vers des consœurs éditrices, à qui je dis : « vas-y toi, t’es plus légitime que moi, mec cisgenre, hétéro, de 45 balais »… On publie Laurène Marx, une autrice trans, qui revendique sa trans-identité de façon politique ; et debbie tucker green, qui écrit expressément pour des acteurs noirs. La Honte, c’est un texte metoo… écrit par un cisgenre hétéro blanc (François Hien), qui a voulu se coltiner ce problème-là. C’est un texte très équilibré, plutôt du côté des victimes, pas un truc de rachat de mec – au pire il y aura un débat avec les féministes, mais justement, ça pose le débat.
On est une maison située à gauche – une coopérative depuis 2015. J’avais racheté les parts du fondateur, Jean-Pierre Engelbach, j’étais le plus gros actionnaire de cette maison. J’aurais pu continuer un truc autocratique, mais j’ai préféré être en codirection. Je ne suis pas le seul maître à bord ; je donne le cap et j’assume la politique éditoriale. Je suis directeur de toutes les collections mais quand j’ai des doutes, je fais lire, même à nos apprentis (salariés mais encore à la fac). Pour le répertoire contemporain, c’est moi qui choisis. En revanche, la collection Lisières, je la codirige avec mes collègues – Mahaut Bouticourt à la com, et Gaëlle Mandrillon, la directrice adjointe. C’est une ligne de crête compliquée à tenir. Mais je suis un simple artisan. Mon boulot, c’est que cette maison continue après moi.
Propos recueillis par JB Corteggiani

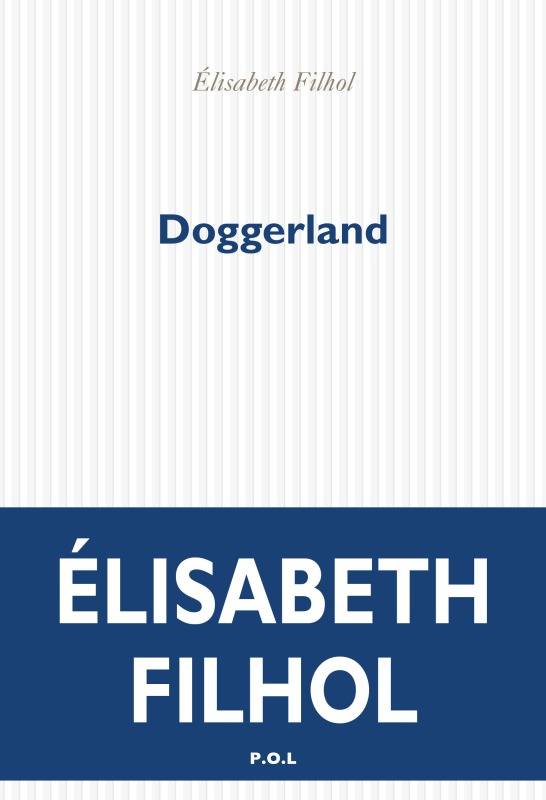

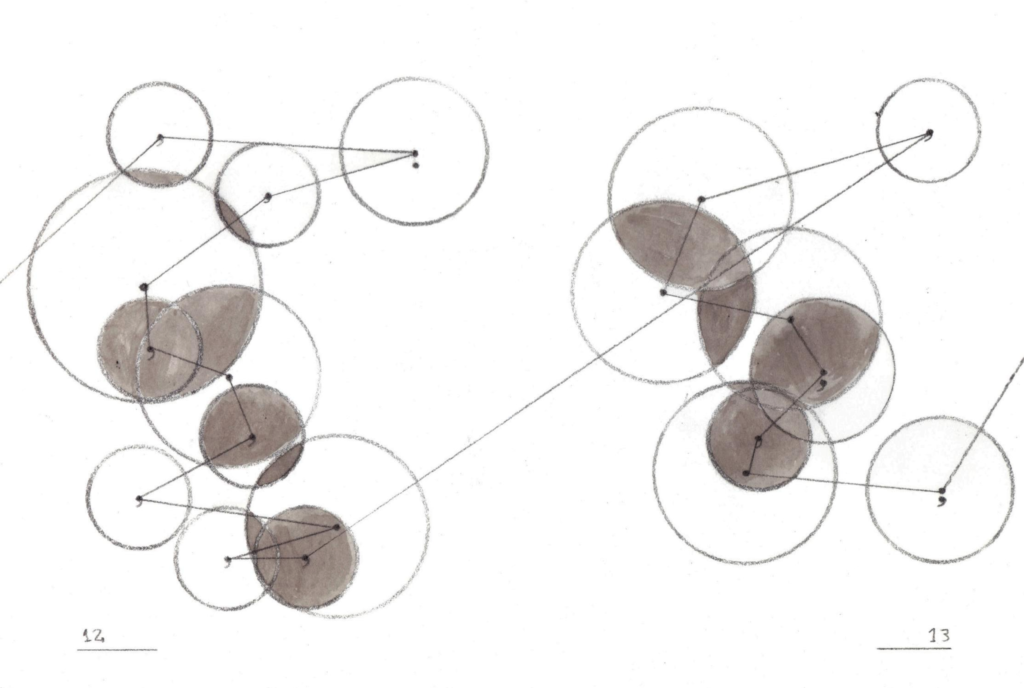





0 commentaires