Depuis quelque temps, les murs de nos villes se sont couverts d’affiches blanches ornées de lettres noires. Des lettres noires. Rien de plus. Qui dénoncent. Quoi ? Les féminicides. Les meurtres réguliers perpétrés dans notre pays et dont un compte terrifiant est désormais tenu, et malheureusement souvent mis à jour. Les passants lisent les messages placardés, les commentent, les expliquent aux enfants qui posent des questions.
Il y a aussi ceux qui, la nuit, viennent les arracher. Je ne parle pas des employés municipaux, qui ont été jusqu’à verbaliser les colleuses à Paris, soit dit en passant. Non, je pense aux anonymes qui n’ont pas pour objectif de nettoyer quoi que ce soit, qui laissent les panneaux blancs à moitié arrachés, qui n’ont à cœur que de rendre illisible le message porté. Ne pas laisser dire aux murs que des femmes sont tuées. Empêcher que la violence soit exposée.
Quand je vois sur les murs ces collages mutilés, maladroitement déchirés, mais néanmoins toujours présents, je me dis qu’ils affichent plus crûment encore la violence dénoncée, mais je me demande aussi qui sont ces arracheurs clandestins et visiblement nombreux, si l’on en croit la quantité de panneaux en lambeaux. Pourquoi donc prendre la peine d’aller tailler en pièces ces mots qui ne demandent rien de plus qu’un arrêt du massacre ?
 Et puis j’ai fini par comprendre qu’il n’y avait pas lieu de s’étonner. Grâce à Martha Gellhorn. Cette journaliste et écrivaine américaine, correspondante de guerre en Espagne en 1937 puis en Tchécoslovaquie, en Finlande, en Chine, dans l’Europe en guerre, etc. Celle qui fut l’épouse d’Hemingway puis eut l’audace de quitter le grand homme (« Je ne veux pas être une note de bas de page dans la vie de quelqu’un d’autre ») a écrit toute sa vie. Et les éditions du Sonneur viennent de publier un recueil de 29 de ses articles qui nous racontent, en long, en large et en travers, le XXe siècle, des années 30 aux années 80, du récit d’un lynchage dans le Mississipi en 1931 à un aperçu du thatchérisme et du reaganisme : Le Monde sur le vif, traduit par David Fauquemberg (préface de Marc Kravetz). Vers la fin du volume, entre un reportage sur l’île d’Haïti et un autre sur le Salvador, se trouve un texte initialement publié en 1984, « Les femmes de Greenham Common », enquête au sein du campement pacifiste installé par des femmes pour protester contre l’installation de missiles nucléaires dans le Berkshire, en Angleterre. Signalons au passage que le camp en question, mis en place en 1981, n’a été démantelé qu’en 2000. Dix-neuf ans de résistance acharnée. « Il y a un peu plus de deux ans, soixante femmes britanniques se sont retrouvées à Cardiff et ont marché jusqu’à Greenham Common. Elles n’avaient pas de plan, rien qu’une indignation partagée », écrit Martha Gellhorn.
Et puis j’ai fini par comprendre qu’il n’y avait pas lieu de s’étonner. Grâce à Martha Gellhorn. Cette journaliste et écrivaine américaine, correspondante de guerre en Espagne en 1937 puis en Tchécoslovaquie, en Finlande, en Chine, dans l’Europe en guerre, etc. Celle qui fut l’épouse d’Hemingway puis eut l’audace de quitter le grand homme (« Je ne veux pas être une note de bas de page dans la vie de quelqu’un d’autre ») a écrit toute sa vie. Et les éditions du Sonneur viennent de publier un recueil de 29 de ses articles qui nous racontent, en long, en large et en travers, le XXe siècle, des années 30 aux années 80, du récit d’un lynchage dans le Mississipi en 1931 à un aperçu du thatchérisme et du reaganisme : Le Monde sur le vif, traduit par David Fauquemberg (préface de Marc Kravetz). Vers la fin du volume, entre un reportage sur l’île d’Haïti et un autre sur le Salvador, se trouve un texte initialement publié en 1984, « Les femmes de Greenham Common », enquête au sein du campement pacifiste installé par des femmes pour protester contre l’installation de missiles nucléaires dans le Berkshire, en Angleterre. Signalons au passage que le camp en question, mis en place en 1981, n’a été démantelé qu’en 2000. Dix-neuf ans de résistance acharnée. « Il y a un peu plus de deux ans, soixante femmes britanniques se sont retrouvées à Cardiff et ont marché jusqu’à Greenham Common. Elles n’avaient pas de plan, rien qu’une indignation partagée », écrit Martha Gellhorn.
Elle poursuit : « Ces femmes estimaient qu’il était temps, pour les gens ordinaires, de dire non. Alors elles avaient décidé de rester là où leurs pas les avaient menés ». Lors de sa description du camp, la journaliste évoque la mémoire des suffragettes : « Les suffragettes avaient été vilipendées, raillées, maltraitées, mais sans elles, nous serions encore toutes sous le joug de ces valeurs victoriennes si chère à Mme Thatcher, et Mme Thatcher ne serait pas au 10, Downing Street, à décrier les femmes pacifistes. »
Et puis il y a ce passage : « Il y aussi les milices, dont je n’avais jamais entendu parler. La nuit, des hommes non-identifiés viennent jeter dans leurs abris des seaux d’asticots, de sang d’animaux et de lisier. Elles affirment que les volontaires chargés de ces missions ignobles sont recrutés dans un pub de Newbury. Incapable de me représenter des hommes pareils, je demande : ‘Mais qui sont-ils ?’ Une femme hausse les épaules. ‘Des hommes en colère’. »
Des hommes en colère. Qui arrachent de nuit les affiches qui pleurent les femmes assassinées et versent, toujours de nuit, des seaux d’asticots et d’immondices sur les femmes pacifistes. Car ce sont les mêmes. Encore et toujours les mêmes.
Des hommes en colère.
« On ne veut plus compter nos mortes », clame un des murs. « Violeur, tueur, agresseur, à ton tour d’avoir peur », répond un autre. Voix de femmes moins apeurées, moins désespérées, plus déterminées et plus fortes et plus rageuses.
Alors, gare, la colère pourrait bien changer de camp.
Nathalie Peyrebonne
Ordonnances littéraires



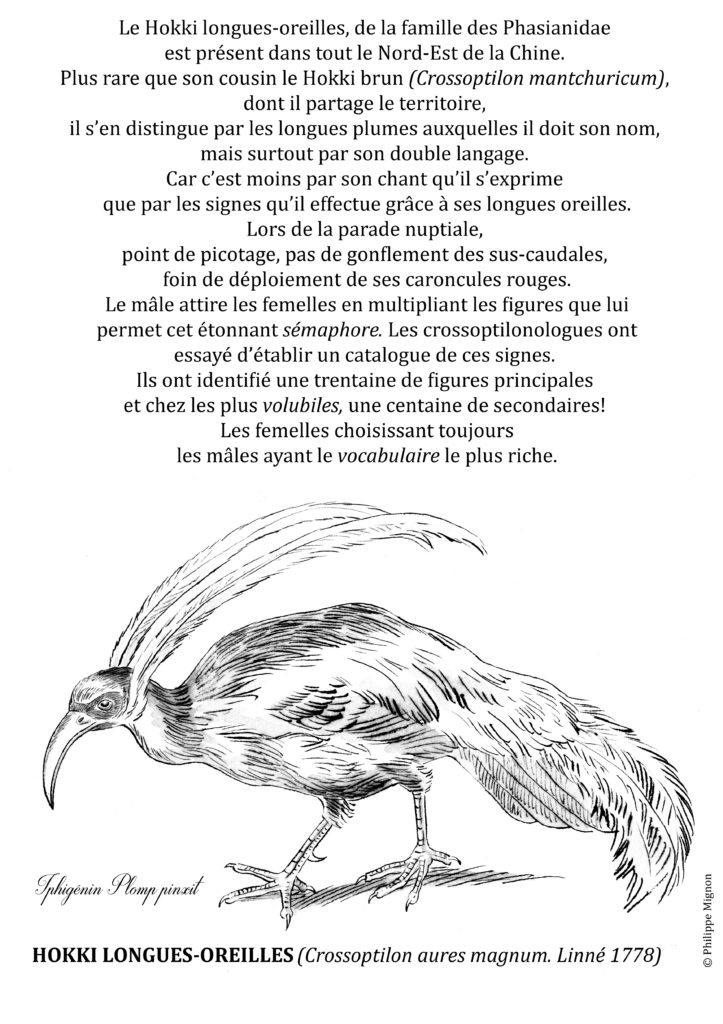


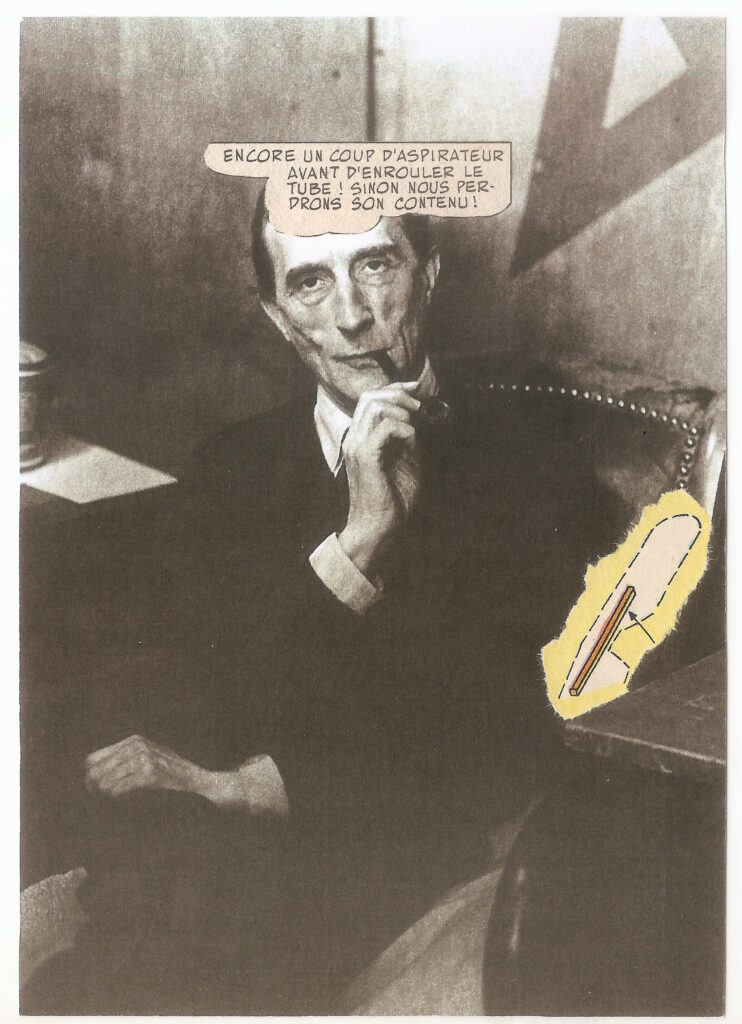


0 commentaires