D’abord les joueurs entrent sur le terrain. Ils sont en ligne. Immobiles.
C’est blanc, c’est jaune et sur la pelouse verte, on dira ce qu’on voudra, c’est moche.
Il y a de la musique. Officielle. Des hymnes. La moitié du stade chante. Puis l’autre moitié. On s’ennuie déjà. Ça commence quand ? demande quelqu’un. Après la pub, lui répond un autre.
Pub, donc. Et puis coup d’envoi.
Sans surprise, le ballon passe d’une paire de pieds à une autre. On s’ennuie toujours mais après tout, c’était prévu. D’abord parce que l’Allemagne est championne du monde en titre. Ensuite parce que l’Ukraine a toujours eu un seul atout, qu’il s’appelait Chevtchenko et qu’il a pris sa retraite en 2012. Le style de jeu de l’Ukraine, pendant une dizaine d’années, a consisté à attendre dans son camp de récupérer le ballon pour le balancer directement en direction de Chevtchenko, seul devant.
19ème minute.
La balle est posée au sol. Un Allemand tape dedans. Un autre Allemand saute et la frappe avec sa tête. Le ballon change de trajectoire à la suite du choc et se retrouve dans les filets.
But, donc.
1-0. Malgré tout, on s’ennuie. Mais comment pourrait-on ne pas s’ennuyer ?
Hier, les rues de Marseille ont été dévastées par des scènes d’une violence insensée. Il se passait quelque chose. Il y avait des images, des visages, de la matière, des questions, des interprétations, des réactions, des condamnations. Des blessés, des blessures, du sang, de la peau, des coups. Insensée, vous dit-on. Incontrôlable. Susceptible de se reproduire n’importe où. N’importe quand. Ici, peut-être. Alors quoi ? Pourquoi ici n’y a-t-il rien à filmer ?
Le match s’enlise puisqu’il n’y a rien de pire pour le rythme d’une partie qu’une équipe supérieure techniquement qui mène au score. On temporise. On gère.
C’est alors qu’on ressent comme une vibration, mais déjà c’est la mi-temps. Une vibration ? On aimerait bien en savoir plus mais pub à nouveau.
Dans les publicités, les joueurs réels deviennent des joueurs de fiction. Les gestes techniques ne souffrent d’aucune erreur. Le jeu est court, efficace et parfait ; les buts sont splendides. Dans les publicités, un match dure trente secondes. On n’a pas le temps de s’y ennuyer. Les téléspectateurs l’ignorent mais dans le stade, on a vite compris que la vibration provenait d’une explosion. On se souvient du mois de novembre, au Stade de France. On se regarde. C’est ici ? C’est dehors ? Regards incrédules. Un nuage de fumée se dissipe au milieu d’un petit cratère bruni au milieu de la tribune C. Les stadiers évacuent les blessés. Le personnel d’entretien nettoie les traces de feu et de sang. On ne va quand même pas tout annuler alors qu’on ne sait même pas ce qu’il vient de se passer. Le match reprend. Lent. Doux. Inoffensif.
À la télé, les images sont abstraites. Des points blancs. Des points jaunes. Se croisent. Se frôlent. Entrent en collision. S’épousent. Un ballet mélancolique. De loin. Le réalisateur de TF1 ne peut pas proposer autre chose que ce plan large et monotone. Pour motiver un changement d’angle, il faudrait un arrêt de jeu. Or il n’y en a pas. Le ballon passe d’une paire de pieds à une autre, et ainsi de suite. On nous indique que l’attentat de la tribune C vient d’être revendiqué par un groupe de séparatistes pro-russes. Quel dommage qu’on n’ait pas pu le filmer.
60ème minute. Une heure que ces vingt-deux là jouent. Et qui feront semblant de le faire pendant encore trente minutes. En plan large. Il n’y a toujours aucun ralenti. Car on ne peut pas montrer le vide au ralenti. Le vide au ralenti, c’est toujours le vide.
Hier, un homme a ouvert le feu dans une discothèque homosexuelle d’Orlando. Il a massacré cinquante personnes désarmées. L’attentat a été revendiqué par l’organisation État Islamique. On a vu des images. Du sang. Des blessures. Des larmes. Peu d’images mais encore et toujours les mêmes, indéfiniment, longtemps. En boucle. Comme un ralenti. Le contraire d’un plan large. Le contraire de l’ennui, c’est peut-être l’horreur.
Le temps passe. 75ème minute.
Il y a eu quelques tirs bien sûr. Les gardiens de but ont saisi le ballon de temps à autre. Les joueurs de champ ont couru. Dans un sens. Parfois dans l’autre. En paix. Au football, il existe des tirs sans danger.
77ème minute.
Des coups de feu résonnent dans la tribune d’honneur. À nouveau, un forcené souhaite mourir pour une cause en emportant avec lui un nombre important d’innocents. On nous tiendra au courant dans les prochaines minutes de la cause dont il s’agit. Sportive ? Politique ? Sentimentale ? Les trois peut-être. Une seule raison est-elle suffisante pour s’abandonner à cette extrémité ?
87ème minute.
Plus que trois minutes à jouer et soudain, après une furieuse percée de l’Allemand Özil et un duel perdu avec le gardien ukrainien, la fulgurante relance manque de surprendre la défense allemande. Frissons. Pupilles dilatées. Adrénaline. Ça n’aura duré que quelques secondes, à peine le temps d’une pub, mais tout à coup, il se passait quelque chose, autre chose que l’épouvantable langueur d’un match sans vie. On a perdu l’habitude de s’ennuyer.
Le temps réglementaire s’achève. On annonce trois minutes de temps additionnel. Le match semble gagner en intensité alors que précisément, une nouvelle explosion retentit. D’après les témoignages des survivants, il s’agissait d’un attentat suicide. Le terroriste, un Grec, aurait hurlé qu’il était contre l’Union européenne.
92ème minute.
Schweinsteiger reprend un centre de Özil et marque le deuxième but de l’Allemagne mais tout le monde s’en moque car des spectateurs explosent maintenant aux quatre coins du stade. Celui-ci trouve qu’il y a trop d’Arabes en France. Celui-ci affirme qu’il soutient la cause des indiens Guarani. Un autre vide son chargeur sur ses voisins parce qu’il juge que la Loi Travail ne doit pas être votée. Un supporter allemand estime que les Juifs dirigent le monde et se fait exploser à son tour.
2-0. Le match est terminé, mais de plus en plus de spectateurs passent à l’acte.
Bientôt, le stade gronde de tirs et d’explosions. Pour la justice. Contre l’injustice. Pour la suprématie. Contre la suprématie. À la torpeur d’un match laborieux répond le fracas d’une civilisation qui implose en direct. Sur le terrain, quelques joueurs à leur tour actionnent leurs ceintures d’explosifs. Taches rouges sur la pelouse verte. Pour revendiquer on ne sait quoi. Pour soutenir on ne sait qui.
Parce que même un match ennuyeux est filmé par cinquante caméras. Chaque personne qui se glisse dans le champ devient le sponsor de quelque chose : Nike, Trump, Daesh.
Alors on baisse la tête et on prend le chemin de la sortie. Dehors, demain, tout le temps, des gars explosent encore, autour de nous, tirent dans la foule, pour X ou Y raisons. Mais nous baissons la tête, et avançons dans ce chaos, pour aller boire un verre en terrasse, pour assister à un match de foot, à un concert, pour participer encore à cette grande inertie, ce long et triste plan large où il ne se passe rien, où les jeux sont faits avant même le coup d’envoi, cette léthargie même que le kamikaze veut enrayer, le temps d’un éclair sanglant. Et puis plus rien.
Insupportable, la compétition continue.
Grégoire Courtois
Grégoire Courtois est vidéaste, net-artiste, libraire et chroniqueur de l’émission La Librairie francophone sur France Inter. À Auxerre, il organise le festival littéraire Caractères. Comme auteur, il a publié les romans Les travaillants (Presque Lune, 2009), Révolution (Le Quartanier, 2011) et Suréquipée (Le Quartanier, 2015).
[print_link]





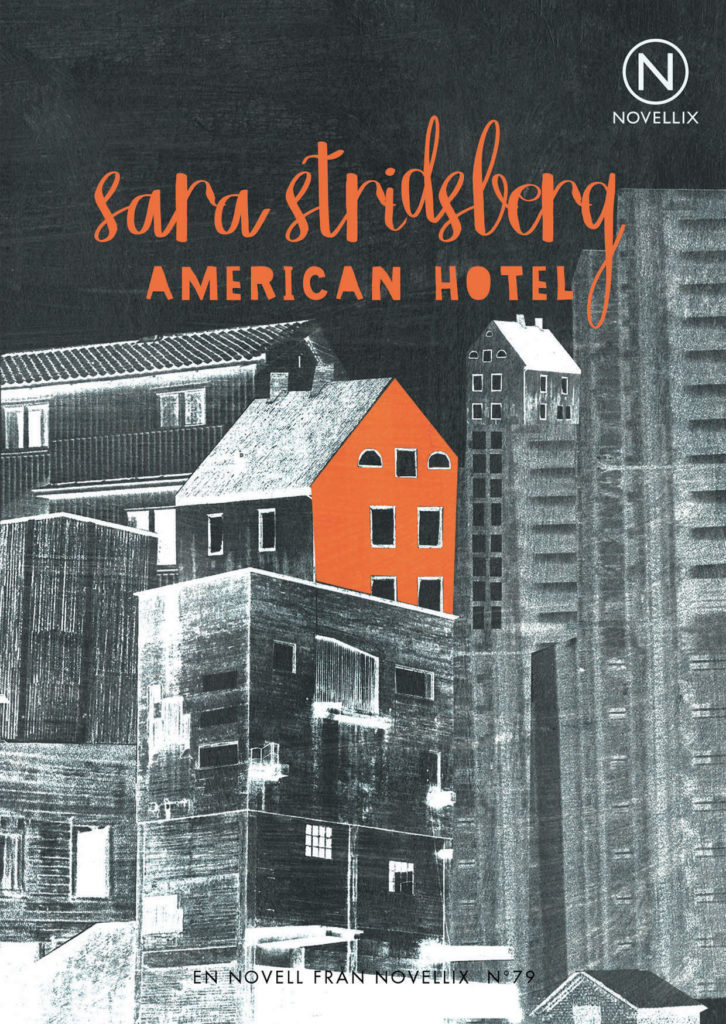
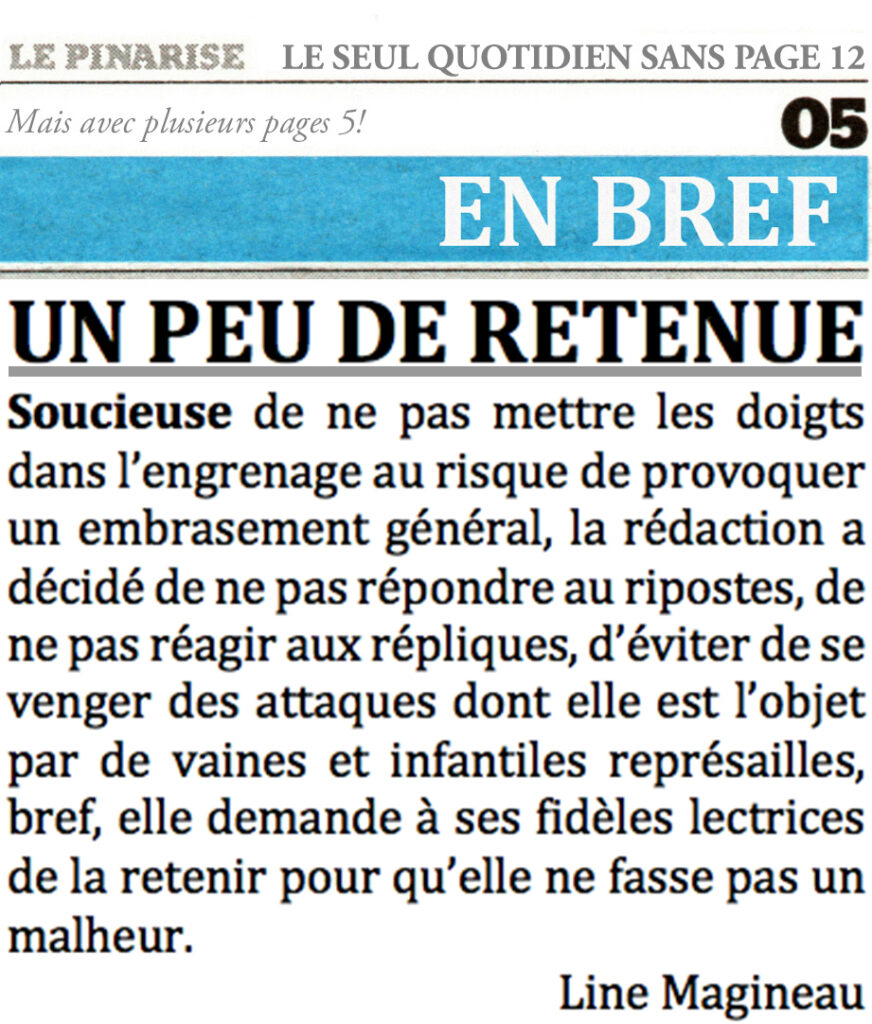


0 commentaires