 Dans ce nouvel Olympe qu’Hollywood markette pour la planète, Deadpool, énième comics passé sur grand écran et digression mineure dans la franchise X-Men, incarne le sale gosse de la famille mutante. À savoir, sous sa combinaison noire et rouge, un tueur à gages amoral et roublard, métamorphosé par les soins d’un Dr Frankenstein qui lui ont laissé un visage de zombie, une puissance de surhomme et un don d’immortel – sa chair se régénère d’elle-même. Mais son vrai super pouvoir est tout autre : le super second degré.
Dans ce nouvel Olympe qu’Hollywood markette pour la planète, Deadpool, énième comics passé sur grand écran et digression mineure dans la franchise X-Men, incarne le sale gosse de la famille mutante. À savoir, sous sa combinaison noire et rouge, un tueur à gages amoral et roublard, métamorphosé par les soins d’un Dr Frankenstein qui lui ont laissé un visage de zombie, une puissance de surhomme et un don d’immortel – sa chair se régénère d’elle-même. Mais son vrai super pouvoir est tout autre : le super second degré.
Dès l’ouverture outrancière, se déploient tous les vertiges de l’ironie et de la mise en abyme : voix off gouailleuse et regard caméra complice adressé aux spectateurs, gags sarcastiques ou parodiques… L’humour trash, volontiers sadique ou libidineux, et la plasticité de la cinétique, avec de si élastiques temporalité (pauses, flash backs, ralentis, accélérés…) et spatialité (travellings tournoyant en spirales insensées, décors démesurés transfigurés par la chorégraphie du chaos, Tim Miller venant des effets spéciaux…), achèvent de designer un trip jouissif et transgressif. Un shoot de légèreté so cool et politically incorrect, libéré des pesanteurs dévolues aux épisodes plus institutionnels. À l’image du antihéros ultra individualiste, lonesome cowboy libertarien qui préfère se couper un bras – littéralement – plutôt que rejoindre ses confrères X-Men, ici pastichés en fonctionnaires de l’action… Le film de super héros post-moderne ultime, à la fois référentiel et iconoclaste ?
Dans ce kaléidoscope de clins d’œil et de reflets à l’infini, que reste-t-il du réel ? Rien, ou si peu, pas même un alibi. Grand maître de ce cinéma au second degré, Tarentino prétend traiter une matière première affective ou historique, qu’on y croie ou pas : vengeance obsessionnelle, girl power, idéologie raciste… Mais ici le divertissement n’est que diversion. Tel son héros parti dans une course éperdue derrière son bourreau, Deadpool se lance dans une fuite en avant effrénée, il palpite toutes les 10 secondes d’un nouveau stimulus – private joke, vanne sexuelle, délire gore. L’intrigue n’est plus que prétexte entre deux fix d’adrénaline, et la baudruche finira par se dégonfler sur une ligne de dialogue. Du rire, du sperme et du sang : la culture geek réduite à sa caricature, manie de collectionneurs et onanisme de post-pubères.
Il y a, certes, pour double incident déclencheur, une singulière noirceur morbide. On sent alors planer cette ombre du trépas qu’annonce le titre : fatalité du cancer qui condamne le héros ; mauvais choix de s’en sauver par des expériences de laboratoire – et surenchère d’agonies, à la limite de ce genre du torture porn identifié dans les 90’s avec les sagas Hostel et Saw… Mais au sortir de l’épreuve du feu, le corps du monstre, ressuscité sous la cendre, devenu indestructible, ampute la dramaturgie de tout enjeu, jusqu’à l’absurde. Plus rien ici n’est question de vie ou de mort. De cette “vanité”, Deadpool porte aussi le masque : complexé par sa face de Créature de Frankenstein, il se couvre de la surface lisse et nue d’une cagoule, où même du regard ne restent que des orbites blanches. C’est que jamais super héros n’eut objectif plus dérisoire : le voici qui répand la terreur et souffre le martyre pour… retrouver sa tronche de bogoss (Ryan Reynolds, en effet), et l’amour qui va avec, une love story cash avec une “putain au grand cœur” ! La séduction à vide et le foutage de gueule semblent alors s’assumer principes du film et miroirs d’une époque. Dommage qu’à la morale d’une telle fable, se renie le cynisme décomplexé censé faire son charme.
Deadpool est au grand écran ce que Les Anges de la téléréalité est au petit – ce programme de NRJ12 qui recycle de jeunes gens “célèbres parce qu’ils sont célèbres”, selon la déprimante tautologie inaugurée en France par le Loft. Un monde parallèle qui n’a plus besoin du vrai monde, un film qui n’existe qu’en citant et grimaçant les autres .
Est-ce à dire que nous tenons là une œuvre “baroque” ? Du plein sur du vide, un monument rococo bâti sur l’excès et l’autodérision, un labyrinthe de fantasmes et de réminiscences où la chair devient volute qui se perce et se recompose ad lib : la vie est une farce, à défaut d’un rêve. Mais une telle esthétique de la surface est censée cacher une profondeur – l’illusion de l’existence, la peur de la mort, tel ce crâne anamorphosé que le peintre Renaissance Holbein crypte dans son portrait des Ambassadeurs. Ainsi des grandes sagas baroques par où Hollywood raconte une théorie du monde : la vie est un jeu vidéo, un trompe-l’œil virtuel manipulé par une intelligence artificielle (Matrix) ; la vie est un parc d’attraction, un manège géant brillant de faux semblants (Pirates des Caraïbes)…
Deadpool, lui, n’a qu’une vérité à offrir, et une sale nouvelle sur l’état du cinéma et de l’Amérique. Fini le temps où des super héros sombres ou fragiles portaient doutes et traumas de l’après 11 septembre : nous voici revenus à l’ère du clinquant et du chiqué, piégés à la connivence d’une voix off et d’un regard caméra, trompés à l’ivresse des tours de passe de passe et des effets d’esbroufe. Plus tricheur que joueur, son super antihéros masqué abat carte sur carte, mais il n’a rien dans son jeu.
Thomas Gayrard
[print_link]

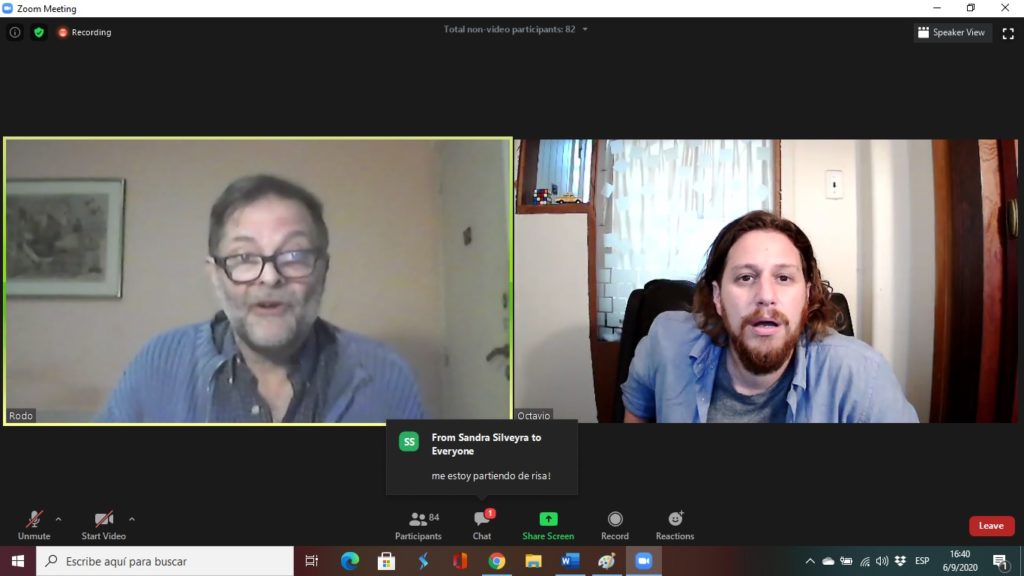






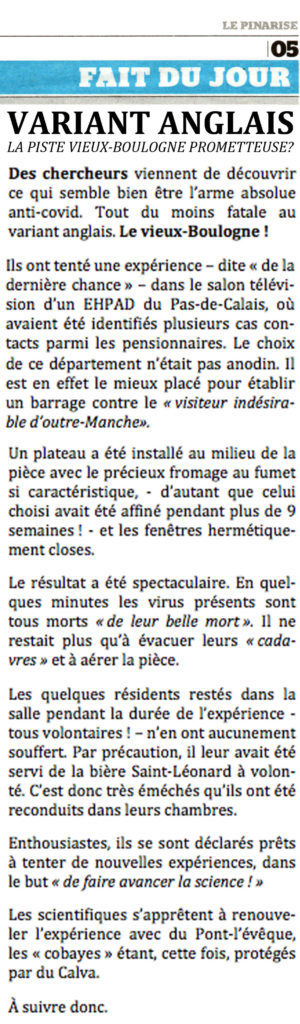
0 commentaires