Le Salon de Montrouge a changé.
Tout a commencé par un changement de direction, puisqu’Ami Barak a pris la succession de Stéphane Corréard, commissaire artistique du Salon entre 2009 et 2015 (de cette époque, un compte twitter dédié garde la mémoire, le compte @SdM_Correard qui, sous l’intitulé “Montrouge 2009-2015”, suit les “actualités des artistes exposés au Salon de Montrouge entre 2009 et 2015, quand Stéphane Corréard en était le directeur artistique”).
Mais le changement est plus profond. Ces dernières années, à Montrouge, on parlait de chercher les “génies ignorés”, on mettait en avant le parcours individuel de chaque artiste, on insistait sur des personnalités. Ami Barak, lui, déclare tout de go son intérêt pour “le concept même de scène émergente” et traduit cet intérêt dans la scénographie du Salon. Si, auparavant, le Salon accordait à chaque artiste sélectionné un espace spécifique, pour cette 61ème édition, Ami Barak a choisi d’entretisser leurs travaux. Dans la scénographie conçue par Ramy Fischler et Vincent Le Bourdon, les œuvres d’un même artiste se voient dispersées en deux ou trois points différents (voire plus, à l’instar de l’index de Clarissa Baumann dont les entrées sont disséminées sur les cimaises).

Vue du 61e Salon de Montrouge © Salon de Montrouge, photo Natalia Fempi Sova
Deux conséquences à cela : l’œuvre survient avant le nom qui l’accompagne (celui-ci n’apparaît que sur le cartel, écrit en petits caractères et affiché bien bas – si vous faites plus d’1,30m, il faudra vous plier en deux pour le lire) ; mais surtout, des airs de famille apparaissent, qui rassemblent des œuvres dont on découvre avec surprise qu’elles ne sont pas de la même main. À mesure qu’on avance dans le parcours, celui-ci s’enrichit rétrospectivement : un type de forme revient, un nom déjà aperçu fait retour, ou un certain matériau, un objet, une atmosphère, une question… Qu’on ne nous méprenne pas : notre propos n’est certainement pas de relever un quelconque manque d’originalité ou de formuler une énième critique de la notion d’auteur et d’individualité artistique. Non, nous souhaitons restituer ce qu’il y a d’enthousiasmant à découvrir, chez les artistes d’une même génération, des points de cristallisation communs. Ceux-ci, parfois infimes, n’ont pas force de style : ils ne constituent pas – et heureusement – l’ébauche d’un –isme nouveau dont on pourrait attifer la période à venir. Ces points de cristallisation, nous nous proposons d’en identifier quelques uns.
L’un d’entre eux se constitue autour de la reconstitution minutieuse et livre, en creux, un portrait de l’artiste en maquettiste. Ainsi, les objets de papier (pied de lampe ou tuyauterie) qu’expose Yassine Boussaadoun ; les décors de cinéma miniatures que Mathieu Dufois construit avant d’y tourner de courts films ; le circuit de train électrique de Gwendal Le Bihan ; la caravelle en stickers de Julien Fargetton ; les constructions filaires de Keito Mori qui tissent sur le mur le dessin d’une architecture (ou d’une machine) labyrinthique et fragile. La plupart de ces œuvres manifestent une virtuosité discrète qui ne fait pas mystère de sa vanité ou de son absurdité.
De l’absurde, on en retrouve dans nombre de pièces qui proposent ce que l’on pourrait nommer un artisanat rieur. Artisanat rieur de ces bilboquets-pièges que façonne Lorraine Château – la beauté du bois et la perfection des formes n’y sont que leurres, puisque ces bilboquets sont taillés de sorte qu’il soit impossible d’en jouer (ici, on pense d’ailleurs aux outils sans usage de Martin Monchicourt, évoqués ici il y a quelques mois). Ou encore de ce mur en parpaings-Tetris qu’érige Gwendal Le Bihan. Ou du constructivisme réinventé de Charlie Boisson, dont les sculptures géométriques associent des matériaux traditionnels (comme le bois) et des écrans LCD.
Autre trait frappant, le goût des lieux désertés, manifesté par des images qui se nourrissent de la géométrie de l’espace, du jeu des angles, des ombres et des couleurs. Ainsi de Marie B. Schneider qui, photographiant des lieux ou réinterprétant l’iconographie de Google Maps, travaille aussi à la géométrisation du monde. Ou encore des grandes toiles de Johan Larnouhet, ces coins d’espaces découpés dans les rayons de soleils invisibles (et ici, c’est aux toiles de Sépànd Danesh ou de Maude Maris qu’on peut revenir).

Marie B. Schneider, Dans l’air, le fond, 2013, photographie, dim variables © Marie B Schneider
Loin de ces rigueurs géométriques, d’autres artistes s’intéressent résolument à la vie, non pas des formes, mais des matériaux. Dans l’atelier abandonné des moutaincutters, roches, agrumes calcinés et dépôts divers recouvrent, accidentent et fossilisent les surfaces. La dégradation de la matière intéresse aussi Guillaume Barth avec son très smithsonien projet Elina, ce dôme en blocs de sel, érigé dans le désert bolivien, pour être dissout par des pluies diluviennes. Il faudrait aussi citer Mathilde Lavenne ou encore les constructions composites de Thiphaine Calmettes et la Peinture pariétale de Hugo Livet. D’ailleurs, l’un et l’autre inscrivent dans leur travail l’icône par excellence de la transformation organique : le champignon, lequel devient, subrepticement, une figure clef du parcours.

Guillaume Barth, Élina, 2015, sel, eau, 300cm de diamètre © Guillaume Barth
Bien sûr, des points ne sont pas un champ, et ce rapide relevé est partiel. Bien sûr, il y a aussi, à Montrouge, tout ce qui échappe aux effets de cristallisations évoqués ou appartient à d’autres formations, non exploitées dans cet article. Par exemple, Bianca Argimon et son Hestia, cette terre d’accueil imaginaire, substitut à l’Europe des frontières closes ; le crépusculaire triptyque So long after sunset and so far from dawn de Romain Kronenberg ; le tropicalisme de Florian Viel, fait de néons, de papier peint et de lianes en kits… Et ceci est sans doute une des raisons pour lesquelles il faut aller à Montrouge : pour constituer sa propre collection de cristaux, sa propre scène bruissant de voix qui parlent tantôt ensemble, tantôt séparément.
Nina Leger
61ème Salon de Montrouge, jusqu’au 31 mai, au Beffroi, 2, Place Emile Cresp 92120, Montrouge. Ouvert tous les jours, de 12h à 19h.
[print_link]







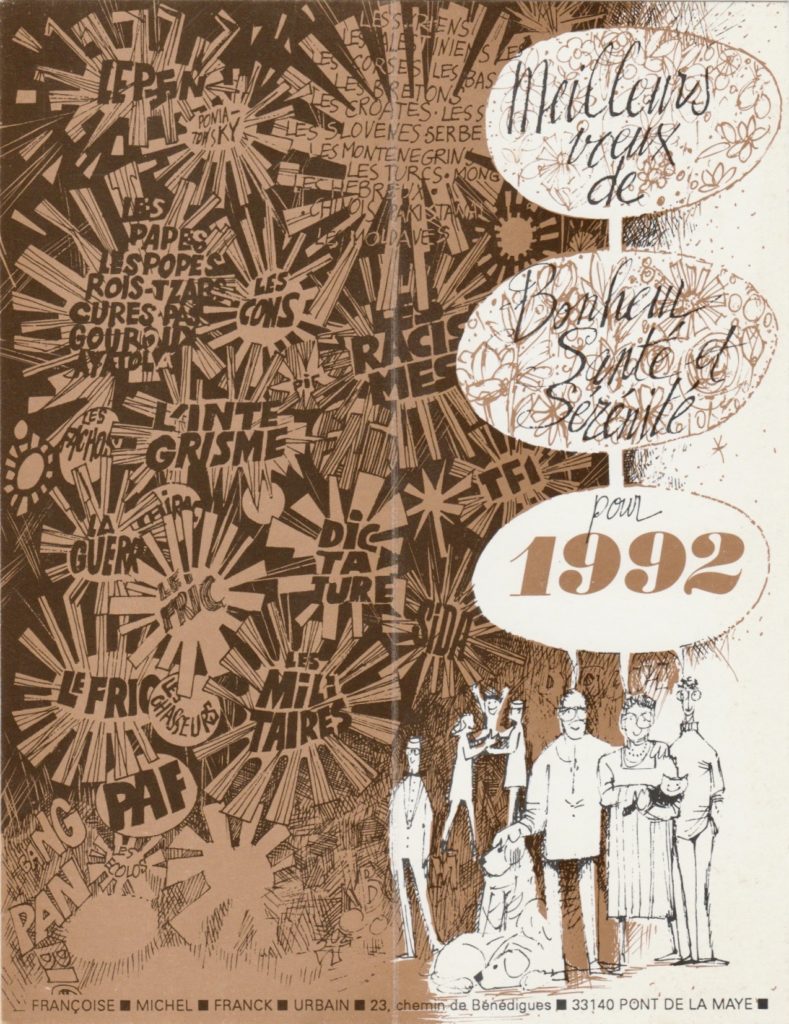
0 commentaires