Bonjour Anne, merci de m’accorder ce temps d’antenne. Une émission spéciale s’imposait. L’actualité est dense. En une semaine l’enquête a progressé à pas de géants. Nous marchons sur des sommets. L’affaire prend un tour politique. Je reviens de Nassau.
Ce n’est pas du tout ce qu’imaginent les gens. Pas le petit paradis sur terre avec cocktails à gogo et pin-up à l’avenant qu’on s’attend à découvrir. Avant de révéler les dernières informations, je voudrais lancer un avertissement aux téléspectateurs. Anne, tu me passeras cette privauté. N’allez pas aux Bahamas. C’est très surfait. C’est pour tout dire l’enfer. Nassau est un cauchemar qui se paye comptant.
J’avais pris un vol de nuit dans l’espoir de dormir durant le voyage. Nous avons eu des trous d’air, nous avons été secoués comme des puces, il n’y a pas eu moyen de fermer l’œil. À l’arrivée j’ai été suffoqué par une chaleur moite, sale et insupportable. L’hôtesse nous avait prévenus peu avant l’atterrissage. Le temps est exceptionnellement chaud. Quand l’Airbus A350 a ouvert ses portes, les passagers ont retenu leur souffle. Il faisait un peu plus de 45 degrés. L’Arabie saoudite en version humide. Ce n’était encore rien. Le pire restait à venir.
Sur le tarmac nous avons été accueillis par la police locale. Des gendarmes d’opérettes vêtus de short et portant des tongs nous ont escortés manu militari jusqu’au hall de l’aéroport. Ils paraissaient à cran. L’un d’eux a dégainé son révolver après avoir aperçu un passager ouvrir son bagage à main. Le péquin cherchait une bouteille d’eau. La situation s’est aggravée à la douane quand jj’ai décliné mon identité. Que cherchait un commissaire français dans ce paradis tropical? Il valait mieux taire les raisons de mon séjour.
Par chance Billot avait bien fait les choses. Il avait réservé une suite dans un des meilleurs hôtels de Nassau avec piscine, jacuzzi, hammam (on se demande bien pourquoi avec le temps qu’il fait) et courts de tennis privés. L’officier qui m’interrogeait habitué à voir les fonctionnaires payés trois francs six sous a déduit du prix de ma chambre que je voyageais pour mon compte. Dès le moment où il n’a plus vu en moi qu’un flic corrompu, comme il y en a tant ici, il a changé de ton. J’étais le bienvenu à Nassau.
J’ai pu quitter l’aéroport sans plus de formalités. Épuisé par le vol de nuit, accablé par la chaleur, je me suis effondré sur le grand lit de ma chambre d’hôtel. J’ai émergé péniblement en fin d’après-midi avec un puissant mal de gorge provoqué par l’air conditionné que la direction du palace règle sur son maximum. Dans la pièce il ne faisait pas plus de 18 degrés. J’ai passé un pull et appelé le room service afin qu’on me serve une collation. Il était trop tard pour commencer mes recherches. À Nassau comme en Espagne les banques n’ouvrent que le matin. L’après-midi est dédié à la sieste et aux activités de loisir qui abondent sur cette île. Plongée sous-marine, excursion en forêt, ski nautique, golf, tennis, pêche au thon, croisière côtière. Le tout est hors de prix et s’adresse à une clientèle richissime.
La capitale est d’une propreté helvétique. Pas un papier ne traîne dans les rues. Des arbres exotiques aux fleurs abondantes et au parfum capiteux agrémentent les avenues de cette ville d’anciens corsaires remise au goût du jour à la faveur du miracle bancaire. Il y a bien sûr quelques bidonvilles où s’entasse la main d’œuvre bon marché qui fait tourner le pays mais on ne les voit pas. Ils ont été relégués en grande périphérie, loin des plages et des hôtels, loin de tout en somme. Les employés sont des gens de couleur, les touristes sont blancs. L’impression dominante est que tout fonctionne à merveille. Il n’y a pas de manifestations, pas de protestations à Nassau. On ne pose pas de questions. On profite du séjour et on paye cash.
Je me suis présenté le lendemain matin au guichet de la Banque Transocéanique dans l’intention d’ouvrir un compte. Le procureur Poisson m’avait autorisé à emporter une mallette de billets pris sur des fonds spéciaux. L’employé, un Caribéen tiré à quatre épingles, a regardé avec condescendance les 200 000 dollars que j’avais déposés sur le comptoir. Le chanteur coûte cher à l’État français mais le succès de l’enquête est à ce prix. Quand j’ai ajoutéi vouloir virer chaque mois une somme équivalente, le visage de l’employé s’est déridé un peu. Il m’accordait le rendez-vous que je demandais avec le conseiller que je piste depuis les révélations de Bartier. L’homme hélas n’était pas disponible avant quatre jours. J’ai ainsi eu tout le temps de visiter Nassau et de m’essayer à des sports que je n’avais encore jamais pratiqués comme le parachute ascensionnel.
Le conseiller, un Américain de la côte Est, m’attendait lorsque je suis arrivé quelques jours plus tard. Nous avons parlé voyage, culture et cuisine. Les linguine à la chair de homard que j’avais goûtés la veille à l’Excelsior étaient exceptionnelles. L’endroit est une des adresses les plus chères de la ville. Le conseiller a paru satisfait et nous avons commencé à aborder les véritables questions. Je passe sur les détails techniques du blanchiment qui n’intéressent pas le grand public plus familier du compte épargne que des paradis fiscaux. L’essentiel est de savoir que le circuit financier qu’on me proposait était celui qu’avaient utilisé Bartier et Jo: Paris, Luxembourg, Jersey, Nassau. J’entrevoyais le bout du tunnel. Il fallait désormais comprendre à quoi servaient ces sommes d’argent envoyées chaque mois derrière le dos du contribuable français. Achat d’une villa avec vue sur la mer? Placements dans des actifs douteux mais rentables (cocaïne, trafic d’êtres humains)? J’étais loin de la vérité.
Le conseiller, Robert Woolroof, a changé soudain de sujet pour connaître mes opinions politiques. Il tenait à savoir ce que je pensais de la gouvernance de la planète. Woolroof n’y allait pas par quatre chemins. La planète! Je n’ai pas vu tout de suite où il cherchait à m’entraîner. Je lui ai renvoyé la balle. Le monde ne va pas bien. Les guerres, les épidémies, le réchauffement climatique, la menace nucléaire, la crise économique, la faim. Il y a des raisons de s’inquiéter, n’est-ce pas? Je préférais demeurer consensuel. Nous avons discuté un moment de la pluie et du beau temps. L’animal ne sortait pas de son terrier. Il attendait de ma part un signe qui lui permettrait de s’aventurer sans péril en terrain découvert. Je me suis souvenu de Kurz. Le gamin n’aimait pas le foot. Il rêvait d’instaurer un nouvel ordre. J’ai pris dans cette direction et dénoncé l’anarchie de nos sociétés, le laisser-aller général, la mollesse enfin de nos dirigeants politiques. Où va le monde?
Tout en parlant, j’observais le conseiller. Le personnage mérite d’être décrit. Grand de taille, mince jusqu’à la maigreur, Woolroof se distingue à l’attention par des yeux gris bleus qui donnent à son regard des reflets métalliques. Le cheveu ras, blond tirant vers le blanc, il a su garder le teint pâle, une gageure dans un pays où le soleil tanne les peaux les plus claires. L’homme ne semble pas un être un habitué des plages. Il ne pratique pas les sports nautiques pas plus que la randonnée pédestre. Il a saisi la balle au bond.
Tout va de travers, m’a-t-il répondu. C’est le bordel, si vous voulez mon avis. Pour des raisons que je ne m’explique pas, Woolroof semblait m’avoir pris en sympathie. Il m’a offert de fumer un havane. Il était quoi, 11h, 11h30. Il a décroché son téléphone pour commander deux cocktails maison. Une heure plus tard nous poursuivions la conversation à table autour d’une délicieuse dorade au gros sel. Cependant Bob, il m’avait dit après avoir allumé son cigare, Bob, appelez-moi Bob – je me suis demandé s’il s’agissait d’un mot de passe me rappelant comment Balda m’avait suggéré de l’appeler simplement Jo – Bob donc papillonnait. Il semblait avoir oublié pourquoi nous déjeunions ensemble.
Il dégustait son poisson avec une méticulosité d’artiste, séparant avec soin les arêtes de la chair, triant les beaux morceaux. Dire qu’il mangeait aurait été excessif. Il grignotait. Il buvait en revanche copieusement. La première bouteille de montrachet n’avait pas survécu aux entrées, un assortiment de pinces de crabe et de crevettes grillés épicées au piment de Cayenne. Bob terminait la seconde bouteille en même temps qu’il renvoyait sa dorade. Je n’ai plus faim, a-t-il confié au serveur en lui tendant son assiette.
Il a enchaîné sans transition sur la seconde guerre mondiale. Ç’avait été une catastrophe. Je ne pouvais qu’abonder en son sens. Hitler était si près de réussir, pensait-il. Les extrémistes de tous poils ont ceci de particulier qu’il est impossible de les faire taire lorsqu’ils abordent leur marotte. Ils sont sur la réserve, volontiers silencieux s’ils se sentent en territoire ennemi, mais ils se montrent au contraire d’une insatiable volubilité avec ceux qu’ils sont persuadés de mettre dans leur poche. Les néophytes excitent leur talent d’orateur. Ils ne craignent pas le sublime. Tout devient historique quand il s’agit de convaincre un quidam hésitant. C’est toujours le grand soir. Woolroof me croyait des leurs ou sur le point de le devenir. Rien ne pouvait l’arrêter.
Il a voulu une fine champagne avant de m’exposer les raisons qui avaient précipité la chute du régime nazi. Hitler était un visionnaire, mais en même temps un exalté. Conquérir le monde en quatre ans! Ce n’était pas sérieux. Le Führer avait péché par précipitation. Les problèmes techniques liés à l’extermination des juifs avaient été sous-évalués tout autant que la puissance de l’idéologie adverse. On ne chasse pas d’un revers de la main vingt siècles de judéo-christianisme, poursuivait-il en avalant d’une traite son verre d’alcool pour en prendre aussitôt un second. J’ai accepté cette fois-ci de me joindre à lui. J’avais besoin d’un petit remontant. Et puis, ajoutait-il le sourire aux lèvres, le monde n’était pas prêt.
Le restaurant où nous déjeunions est un endroit réputé et très chic fréquenté par le gratin de Nassau, hommes politiques véreux, personnalités du show business, banquiers. La porte d’entrée est gardée par deux athlètes blancs dont l’un d’eux montre une vague ressemblance avec Arnold Schwarzenegger. À l’intérieur une terrasse ombragée et rafraîchie par des brumisateurs accueille une clientèle soucieuse de son bien-être et discrète.
Le monde a changé, a repris Bob après une légère pause étudiée. Les citoyens sont devenus dociles. L’habitude des grands rassemblements que leur donnent les concerts pop les prépare aux grandes messes politiques. La mondialisation facilite le travail de propagande, un travail essentiel sans lequel il n’y a aucune obéissance, aucune soumission. Et si le peuple est insoumis, vous savez ce qu’il arrive. C’est la démocratie. Heureusement ces temps sont révolus. Pensez qu’aujourd’hui un Américain du Texas peut chatter avec une Française, je ne sais pas, du Loir-et-Cher par exemple. Ils ne se sont jamais vus, ils ne rencontreront probablement jamais, enfin ils ne se connaissent pas, mais ils échangent, ils échangent à toute heure du jour et de la nuit malgré le décalage horaire.
Les réseaux sociaux sont de formidables outils de communication. Les gens éprouvent désormais le sentiment d’être proches les uns des autres quelle que soit la distance. Ils forment une seule et même humanité. Il reste sans doute quelques réfractaires. Ils disparaîtront bientôt broyés par la machine. Nous ne trouvons déjà plus de voix réellement discordantes sur Internet. La Toile est partout. Elle pénètre les cœurs, elle plie les volontés. Et tout cela pour le plus grand bonheur de tous. Le monde est prêt, Beltram! Il suffit maintenant de frapper un grand coup.
Woolroof s’était quelque peu emporté et avait haussé légèrement la voix. Plusieurs convives se sont retournés pour me fixer et me jauger. J’étais un étranger dans ce cercle étroit des milliardaires internationaux où chacun se connaît. Mais la confiance que m’accordait Woolroof en me parlant sans détour, comme à un initié, a semblé rassurer les plus suspicieux. J’ai entendu de nouveau le bruit des couverts contre les assiettes en porcelaine. Si Bob mangeait peu, il n’en allait pas de même des autres clients. Ils dévoraient leur plat avec cette avidité qui caractérise les carnassiers. Woolroof attentif au moindre détail a préféré baisser le ton. Malgré la qualité de la cuisine, je commençais à trouver le temps long, j’attendais des faits. Je ne voyais pas en quoi ses opinions concernaient l’argent que je venais peut-être imprudemment de lui confier. Ce conseiller bancaire pouvait être un escroc de la pire espèce.
Je comprends votre impatience, m’a-t-il dit comme s’il lisait à livre ouvert dans mes pensées. J’ai quelque chose en vue pour vous. Une belle affaire. Nous en discuterons ailleurs. Tout le monde nous écoute, chacun est à la recherche d’une bonne opération. Vous pourriez sans doute vous adresser à mon collègue de la Banque du Panama qui déjeune à deux tables de la nôtre. Ce midi il régale un sénateur américain. Il vous proposerait de beaux placements. Il est connu pour son flair. Ce que j’ai à vous offrir est d’une toute autre envergure. Passez demain à mon bureau, vers les 10h. Je suis certain que nous allons nous entendre.
C’est à peu près en ces termes que Woolroof m’a fait ses adieux avant de disparaître emporté par une luxueuse limousine aux vitres teintées. Je n’ai pu m’empêcher de le maudire en constatant qu’il me laissait une addition salée sur les bras. La bouteille de montrachet valait à elle seule trois cents dollars. Le procureur Poisson avait déjà renâclé à dégager les fonds nécessaires à l’ouverture d’un compte dans un paradis fiscal. Le prix prohibitif de mon hôtel l’avait ensuite jeté hors de ses gonds. Mis devant le fait accompli, il m’avait recommandé de me contenter de sandwichs pour les frais de bouche. Ils doivent manger des tacos à Nassau, non? C’est bon les tacos, c’est nourrissant et surtout ça ne coûte rien. Mangez des tacos, Beltram. Le serveur a paru surpris quand je lui ai réclamé la note. Elle avait évidemment été réglée. J’avais commis un faux pas, une faute de goût en quelque sorte.
Le lendemain Woolroof m’attendait dans le hall de la banque avec une impatience qu’il ne chercha pas à dissimuler. Vous voilà! s’exclama-t-il en m’apercevant. Un ascenseur nous transportait au dix-huitième étage d’un building flambant neuf. Bob paraissait surexcité. Ses yeux brillaient comme deux lampes-torche dans la nuit, son regard était effrayant. Vous connaissez Niteroi, me demanda-t-il sans plus d’explication. Le nom me rappelait une ville que ma mémoire peinait à retrouver. Niteroi, Niteroi. De l’autre côté de la baie, précisa Bob devant mon embarras. Voyons Beltram, ne me dites pas que vous n’êtes jamais allé à Rio. Le déclic s’est produit sur ce mot. L’un des deux Brésiliens que nous avons fini par libérer avait travaillé à Niteroi dans une salle de musculation. C’était le plus idiot des deux. L’autre, Ronaldo, possédait au moins un peu de sens musical.
Oui, bien sûr. Niteroi. La colonie allemande de Niteroi. Enfin Señor Beltram, je vous retrouve. Bob aime à l’occasion mâtiner son anglais d’expressions espagnoles. C’est chez lui un signe d’affection, ai-je cru comprendre. Por favor, allons droit au but maintenant. Je ne demandais rien d’autre. Woolroof me montra un ordre de virement permanent à échéance mensuel d’un montant de 100 000 dollars. Ce n’est qu’un début, n’est-ce pas? me lança-t-il sur un ton égrillard.
L’argent enivrait Woolroof. Palper des millions de dollars devait lui procurer une jouissance proche de l’orgasme. Il adoptait depuis quelques instants une attitude presque féminine, minaudant, avec des trémolos dans la voix lorsqu’il égrenait les chiffres. Le virement était à l’ordre de Karl Reinhardt sur le compte d’une banque suisse établie au Brésil depuis la fin de la seconde guerre mondiale. J’en avais entendu parler quelques années auparavant dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent. L’enquête s’était enlisée. La banque était intouchable, protégée par des personnalités de premier rang dont l’identité n’avait pu être révélée. Entendre prononcer le nom de Reinhardt dans cet espace feutré d’un bureau d’une tour de 32 étages me fit vaciller sur mes jambes.
C’était le building qui tanguait légèrement. Nous allons avoir un coup de vent, me dit Woolroof. Le gratte-ciel commençait à se dandiner comme une catin. Vous connaissez l’organisation, poursuivait le conseiller sans prêter attention aux nuages noirs qui s’amoncelaient à l’horizon. Reinhardt abat un sacré boulot. Les événements vont se précipiter. Vous l’aurez, votre retour sur investissement. Le Brésil est déjà entre nos mains, les États-Unis n’attendent que le signal, l’Europe est à genoux. Vous ne serez pas déçu, Beltram. Reconnaissez qu’il est tout même plus intéressant d’investir dans l’édification d’un ordre nouveau que dans le commerce des cacahuètes. La perspective de participer au grand chambardement ne vous excite pas? Si le chef a confiance en vous, il vous confiera des missions de premier ordre. Un commissaire de police peut nous être très utile. Je crois que vous lui plaisez déjà. Nous nous sommes renseignés.
Woolroof me tendit le papier. Il n’y avait pas d’autre choix. J’ai signé. Le building bougeait sérieusement. Le coup de vent se transformait en cyclone. Nous nous séparâmes en toute hâte. Prenez l’escalier. C’est plus prudent, me lança Woolroof avant de s’éclipser par une autre porte. Je quittais le bureau quand il réapparut, le visage joyeux. Les aléas du climat ne le tourmentaient guère. Revenez dans deux mois. Je vous donnerai le détail de l’organisation.
À peine sorti de l’immeuble, je fus douché par les trombes d’eau qui s’abattaient en rafales. Nassau n’est vraiment pas l’endroit idéal pour passer ses vacances. J’ai dû attendre deux jours encore pour attraper un vol. La tempête avait cloué au sol tous les appareils.
Chapitre précédent La Terre n’est pas assez ronde Chapitre suivant






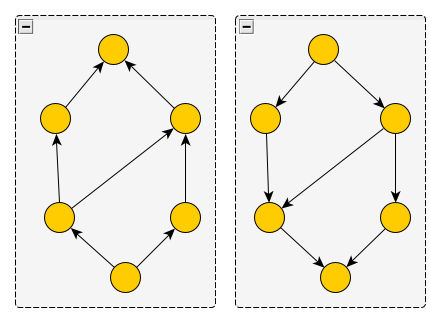


0 commentaires