Pionnier des enquêteurs sur la sexualité, Alfred Charles Kinsey réalise une première enquête sociologique dans les années 1940-1950, qui dresse un inventaire des pratiques sexuelles. Pénétration, caresse, fellation, mais aussi zoophilie, douleurs variées, sodomie. Pour Kinsey, originellement entomologiste, le propos n’est pas la morale mais la documentation des mœurs. Son étude fait scandale. Elle va également éveiller la curiosité d’autres chercheurs, déterminés à sortir du cadre de la bien-pensance et de la religion.

Virginia Johnson (Lizzie Caplan) et Bill Masters (Michael Sheen).
C’est ainsi que les sexologues Masters et Johnson vont prendre le relais, et initier des recherches sur la sexualité à l’université Washington de St Louis (Missouri). Nous sommes à la fin des années 1950, Bill Masters est un gynécologue obstétricien connu pour ses travaux sur la fertilité, et applaudi par la bonne société qui lui doit quelques bébés. Virginia Johnson, elle, est une borderline sociale. Mère de deux enfants, ancienne chanteuse de cabaret, très à l’aise avec sa sexualité et son indépendance économique et affective, elle distingue le plaisir sexuel de la relation amoureuse, une attitude qui n’est pas exactement plébiscitée par l’Amérique de Truman et d’Eisenhower.
Une Amérique légendaire
Masters of Sex, de Michelle Ashford raconte en quatre saisons l’histoire de ces deux chercheurs, de leurs observations en labo sur le plaisir partagé en duo ou en solo. Mais, au-delà du fait historique et/ou scientifique, la série, adaptée du roman éponyme de Thomas Maier (non traduit en français), coche de nombreuses cases pour figurer dans le top des fictions sur le sexe. Reconstitution historique, on y savoure de belles images sur une Amérique légendaire (ses voitures, son mobilier, ses tenues vestimentaires soignées). Le casting, impeccable, joue sur le contraste entre une Virginia Johnson/Lizzie Caplan « raisonnablement » libérée face à un Bill Masters/Michael Sheen taiseux, coincé dans ses principes et ancré à une enfance difficile. Comme pour toute série digne d’intérêt, les personnages secondaires bénéficient eux aussi de leurs propres problématiques, qui densifient le propos.

Masters of sex – saison 1. Photographie Erwin Olaf.
Mais le talent d’Ashford, en l’occurrence, est d’avoir réussi à ouvrir des passerelles entre l’histoire de Masters et Johnson et notre époque et ses questionnements post-#metoo. Chacun des personnages féminins vit une approche de son genre et de sa sexualité qui lui est propre, en lien avec son parcours. La femme du doyen Scully, Margaret (Allison Janney), la cinquantaine avancée et non désirée par son époux, souffre d’une très grande solitude. Leur fille Vivian (Rose McIver) se sent prête à tout pour épouser le bon parti jusqu’à ce qu’elle réalise que ce choix conventionnel ne lui convient pas. L’ex-prostituée Betsy DiMello (Annaleigh Ashford) comprend que sa témérité en matière sexuelle peut la mettre à l’abri.
Plaisir féminin
Quant à Virginia Johnson, personnage central de la série, moderne –voire avant-gardiste–, elle défend ses choix et propos contre toutes et tous, reprenant des études; n’acceptant aucune pression de la part d’un homme, fût-il amoureux; dépassant les obstacles que le patriarcat dresse sur son chemin de femme entreprenante. On la sent également vulnérable, et dans une grande solitude (sa relation avec le docteur Lilian DePaul –Julianne Nicholson, excellente– fait écho à cette solitude).
Si Masters of Sex raconte l’histoire de deux chercheurs hors du commun, de leurs parcours individuels et en duo vers une connaissance du plaisir notamment féminin, la série évoque avant tout la place de la femme dans une société en mutation. Et la mise en danger d’individus pour cause d’autocensure de soi sous le joug de la bien-pensance – un thème encore terriblement contemporain.
La série Masters of sex est disponible sur Canal+ VOD. 14,99€ par saison.








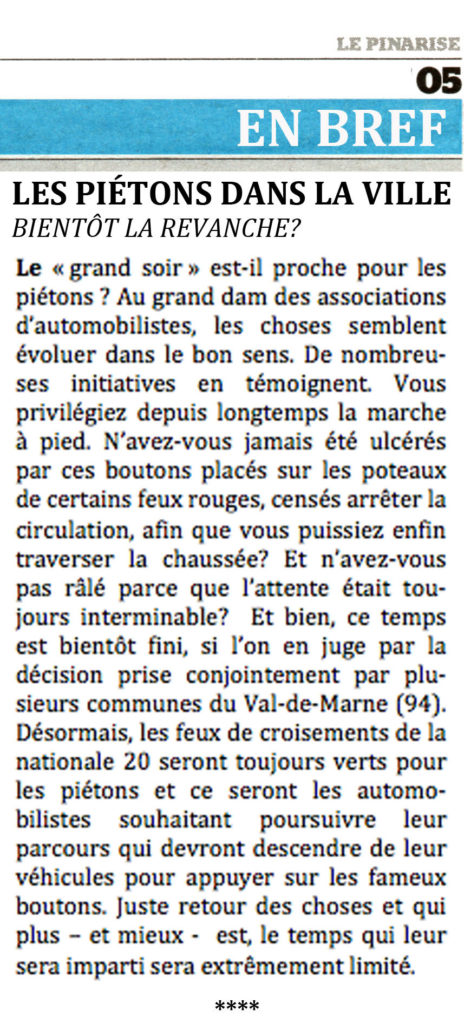
0 commentaires