Depuis Comment le peuple juif fut inventé, Shlomo Sand, historien, professeur émérite de l’université de Tel–Aviv, est honni par les uns, qui voient en lui un ennemi de son pays voire de son peuple et l’ont mal lu ; adulé par les autres, antisionistes, qui l’ont souvent mal lu aussi. Il publie son premier polar, La Mort du Khazar rouge, que l’on conseillera aux deux. Le roman, policier ou autre, a cet avantage : il échappe aux catégories et ouvre sur la nuance, l’intime. Et l’auteur.

© Olivia Grabowski-West
On retrouve dans La Mort du Khazar rouge vos thèses, vos recherches historiques. Pourquoi avoir choisi la forme du roman policier ?
Toute ma vie, j’ai écrit des fictions avec des notes en bas de page… Il y a forcément de la fiction dans l’Histoire, sinon on ne peut pas la raconter. Pas plus que le récit national. Et j’ai toujours voulu écrire. Avant de devenir historien, je rêvais d’être écrivain. Je n’en ai pas eu le courage. Je viens d’un milieu modeste, alors, universitaire, c’était un salaire, la retraite… Il y a des avantages, même si je ne suis pas tendre envers les universitaires dans le roman…
J’étais donc à l’hôpital avant mon opération du cancer, sans archives à portée de main, et j’ai pensé écrire sans les notes en bas de page. J’ai fait un essai, à l’imagination, sans m’appuyer sur les récits des autres. Et ce fut un plaisir. Le polar ? Depuis dix ans, j’avais vécu des choses difficiles, dont le cancer, et j’ai eu envie de me tourner vers le polar, avec ses morts, ses tragédies, ses assassinats, éloignés des tempêtes universitaires. Et depuis dix ans aussi, je me sentais en phase avec les polars scandinaves : Henning Mankell, Stieg Larsson, dont j’étais proche politiquement. Leurs livres sont graves, mais il y a toujours une ouverture, à la fin. Et puis j’avais ce désir de raconter une histoire. Avec la fiction, je sentais une liberté que je ne pouvais pas avoir dans mes récits historiques.
S’agissait-il aussi de toucher un public plus large ?
Mes livres historiques se sont très bien vendus ; ils sont traduits dans vingt-deux pays. Mais oui, disons plutôt atteindre un public différent : pas des savants, pas des collègues. Mes étudiants me reprochent toujours d’être trop minutieux, avec trop de notes…
Et donc, la victime du premier meurtre est un professeur de l’université de Tel-Aviv, Yithzak Litvak, qui par ses travaux remet en question le récit national israélien. Comme vous ?
Je ne suis pas Litvak. Je me suis inspiré d’un historien bien réel, Abraham Polak, que je n’ai pas connu personnellement. Polak, polonais, est devenu Litvak, lituanien. C’est lui qui a écrit le premier livre consacré aux Khazars [1]. Des questions se posaient au sujet de sa mort, et voilà : ce fut mon point de départ. Et comme je connais assez bien le milieu universitaire…
Alors qu’on vous accuse d’être un ennemi interne d’Israël puisque vos travaux sapent le mythe du « retour à la terre promise » et la notion de peuple juif, ce qui frappe, dans votre livre, c’est votre attachement au pays, aux gens, aux paysages, un attachement affectif, sensuel… Loin d’Israël, vos personnages en ont la nostalgie. Quel rapport entretenez-vous avec votre pays ?
Je ne suis pas né en Israël, mais dans un camp de réfugiés en Autriche, après la guerre. Je suis arrivé, bébé, avec la naissance de l’État. Si critique que je sois de la politique menée, je n’ai jamais remis en question l’existence d’Israël. Même en sachant très tôt qu’il s’agissait d’une colonisation, qu’on expulsait des gens pour bâtir un État. Mais comme cela se passait après la seconde guerre mondiale, je dirais que l’Europe a vomi ses Juifs sur des Arabes.
Puis j’ai fait des études en France, j’ai même commencé à enseigner à l’École des Hautes études, et, comme l’université de Tel-Aviv m’invitait à venir, j’y suis retourné. À Tel-Aviv, pas en Israël, la différence est très, très grande. Je vis à Tel-Aviv, j’y mourrai probablement. J’y suis attaché, à la vie quotidienne qu’on y mène. Pour donner une image : si Israël était Tel-Aviv, on serait déjà arrivé à un compromis historique avec les Palestiniens. Aux dernières élections, le centre gauche y a fait 35%, Netanyahou 19% ! La droite et l’extrême droite y sont très minoritaires. Mais Israël n’est pas Tel-Aviv, comme les États-Unis ne sont pas New York, Berlin n’est pas l’Allemagne…
Je suis en désaccord total avec la politique israélienne, avec le roman national sioniste, mais la politique en soi est faite de compromis. J’accepte donc certains processus. Je suis très radical dans mon écriture – et on retrouve cette radicalité dans mon polar, je crois – mais plus modéré politiquement que ce que les gens pensent généralement. Plus nuancé. Prenez mon personnage, Litvak : il est un sioniste convaincu, mais il est aussi anti-raciste, anti-essentialiste. Il sait très bien qu’on ne naît pas juif, on le devient. Et aussi que l’origine des Juifs dans le monde est variée. Ils ne venaient pas tous de la terre de Palestine.

Jaffa, où vit l’enquêteur Émile Markus, avec en fond les immeubles de Tel-Aviv. Fond d’écran de Shlomo Sand..
Votre enquêteur principal, Émile Morkus, est arabe chrétien israélien, autant dire un homme au ressenti complexe (et attachant). Dans la vraie vie, même après la nomination du commissaire Jamal Hakrush en 2016, qu’en est-il du parcours possible d’un Arabe israélien dans la police ?
Émile Morkus a un problème avec l’ordre. Au début de sa carrière, il veut être très israélien. Mais un malaise le gagne avec la première Intifada, c’est une autre dimension, il est touché par la souffrance des Palestiniens derrière les barrières. C’est un laïc complet, un serviteur de la loi. Là aussi, je me suis inspiré de quelqu’un qui a existé, dans la police israélienne. La plupart des spécialistes et historiens de la police que j’ai rencontrés le considéraient comme le meilleur enquêteur qu’ils connaissaient. Dans la vraie vie, il se retrouverait bloqué à un certain moment. Même si Émile Morkus part en retraite assez haut gradé. Ça, c’est possible. Mais pas devenir chef de la police.
À l’université, j’ai eu des élèves policiers, des généraux – par exemple Benny Gantz, que je n’ai pas vraiment connu, il parlait peu – et j’ai fait une recherche sur ce sujet, la montée dans la hiérarchie. Par exemple, il y a des Arabes dans l’armée israélienne, mais pas des Arabes ordinaires, des druzes, des bédouins. Mais je n’ai pas trouvé d’Arabe dans le Mossad, ni dans le Shabak [renseignement intérieur, ndlr] qui joue un rôle dans mon livre. Des gens intéressants mais pas d’Arabes. Du moins, je crois : je n’en fais pas partie !
Vous étrillez le petit monde universitaire, qui ressemble à d’autres petits mondes universitaires. Est-ce un roman à clefs, où le lecteur israélien [2] reconnaîtra tel ou telle ?
Il y a plusieurs choses que l’on peut reconnaître. Il y a un assassinat semblable à un assassinat qui a eu lieu dans la réalité. Cet homme, dit séfarade, qui fut accusé et condamné pour l’assassinat d’une étudiante. Il a passé onze ans en prison, en est sorti aveugle, comme dans le livre, est mort d’un cancer quelques temps après. C’est une histoire très connue, que des gens identifieront, même si j’ai changé le nom, y ai ajouté mon imaginaire. L’affaire avait touché beaucoup d’Israéliens.
Côté universitaires, oui, certains pourront se reconnaître aussi… Ne pas aimer. À un moment, j’avais envisagé d’assassiner davantage de mes collègues. Mais ça ne collait pas avec l’intrigue.
Votre livre n’est pas très indulgent envers les gauchistes israéliens, et pas plus envers les dirigeants palestiniens. Émile Morkus, le policier, pense qu’inculquer « le rêve du retour aux enfants dans les camps de réfugiés misérables » s’apparente à « un crime »…
L’écrivain n’est pas forcé d’adhérer aux opinions de ces personnages ! Mais je n’ai jamais caché les miennes. Si vous voulez savoir ce que je pense, je suis aussi contre le « droit au retour ». C’est du pragmatisme politique. Dire clairement qu’il est impossible de revenir dans cette maison qui a été détruite, mais : reconnaître les torts et réparer. Parler de droit du retour, soixante-dix ans après, à des gens éduqués dans des camps de réfugiés, leur dire qu’ils retourneront à Haïfa ou Jaffa, c’est presque un crime, oui, pour moi, car ce n’est pas possible.
C’est ce que dit É mile Morkus…
Et il m’a convaincu !
… Dans ma jeunesse – ici, en France – j’ai traversé et connu une période gauchiste. J’étais au Matzpen [3]. Après 67, j’étais à Jérusalem, combattant, j’ai tiré, on a tiré sur moi, j’ai fait partie des premiers groupes contre l’occupation. J’étais l’un des rares non-intellectuels. Mon bac, je l’ai passé à 25 ans.
Un ami israélien, alors, à Paris, m’a raconté cette histoire. Il se trouvait à une réunion d’extrême gauche, une quarantaine de personnes, lorsque quelqu’un apparut à la porte, et tout le monde a couru vers lui. Il demanda : c’est lui, le leader ? Non, lui répondit-on, c’est l’ouvrier… !
Voilà, mais ces groupes m’ont beaucoup appris, au niveau théorique, idéologique. Ceux dont je parle dans le livre, c’est plus tard : un groupe lambertiste. C’est eux que je décris sur le mode ironique. Même si les idées sont justes, le problème c’est les leaders, et dès qu’il y a dix personnes, il y a leader. Ce n’était pas marrant, surtout pour un type anarchisant comme moi. J’étais le seul Luxemburgiste. Je connais le sujet, j’ai fait ma thèse sur Georges Sorel et le syndicalisme révolutionnaire…
Jusqu’aux années 60, en Israël, des historiens mènent leurs recherchent et les publient, même lorsque celles-ci peuvent ébranler ce qui est devenu le Roman national israélien, avec exil d’un peuple unique et retour fondé à la terre. Derrière les meurtres ciblés du roman, l’histoire d’une reprise en main ?
Jusqu’à la guerre de 67, un Juif pouvait ne pas être le descendant direct du roi David, ou de ses troupes. Lorsqu’Abraham Polak publie, même le ministère de l’Éducation approuve lorsqu’il écrit que l’origine des juifs ashkénazes est plutôt de l’est (Khazars, peuple de la steppe converti, ndlr) et non de l’ouest (diaspora). Un peuple de convertis, comme la Khaïna dans le Maghreb, comme ce royaume juif yéménite Himyar. Il n’y avait pas, alors, cette idée essentialiste, de ligne directe depuis David, avec des soldats israéliens qui en seraient issus. Mais comment, autrement, justifier l’éviction de la Jérusalem arabe ? Donc les Juifs sont partis il y a deux mille ans de Palestine, sont allés jusqu’à Moscou, et sont revenus. Chaque Israélien apprend ça dès l’école.
Il y a deux versants à votre question, l’essentialisme était autrefois moins fort, mais l’idée était tout de même que les Juifs rentraient d’exil. Même quand j’étais gauchiste, antisioniste, j’étais certain que les Juifs avaient été expulsés, même si je n’étais pas convaincu d’un droit au retour deux mille ans plus tard. Il a fallu que je fasse des recherches pour découvrir qu’il n’y a pas trace de cette expulsion. Il n’y a pas eu d’exil en nombre depuis la Judée. Le roman national est aujourd’hui plus fort que dans les années cinquante.
Est-ce ainsi que l’on en arrive aux tests ADN pour déterminer la judéité des futurs époux ?
Vous voulez vraiment que je parle de ça ? Il y a plusieurs centres israéliens, et un à New York, qui cherchent obstinément un ADN juif. Que les Juifs, qui ont tellement souffert au XXe siècle, en viennent à cette vision ethnique… Il y a une culture yiddish, par exemple, oui, mais il n’y a même pas de culture juive commune à tous, seulement une religion comme fondement commun. Alors on cherche l’ADN juif sans le trouver, c’est de la religion ! Mais je n’en parle pas plus, c’est le sujet de mon prochain roman…
Shlomo Sand
Propos recueillis par Dominique Conil
Livres
 La Mort du Khazar rouge, Shlomo Sand, traduit de l’hébreu par Michel Bilis, 380 pages, éditions du Seuil, 21 € .
La Mort du Khazar rouge, Shlomo Sand, traduit de l’hébreu par Michel Bilis, 380 pages, éditions du Seuil, 21 € .
[1] Abraham Nahum Polak est un historien israélien né en 1910, auteur, entre autres, de Khazars, histoire d’un royaume juif en Europe, publié en 1943, qui reçut alors le prix Biziak de la pensée juive à Tel-Aviv, avant d’être, plus tard, critiqué et jamais réédité : l’historien en se basant sur de nombreuses sources, estimait que la plus grande partie des Juifs ashkénazes était issue du peuple de la steppe khazar converti au judaïsme, ce qui invalidait une filiation venue tout droit de Palestine, et remettait en question le droit au retour invoqué par le récit national israélien. Abraham Polak, lui-même sioniste, est mort en 1970.
[2] Sous le titre Vivre et mourir à Tel-Aviv, le roman est publié depuis trois semaines en Israël.
[3] Matzpen : parti communiste israélien (extrême gauche)



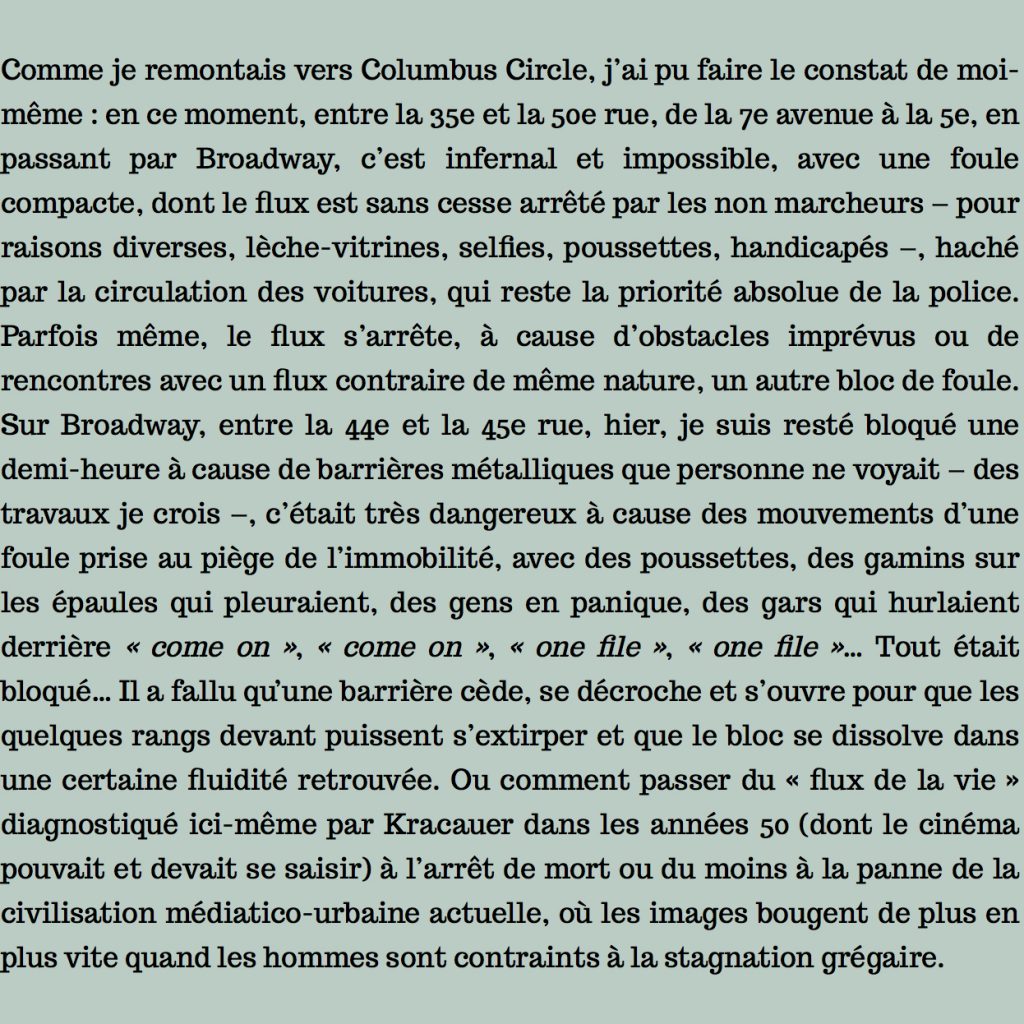




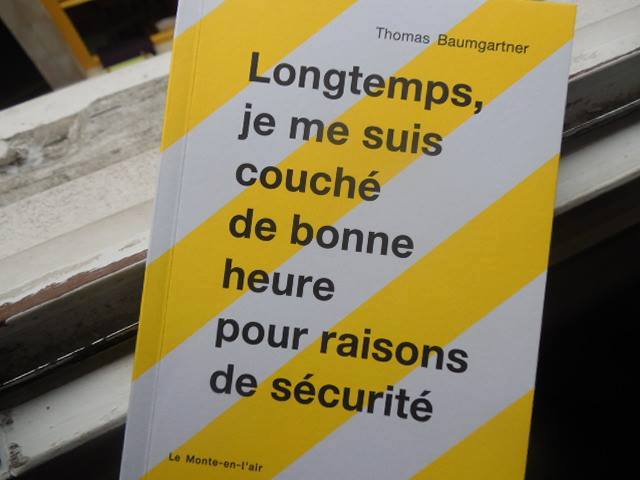
0 commentaires