 Quand la SF tourne au road movie dépressif : un père, assisté de sa femme et d’un ami, fuit et lutte pour protéger son fils Aton, doué d’une aura paranormale, avant un mystérieux rendez-vous donné par des forces invisibles… Pour son troisième long métrage, Jeff Nichols quitte ici le territoire southern gothic de Mud et Take Shelter, pour marcher sur les pas du patriarche Spielberg, en une sorte de remake inversé de Rencontres du Troisième type. Assurément, Nichols compte parmi les héritiers du wonder boy d’Hollywood, tant le film palpite de reflets avec les œuvres de J.J. Abrams, M. Night Shyamalan, ou même James Cameron… Et pourtant, s’il y a bien crise du sens ici, ce n’est pas dans le pur jeu référentiel où finit par se perdre Deadpool – chroniqué ici-même – mais au contraire, par ce qui se murmure de si “spécial” à “minuit” : le sens a disparu, il a quitté notre monde.
Quand la SF tourne au road movie dépressif : un père, assisté de sa femme et d’un ami, fuit et lutte pour protéger son fils Aton, doué d’une aura paranormale, avant un mystérieux rendez-vous donné par des forces invisibles… Pour son troisième long métrage, Jeff Nichols quitte ici le territoire southern gothic de Mud et Take Shelter, pour marcher sur les pas du patriarche Spielberg, en une sorte de remake inversé de Rencontres du Troisième type. Assurément, Nichols compte parmi les héritiers du wonder boy d’Hollywood, tant le film palpite de reflets avec les œuvres de J.J. Abrams, M. Night Shyamalan, ou même James Cameron… Et pourtant, s’il y a bien crise du sens ici, ce n’est pas dans le pur jeu référentiel où finit par se perdre Deadpool – chroniqué ici-même – mais au contraire, par ce qui se murmure de si “spécial” à “minuit” : le sens a disparu, il a quitté notre monde.
C’est que “l’enfant prodige” reste un mystère – et d’abord pour les siens. Aton, réactivant la mythologie du jeune mutant surpuissant (on pense à Akira, entre autres), est un hypersensible que l’univers dérègle autant qu’il dérègle l’univers. Drame de la paternité, Midnight Special a l’idée simple et géniale de faire surgir ses transes, petits suspenses ou grands spectacles, comme ces symptômes d’une catastrophe que des parents démunis ne savent déchiffrer – le réalisateur a raconté sa panique, quand il fut confronté aux spasmes de son nourrisson. Les ressorts internes d’un enfant comme autant d’énigmes quantiques du cosmos… Jusqu’à cette belle scène où, au cœur d’une grotte cachée dans la forêt, dans un huis clos de conte si organique et intime que l’espace s’abstrait en une pure rêverie psychanalytique, l’enfant convainc le père de lui laisser faire enfin ce qui est censé le tuer. Il faudra à Aton quitter les lunettes et les interdits dont les adultes l’ont voilé, pour laisser se révéler son identité. Car s’écrivent ici les lois d’Asimov de l’amour parental, le père restant le vrai héros de cette aventure initiatique : tout faire pour protéger sa progéniture ; tenter de comprendre comment elle fonctionne ; accepter de la voir grandir et partir.
Mais pas plus que les parents, les experts conjugués du FBI et de la NSA n’y comprennent rien. Si une révélation nous attend bien à la fin, nous ne saurons jamais le détail du pourquoi ni du comment, ainsi que la SF se sent si souvent obligée de nous en débiter la théorie, selon la mode du moment. Et quand un spécialiste décrypte enfin le réseau des coordonnées affiché au tableau, le spectateur reste ce mauvais élève perdu face à une équation trop complexe, celle de notre monde. Nous voici collés à la surface de l’événement, aveuglés par toute une pyrotechnie d’éclats et d’éclairs, chats pris dans les faisceaux de ces effets spéciaux venus bouleverser un monde sombre et immobile.
Notre univers tout entier est un mystère, une nuit noire où nos existences filent comme un bolide roulant tout phare éteint (splendide scène inaugurale). Toute la mise en scène conspire à cette opacité des signes : expressionnisme en 35 mm des ténèbres et des ombres, jusqu’à “l’aurore” du film ; intérieurs carcéraux (planque, voiture, camp, cellule…), barricadés pour se défendre d’un dehors plein de menaces ; énergie neurasthénique du rythme et de l’interprétation, tout en dialogues minimalistes et silences éloquents ; masque minéral et regard de Gorgone du géant Michael Shannon, ici encore statue vivante de l’Amérique parano où doutes et peurs se sculptent en spasmes à peine perceptibles (l’acteur attitré du cinéaste persiste à réinventer le modèle hollywoodien de la “tension intérieure”, tel qu’à sa manière border line De Niro l’a longtemps porté)…
Au milieu de tant d’obscurité, le regard d’Aton, libéré pour des instants d’épiphanie, illumine les adultes. Touchés par la grâce d’une tendresse infinie, ils se convertissent aussitôt en disciples tels les apôtres suivant le Christ. Nichols retravaille ici son obsession pour la foi : la religion sans doute, en notre ère de fanatisme et de crise – prophète d’une secte malgré lui, Aton ne cesse d’interroger ce Ciel qu’on croyait vide et d’où ce n’est plus l’œil de Dieu qui nous surveille –, mais plus largement, l’espérance, ce à quoi on se rattache pour survivre.
Quiconque a étreint un bambin dans les heures qui ont suivi les attentats de Paris, comprend de quoi nous parlons. Devenus pervers polymorphes depuis Freud, les enfants n’en demeurent pas moins cette lumière dans la nuit où nous nous débattons tous : “notre besoin de consolation est impossible à rassasier”, comme en fait adage le plus beau titre du monde – et un des plus beaux essais poético-philosophiques – signé du Suédois Stig Dagerman, manifeste de l’espoir envers et contre tout, paru deux ans avant son suicide. Face à un absurde camusien tel qu’il faut peut-être se reposer le seul “problème philosophique vraiment sérieux”, l’enfance est un super pouvoir : une puissance de réconfort.
Thomas Gayrard
Midnight Special (1h41) de Jeff Nichols, avec Michael Shannon, Jaeden Lieberher, Joel Edgerton… Sortie le 16 mars.





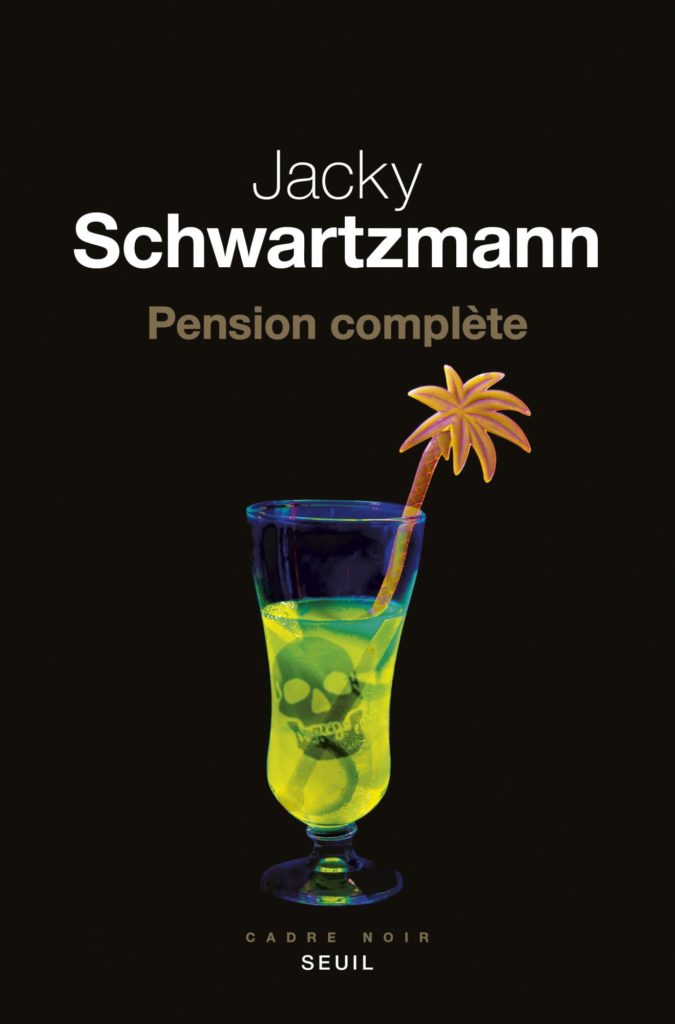
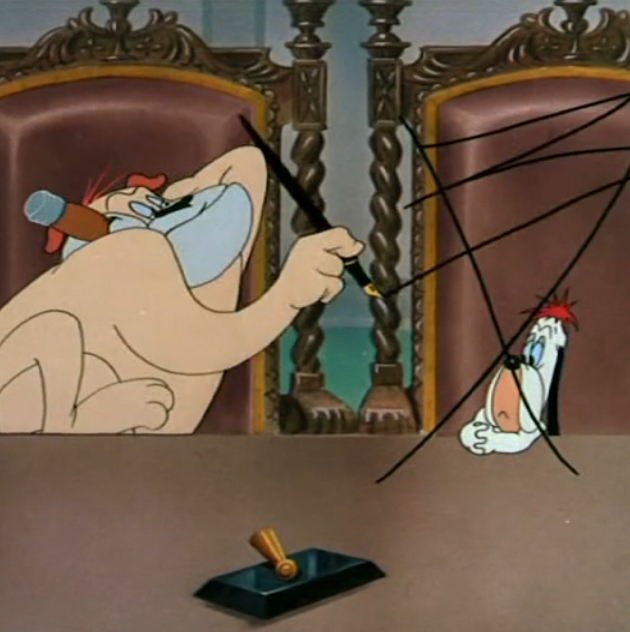

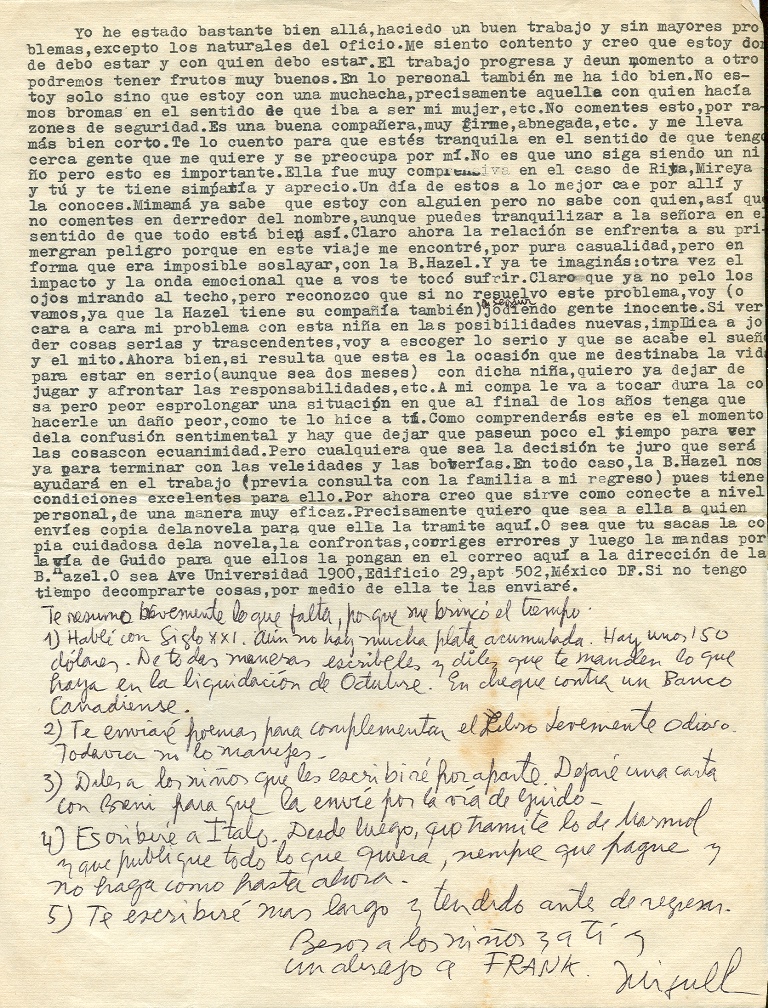
0 commentaires