Les mondes possibles, dont nous parlions dans notre précédente chronique, portent en eux le risque de n’être que des virtualités incapables d’entrer en manifestation, se réduisant alors à de simples phantasmes évanescents, d’où l’importance de les faire voir. En tant qu’il est toujours une représentation, le pouvoir se situe en effet dans la sphère du visible, d’une part parce qu’il doit être vu comme tel, d’autre part parce qu’il institue la manière de voir le monde de tous ceux sur lesquels il s’applique. Quoiqu’on en dise aujourd’hui, plus qu’une question d’image, la politique est avant tout affaire de « monuments », c’est-à-dire que réalisations majestueuses permettant sa persistance dans le champ du regard. La grandeur des hommes, des peuples ou des événements, perdure dans l’érection de ces ouvrages destinés à en perpétuer la mémoire, afin que la visibilité persiste après l’effacement du temps. Le monument n’est cependant pas seulement un vestige du passé : il est aussi et surtout l’incorporation du pouvoir, sa réalisation formelle, capable de fixer son inévitable disparition. Plus profondément, la « monumentalité » est alors ce qui caractérise toute œuvre majeure, la production dans laquelle l’art trouve son expression la plus achevée. Comme l’expliquent Deleuze et Guattari, le monument est une fusion de sensations qui permet de faire perdurer sous une forme stable l’événement, donnant ainsi un corps au virtuel, qu’il soit passé ou futur [1]. Les grandes œuvres artistiques ont ce statut de « monuments », en nous faisant pénétrer dans un autre monde, celui né du regard de l’artiste, nous invitant à appréhender différemment celui dans lequel nous vivons [2].
Comme tous les arts portés par l’image, la BD érige des monuments qui rendent visibles une multitude de mondes possibles, par exemple en imaginant une variation hyperbolique à partir de réalités existantes. Certaines de ses productions permettent ainsi de nous interroger sur les risques inhérents à des pratiques politiques pourtant consensuelles, en mettant en évidence leurs basculements possibles dans des réalités dystopiques. Riff Reb’s met en scène, dans les trois opus de son Myrtil Fauvette (Les Humanoïdes associés, 1990-1995), une dictature écologique dans laquelle toute forme de pollution est rejetée de manière autoritaire. Pétrie de bons sentiments et plaçant le politiquement correct au-dessus de tout, la culture s’y trouve réduite à des niaiseries sentimentales, visant à ne choquer personne. Chaque citoyen est par exemple contraint d’adopter un animal, attribué par tirage au sort — faisant que l’on voit une mamie promenant son hippopotame ou un père de famille, sa girafe — et les chars de l’armée sont recouverts d’espaces verts… Tout naturellement, la contestation est assurée dans ce monde inversé par les « salitionnistes », apôtres de la pollution à outrance qui réalisent des attentats à coup d’ordures…
Les sociétés contemporaines ont connu une mutation destinée à corriger leurs propres excès, le souci écologique, sécuritaire ou sanitaire — certes louables — produisant par contrecoup des effets qui ne sont pas toujours mis en évidence. La caractéristique principale de ce que Michel Foucault nommait les « sociétés de sécurité » [3], qui ont succédé au systèmes « disciplinaires », est de chercher à gérer, à partir de la statistique, la probabilité de maladies, famines, ou crises diverses, afin de réduire au maximum les risques. Elles ne visent pas à interdire, mais à « laisser faire », d’où leur caractère « libéral », tout en procédant à une normalisation des comportements. Plus que les antérieures, ces sociétés d’un nouveau genre veulent minimiser tous les dangers afin d’accroître le bien-être des individus et ainsi leur productivité. Si ce souci du bien-être apparaît certes comme un progrès, il peut également entretenir un sentiment d’insatisfaction perpétuel, reculant sans cesse les exigences de ce que l’on considère être la « vie heureuse ». La volonté de réduire les risques virtuels a ainsi attisé un sentiment de crainte face à un futur nécessairement angoissant, le déclinisme ambiant nous faisant oublier que « l’Europe occidentale vit une époque paradisiaque » [4]. Devenue obsessionnelle, l’exigence de sécurité risque de nous conduire de Charybde en Scylla, empiétant sur l’autre composante essentielle de la vie en commun : la liberté.
Dans leur série de politique fiction intitulée S.O.S. bonheur [5], le scénariste Jean Van Hamme, accompagné par Griffo au dessin, se proposent de traiter de la dégénérescence possible de nos systèmes sociaux dans leur volonté d’encadrer tous les risques envisageables. À votre santé met ainsi en scène une sécurité sociale devenue despotique, assistée par une police médicale chargée de contrôler la manière de se nourrir ou la bonne mise aux normes des appareils domestiques, afin d’empêcher tout risque de maladie ou d’accident. Dans Vive les vacances !, la gestion des loisirs est aussi devenue une structure totalitaire, imposant des camps de vacances où il est nécessaire de s’amuser avec les autres, tout contrevenant au bonheur contraint pouvant faire l’objet de sanctions. Cette série se place à la croisée de deux arts du possible, la politique et la BD, pour nous plonger dans des univers qui peuvent sembler irrationnels au premier abord. Et pourtant, en sommes-nous si loin ? Pour ne prendre que l’exemple le plus évident, la peur du terrorisme nous a progressivement conduit à trouver normales les violations de la vie privée ou la limitation des libertés, faisant perdre en autonomie ce que nous cherchons à gagner en sécurité…
Néanmoins, les univers possibles produits par la BD ne sont pas seulement fantasmatiques, car ils peuvent prendre pied dans le monde réel — par exemple avec le cosplay [6] — redoublés par les nouvelles technologies qui permettent de juxtaposer le virtuel et le réel par le biais de ce que l’on nomme la « réalité augmentée », bien que celle-ci relève plus du jeu vidéo. Plus profondément, certaines BD très populaires ont pu essaimer sur le terrain politique à proprement parler, comme V for Vendetta [7]. Il s’agit d’une fiction politique dans une Angleterre post-apocalyptique, dans laquelle un parti fasciste, le Norsefire, exerce un pouvoir totalitaire fortement inspiré de 1984. Le personnage éponyme, V, est un anarchiste qui veut prolonger l’action du conspirateur Guy Fawkes [8], portant toujours un masque qui représente le visage de ce dernier. Sortant des cases de la BD, ce masque a inspiré à la fois ceux des membres de la communauté de hackers baptisés Anonymous et ceux que portaient les Indignés en 2011-2012, devenant progressivement le visage de la contestation politique.
Comme les univers produits par les œuvres littéraires ou cinématographiques, ceux que proposent certains scénaristes et dessinateurs se constituent à la manière de véritables mondes parallèles au nôtre, dans lequel le politique est omniprésent. Je ne pouvais conclure cette chronique sans évoquer à nouveau les Cités obscures de Peeters et Schuiten, dans lesquelles sont dépeintes différentes villes qui peuvent être totalement imaginaires ou inspirées par des agglomérations réelles, comme Brüsel ou Pâhry. Soucieux de produire un monde à part entière, les auteurs ont alors doublé leur production de conférences ou d’expositions, dans lesquelles ils se présentaient parfois comme des voyageurs de retour de cet univers parallèle, livrant au public leurs observations à la manière d’explorateurs.
Des points de passage sont ainsi censés exister entre la Terre et les Cités Obscures, comme la station du métro parisien Arts et métiers, qui a été transformée en 1994 par Schuiten, architecte de formation, dans un style proche de celui des Cités, afin de permettre aux usagers de mettre un pied dans l’univers obscur… La rupture opérée par l’irruption du possible est le thème même de La Fièvre d’Urbicande (Casterman, 1985). Dans la société très régulée d’Urbicande, apparaît un jour de manière inexpliquée un cube qui se met à croître en « réseau », enchevêtrement indestructible de poutres, qui envahit progressivement toute la ville. L’Urbatecte Eugène Robik vers lequel se tournent les habitants ne peut rien faire, et c’est l’ensemble de la structure sociale de la cité qui se trouve déstabilisée par cet évènement incontrôlable. Ce récit apparaît ainsi comme une allégorie du dépassement du pouvoir face à une situation de crise, lorsque celle-ci n’a pas été anticipée, une métaphore de la force destructrice du possible lorsque nul art ne parvient à le canaliser. En envisageant de manière imaginaire ces surgissements de l’inattendu, les œuvres de fiction nous permettent de réfléchir aux comportements que nous adopterions si nous étions projetés dans de telles situations. Mais elles manifestent surtout les limites de l’art politique, ainsi que la fragilité des structures sociales apparemment les plus stables, lorsque le possible vient se concrétiser dans sa version la plus aigüe, l’improbable.





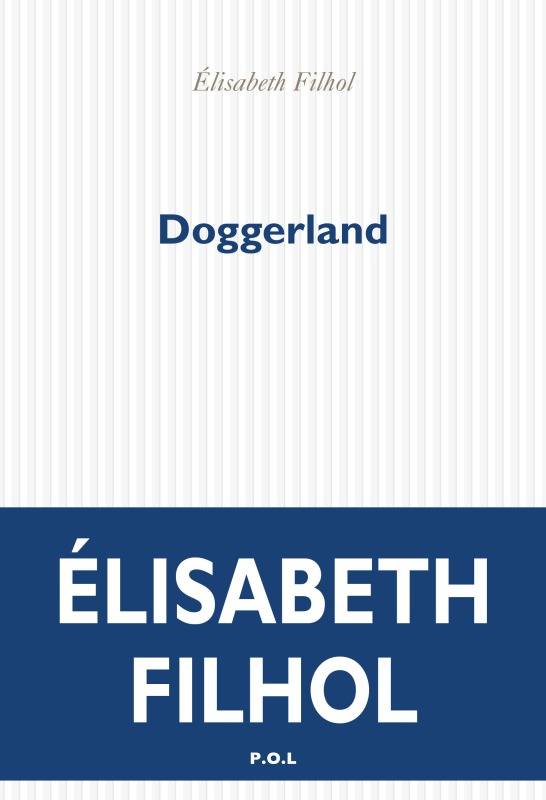







0 commentaires