Les maisons d’édition indépendantes constituent un large pan de l’édition francophone. En interrogeant l’expérience de ces éditeurs et éditrices, délibéré enquête sur ce désir d’indépendance.
C’est en 1988 que Harmonia Mundi, l’historique producteur de disques basé à Arles, s’est lancé dans la diffusion et la distribution de catalogues d’éditeurs indépendants. Président de Harmonia Mundi Livre, Benoît Coutaz revient sur son rôle.
Chez Harmonia Mundi, nous « hébergeons » cent vingt éditeurs très divers mais qui sont réellement indépendants. Ces maisons d’édition sont incarnées par la ou les personnes qui les ont créées ou reprises. Au niveau du capital, il y une absence de dividende, il s’agit d’une économie d’investissement plutôt que de spéculation. Les grands groupes éditoriaux ont une approche de marché de masse, de rentabilité, d’omniprésence. Ils obéissent à des critères différents. Les concentrations ont provoqué une interrogation de la part des éditeurs indépendants. Il y a une évolution qui questionne. Ceux que j’appelle les éditeurs indépendants ont une exigence éditoriale et pas seulement économique, même s’il faut les deux. Il faut prendre des risques éditoriaux et savoir compter pour préserver l’indépendance.
Que répondez-vous aux éditeurs indépendants qui, du fait de leurs ventes modestes, peuvent craindre d’être mal représentés ?
Ce n’est pas notre vision du métier. Lorsqu’on est sollicité ou lorsqu’on sollicite un éditeur, on doit être capable de lui apporter une perspective, une confiance et une écoute, tant en diffusion qu’en distribution pour qu’il se développe dans le temps. Si chacun de nous fait correctement son travail, avec la même exigence et la même confiance, il pourra éditer et nous pourrons nous occuper de sa distribution et de sa diffusion. Nous accueillons deux ou trois maisons en création chaque année. Au début, elles n’ont pas grand-chose : un livre, un projet que nous demandons à trois ans, à cinq ans, pour qu’ensemble nous construisions une perspective. Si les éditeurs croient en leur projet éditorial, nous on croit en notre capacité de les distribuer et de les défendre, de les représenter. La diversité de nos éditeurs nous permet d’être appréciés des libraires. Ils savent que dans ce qu’on va présenter, il y a des choses qui vont les intéresser.
Vous arrive-t-il d’intervenir sur le choix des titres, dans les catalogues ?
Jamais. Accompagner ce n’est pas intervenir. Nous travaillons avec des maisons d’édition dont la structure ne permet pas d’avoir un directeur commercial ou un directeur marketing. Nous avons des personnes en interne qui peuvent répondre à leurs interrogations. C’est ce dialogue qui nous permet de travailler collectivement. Mais c’est la responsabilité des éditeurs d’avoir choisi tel auteur, tel traducteur, d’avoir fait tel livre. Notre rôle c’est de défendre les projets dans lesquels ils se sont investis.
On parle beaucoup de surproduction éditoriale. Faites-vous le constat d’une inflation du nombre de titres publiés ?
Je ne suis pas d’accord. Il s’agit un marché d’offre, de curiosité. Mon combat, c’est de pouvoir défendre ce que j’appelle la démocratie culturelle. Si les éditeurs ne se sont pas trompés, si le diffuseur ne s’est pas trompé, le libraire va être intéressé par ce qu’on lui présente et le lecteur le sera aussi. Parfois il faut accepter de ne vendre que 200 exemplaires, parce qu’on a une qualité qui est intéressante et peut-être que cet auteur trouvera son public au deuxième ou troisième titre. Parfois on fait 40 000 exemplaires d’un premier roman, mais si l’éditeur n’avait pas eu l’audace de retenir ce manuscrit et le diffuseur de le présenter, ça n’existerait pas. Si on dit que l’on publie moins, que l’on fait que ce qui est rassurant, ce qu’on connaît déjà, la possibilité de diffuser des pensées ou des textes différents disparaît. Les grosses structures ont prétendu réduire leur production, mais on a bien vu qu’il y avait eu des renvois de contrats, des abandons d’auteurs, qu’elles ont privilégié le top 5. C’est terrible d’éditer un livre. C’est du travail, c’est du temps, des corrections, une maturation d’un projet. Je récuse le terme de surproduction. Si il n’y a pas de public, c’est qu’on s’est trompés, mais on n’a engagé que nous. Si on attend qu’il y ait un public, comment fait-on ?
Certains éditeurs peuvent se sentir pousser à publier plus de nouveautés pour compenser les retours. Qu’en pensez-vous ?
C’est un mauvais calcul. Il ne faut pas faire de la cavalerie. On publie ce en quoi l’on croit et on cherche un point d’équilibre. Économiquement il faut être prudent et exiger de son distributeur-diffuseur qu’il permette d’atteindre le point d’équilibre. C’est notre engagement. On ne publie pas pour remplir une case, ça ne sert à rien. Si vous faites ça, vous ne croyez pas réellement à ce que vous faites, vous cherchez une opportunité. Fondamentalement, on ne publie pas pour publier, on ne vend pas pour vendre, on publie parce qu’on y croit. Les succès permettent de prendre des risques.
Les libraires sont souvent obligés de vendre les best seller pour faire leur chiffre et payer leurs frais. Y-a-il une place dans les librairies pour d’autres publications ?
Le libraire a la liberté de faire son choix et d’avoir un profil de librairie différent de la librairie voisine, c’est ce qui est intéressant. Les libraires doivent prendre des précautions économiques mais ils peuvent se permettre d’être originaux, indépendants pour séduire un public différent. Une rue où il y a trois librairies, ça peut être trois librairies différentes avec une richesse particulière. Une librairie qui ferme, c’est un public qui disparaît. Il faut créer une offre, une appétence par la diversité des propositions.
On sait que des éditeurs ou éditrices indépendantes ne parviennent pas toujours à se payer. Pourquoi la chaîne du livre ne peut-elle pas faire vivre tous ses maillons ?
Il faut voir quelle est la perspective de l’éditeur dans le temps, si son but est d’être pleinement éditeur et de vivre de sa maison d’édition. Cela induit un minimum de titres au catalogue et un engagement. Les éditeurs avec lesquels nous travaillons sont globalement à plein temps dans leur maison, ça veut dire qu’ils en vivent. D’un autre côté, on sait que le prix du livre n’évolue quasiment pas. Est-ce que c’est logique ? Est-ce que le livre est au juste prix aujourd’hui ? On peut se poser la question. Je ne crois pas à un prix bas. D’ailleurs certains éditeurs ont déjà commencé la démarche d’augmenter un peu les prix, et ça peut faire une révolution. Ce qui est gratuit, les gens le consomment mais ne s’y intéressent pas. Alors qu’un livre, c’est des heures de lecture et de détente renouvelables, il est prêtable, échangeable, c’est une belle tranche de vie.
Propos recueillis par Juliette Keating
Indépendances





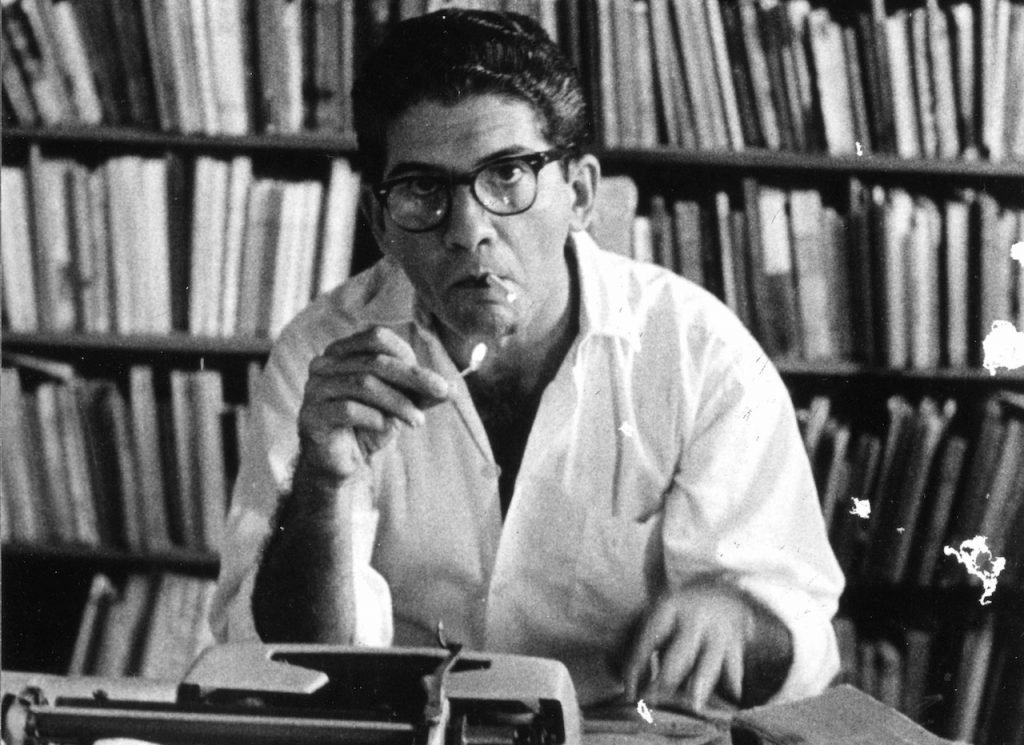

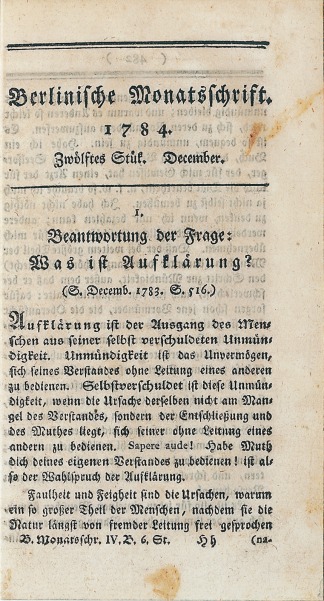
0 commentaires